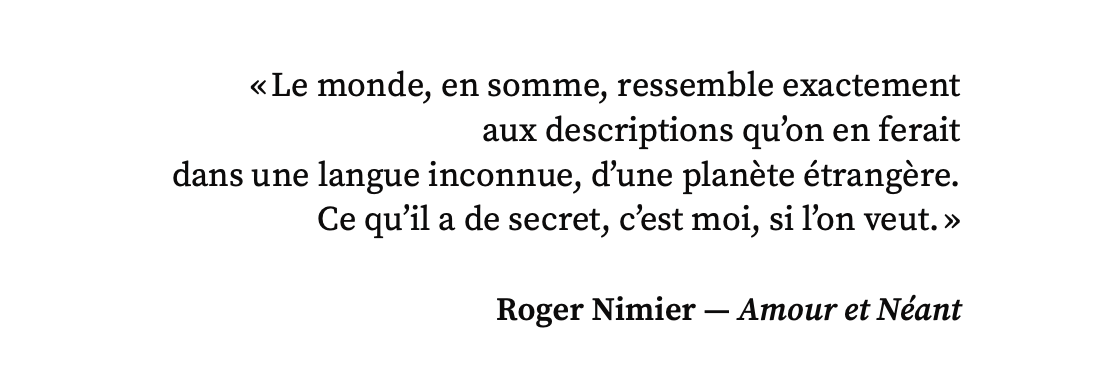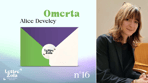La nuit Cayenne, Victor Dumiot
Lettre Zola n°05 - juin 2024 « J’ai quinze ans, et vis depuis quelques mois en Guyane. Un soir, Nicolas, Lara et moi décidons de nous rendre dans une soirée clandestine. On aurait pu y laisser notre peau – ou pire. Une chose est sûre : si vous racontez ce que vous avez vu en Guyane, personne ne vous croira... »


« Tu ne peux pas rester chez moi », ma mère m’a dit, parce qu’elle a de grosses emmerdes avec cet homme, mauvais amant, mauvais repris de justice, meurtrier mal reconverti, rencontré dans une formation professionnelle agréée par l’État, qui nous menace de mort, elle et moi, depuis qu’elle a décidé de le quitter – définitivement.
Je suis terrorisé par ses appels incessants, ses coups sur la porte, jour et nuit, ses filatures dans la rue. Trois semaines que nous vivons barricadés. Je ne l’ai jamais vu, ne sais pas à quoi il ressemble physiquement, il n’est pour moi qu’un SMS reçu à 16h47 : T morte.
Un fantôme qui, de nulle part, surgirait pour le sang.
Fin des vacances d’été, sans aucune promesse de retrouvailles l’année prochaine, ni de générique mielleux comme à la fin des teen movies, j’ai si peur que je ne pense même pas à ma mère, que j’accuse d’être responsable, coupable, inconsciente d’avoir pris ce risque, sans imaginer une seule seconde l’enfer qu’elle a subi, et qu’elle me cache pour « ne pas en rajouter », ni celui qu’elle s’apprête à traverser seule. Un vendredi matin, après avoir passé une heure à marcher au bord de la Loire pour réfléchir, elle est catégorique :
— Tu vas partir ce soir, ton père a pris le billet : tu le rejoins en Guyane.
Rien ne nous prépare jamais assez à la fuite. On en rêve parfois, mais ce n’est jamais le bon moment. Ce n’est pas comme dans une partie de cache-cache ou de loup, ça ne se termine pas par un essoufflement joyeux, on ne peut pas dire : « Attends, je recommence », ce n’est pas comme dans un jeu vidéo, ou dans la théorie, lorsqu’on imagine avec légèreté ce que l’on emporterait avec soi sur une île déserte en cas de catastrophe nucléaire ou d’exil.
La fuite est un engagement jusqu’au-boutiste de la vie tout entière.
Le temps se compte et se perd. Mes dernières heures à Tours, dans le petit HLM que ma mère occupe et qu’elle refuse de quitter, question de j’y suis j’y reste, sont celles d’une préparation précipitée à vivre ailleurs, en Guyane. Je regarde dans ma chambre tous ces objets accumulés que je ne pourrai pas prendre avec moi. Je dois choisir entre un album photo, une boîte que ma grand-mère m’a offerte, achetée à Poitiers et dans laquelle je conserve précieusement mes souvenirs, et un autographe de Clara Morgane que mon père m’a donné il y a très longtemps. Prendre le plus utile. Alors je bourre mon sac de l’essentiel, des t-shirts, des sous-vêtements, mon ordinateur et ma Xbox.
— Tu devrais la laisser ici, elle prend trop de place, me dit ma mère.
C’est hors de question.
Je n’ai pas de valise.
— Ton père t’achètera des affaires-là bas ! rajoute encore ma mère sur le chemin de l’aéroport, d’une voix faussement distante.
« Tu devrais partir avec moi », ai-je envie de lui répondre. Mais la honte, la douleur, et sans doute la tristesse, nous obligent au silence et je comprends en la regardant, mine fatiguée, éteinte, froid moteur d’une voiture la nuit en hiver, qu’elle souhaite affronter seule la situation, comme si elle était la capitaine d’un navire troué, qui observe de son poste de commandement tous les passagers foutre le camp. Elle va se désagréger. Je serre fort les sangles de mon sac, une bouée de sauvetage, un parachute, l’idée même du départ, de la vie qui m’attend, qui doit reprendre, et compte les minutes, et compte les secondes qui m’enferment en France. Je veux l’envol, je veux l’ex- filtration, quitter le territoire hexagonal, métropolitain, et être mis en sécurité, enfermé en plein vol stationnaire dans la carlingue hypersonique d’un avion de ligne Air Caraïbes, où les stewards portent un uniforme de couleur bleue, bleu comme le lagon, bleu comme le curaçao, bleu comme le paradis. Et de pouvoir enfin souffler.
Terminal B, enregistrement et portiques de sécurité.
En disant au revoir à ma mère, cet au revoir tragique que l’on prononce pour se rassurer, pour s’excuser, aussi, pour ne pas se sentir trop coupable, je me sens douloureusement l’inverse d’un être écartelé, réduit à n’être plus qu’une bande de muscles, un centre sans direction, hors gravité, qui ne peut que laisser faire.
La Guyane commence par la bouche de mes parents, qui m’ont raconté leurs aventures, parce qu’ils y ont vécu quand ils s’aimaient, il y a longtemps, à moto, à la Crique, dans les carbets, à la frontière brésilienne. Beaucoup de sueur, de rhum, beaucoup de sexe, de sang et de regrets. Depuis, notre famille gravite autour de cette terre comme d’une étrange planète qui, à chaque nouveau cycle, impo- serait qu’on la visite.
Cela se produit tous les vingt ans.
Je me souviens aussi du film Papillon, dans lequel Steve McQueen joue ce prisonnier enfermé à tort sur l’île du Diable, au large de la Guyane, comme avant lui le pauvre Dreyfus en 1895, et qui parvient à s’en échapper.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage.
Par le hublot, j’observe l’océan Atlantique qui brille, barrière d’eau, de sel et de kilomètres qui donne l’im- pression d’un désert, qui renforce celle de la traversée, du dépaysement – c’est-à-dire du nettoyage des paysages connus. On ne sait pas bien si l’océan protège ceux qui ont fui, comme moi, ou s’il tient à l’écart, de toutes ses forces, la Guyane, comme d’un corps contaminé, naturellement mauvais et radioactif. La vraie terre des damnés. De là peut-être l’esprit insulaire de ces habitants des Antilles continentales, qui ne font pas tellement la différence entre la mer et les arbres, ce vert-marron qui s’étend à perte de vue et dans lequel, indistinctement, tous disparaissent, se noient et revivent.
Arrivé à l’aéroport Félix-Éboué (Matoury), la première chose qui me frappe, c’est la chaleur. Pas cette chaleur que l’on connaît en métropole, pas cette chaleur caniculaire, même de 2003, pas ce soleil tragique camusien qui vous perce l’écorce frontale comme la pointe d’un leucotome. Plutôt la chaleur du Salaire de la peur. Une chaleur moite, transpirante, épaisse, qui ne vous frappe pas mais vous enveloppe et vous compresse le corps, qui vous accompagne et vous enferme comme une bulle d’air sans air, comme un masque sur la peau, comme si vous étiez sous couveuse, comme un microclimat porté à même la chair. Vous cherchez l’oxygène, vous promenez votre bouche, mais toujours vous n’inspirez que cette chaleur humide et visqueuse.
L’avion a préparé son effet en me plaçant sous climatisation continue, jusqu’à ce que mon pied frappe la première marche de l’escalier mobile, le soleil en haut qui aveugle, et les arbres tout vert foncé plus loin, et la terre, mon Dieu, ce marron-rouge des pistes, rouge comme des muscles, qui enserre l’asphalte de l’aéroport, il faut que je respire, il faut que je respire lentement, tandis que les habitués, les locaux me poussent en ricanant sur le côté car je n’avance pas assez vite et qu’eux s’empressent de re- joindre à grands pas leur famille, leur véhicule, leur vie. Je regarde à gauche, à droite, essaie de me raccrocher à quelques regards, à quelques visages familiers, mais tout me paraît différent, les voix fortes, les débardeurs blancs, les polos Hugo Boss, les petites sacoches noires tenues en bandoulière, les longues chaînes d’argent ou d’or que les hommes portent, les « moun », « blada », les pschitt, des échos de langues qui me montent aux oreilles comme des serpents, du portugais, du créole, du russe, de l’espagnol et du français, tout se mélange et le vertige arrive en flashs blancs qui me tachent les yeux, et j’ai de plus en plus chaud. On vient de vider l’appareil.
Mon père m’attend comme prévu à la sortie, avec ses lu- nettes de soleil un peu ridicules, des lunettes de tennisman – ou pire, de cycliste –, qu’il a trouvées par terre. Je ne me sens pas dépaysé, je crois être entré dans le mauvais pays.
On s’installe en silence dans la voiture garée sur le parking bordé par la jungle.
Nouveau sas de chaleur sous la tôle chauffée, j’expire, me bouche les narines dans cet habitacle qui empeste l’humidité, le renfermé et le sel. C’est une vieille Citroën qui tombera bientôt en panne. Il fait si chaud que je panique, je ne vais pas tenir ici, j’ai l’impression que mon cou se contracte, que le col de mon t-shirt le serre. Mon père précise :
— La climatisation ne fonctionne pas, faut que tu ouvres la fenêtre.
Je me sens triste, pauvre et vulnérable. Le véhicule démarre, ronronnement du moteur, on allume l’autoradio pour diluer le silence et j’entends : « Toujours pas de nouvelles du puma, aperçu dans les rues de Rémire-Montjoly. »
Je demande :
— C’est loin de chez nous, ça, Rémire-Montjoly ?
— C’est où on habite, me répond-il en souriant.
— Génial.
Après quelques longs instants de silence, mon père ajoute :
— Si t’es pas content, tu peux repartir, hein ! Repartir.
Je tourne la tête en direction de l’aéroport et regarde, au travers des grilles qui les délimitent, les longues pistes gris et noir sur lesquelles le soleil semble devenir de l’eau. J’ai le front qui coule complètement. Ici, la chaleur est bien le premier ennemi de l’homme, juste après les mous- tiques qui me piquent le cou, les chevilles et les avant- bras. Un avion se prépare déjà en effet à repartir, mais mon père accélère comme pour me dire : « Ah ben, c’est trop tard, fallait te décider avant. »
La Guyane est une destination sans issue. Une sorte d’attrape-rêve qui promet aux audacieux et aux âmes vagabondes de combler leur faim d’aventures. Tous s’agglutinent et se collent les ailes à cette terre rouge, violente, dans laquelle sont embourbés les cris, les blessures, les traumatismes de l’histoire coloniale, terre à l’identité compromise, contradictoire, contrastée. Le bras du monde s’est ici allongé, et a étendu ses gros doigts pour former mille ramifications qui jamais ne se touchent. Les hommes demeurent séparés comme en zone de transit. Coincés, attendant de pouvoir repartir, hagards, soufflés par les promesses luxuriantes, le rêve d’une abondance par simplicité, cherchant à conclure de bonnes affaires, ou se purifier dans l’eau du Maroni. C’est à cette source que le sang qui coule dans leurs veines se colore étran- gement. Tous se sentent habitants d’une même planète, paradis de couleurs où le vivant s’abrite, grandit, grossit, prolifère, où la lutte est à toutes les échelles, à chaque seconde, depuis la liane jusqu’au trottoir.
Cette planète appartient au mouvement, elle est hostile aux signes qui pourraient la fixer, à ceux qui croient la tenir. Elle supporte mal les solutions provisoires, les poli- tiques temporaires et cosmétiques, et les millions d’euros qui y sont déversés et récupérés par une poignée d’héritiers créoles, grands propriétaires à la gestion mafieuse qui ne font pas grand-chose, sinon se plaindre, des cou- pures d’eau, d’électricité, de la faillite locale des services publics, des prisons surchargées, de l’abandon policier face à l’ultraviolence, du fait qu’on crève pour un bracelet, pour un portefeuille, pour un mauvais regard dans la rue, ou bien à l’hôpital, d’une septicémie, après sept heures d’attente, parce qu’il n’y a pas assez d’infirmiers, pas assez de médecins, parce que le matériel est vétuste, parce qu’ici tout arrive plus tard, tout coûte plus cher, cette planète, c’est soi-disant la France, c’est la France dégradée, c’est la France délaissée, c’est la France d’outre-mer.
Je vous le dis, cette planète est vivante, pensante, com- battante, et elle avance comme les 500 Frères qui se sont levés en 2017, trois ans après mon départ, pour réclamer moins d’injustice, moins d’insécurité, et plus d’action. Cette planète est laissée de côté, ce qui fait pour certains la chance, pour d’autres la tragédie de cette Guyane où l’on vit de feu et de pluie battante.
Novembre 2011
Comme prévu, je reçois son message juste avant qu’il n’approche de chez moi :
23 h 19 : t’es bon ?
Dans le silence, je me redresse sur mon lit, dos immo- bile contre le mur, et je tends l’oreille en calmant ma respiration. J’ai le plan dans la tête.
Je me suis couché tout habillé, t-shirt, short et chaussettes noirs. Il me faut environ sept secondes pour retirer mon drap, me tourner, puis me pencher – sans faire grincer les lattes du lit – et tirer vers moi le battant de la fenêtre, préalablement ouverte (la plupart des maisons de Guyane sont équipées de barreaux aux fenêtres pour pré- venir les intrusions et les cambriolages, très fréquents, et parfois très violents. L’année de mon arrivée, dès le mois d’octobre 2011, une bande de braqueurs brésiliens commence à semer la terreur à Cayenne et à Rémire-Montjoly. Comme des tueurs en série de la côte californienne, ces hommes frappent chaque nuit une à deux maisons. Ils volent tout, des bijoux au contenu du frigo, et surtout s’en prennent au père, à la mère, aux enfants, qu’ils défoncent à coups de poing ou qu’ils violent. Pendant ces mois de psychose, il n’est pas rare d’observer devant les maisons, la nuit, des propriétaires soucieux, des maris inquiets, des grands frères protecteurs, armés d’un fusil de chasse et qui veillent. La Guyane est le seul département français où il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour détenir un fusil. Chaque matin, en écoutant la radio avec mon père, nous suivons la progression des braqueurs. « Tiens, me dit-il un jour, c’est le voisin d’en face qui a été frappé. Pas de chance ! » Une loterie infernale. Chez nous, il n’y a pas de barreaux, car mon père prétend que ça ne sert à rien et que ça coûte trop cher, version qu’il révisera légèrement lorsqu’il se retrouvera, nu, face aux cinq hommes qui sont entrés par effraction chez nous en défonçant la fenêtre avec un simple pied de biche, les menaçant avec sa raquette de tennis et son torse velu. Nous avons eu de la chance, confirmeront les gendarmes, qui nous conseilleront à demi-mot, « pour la prochaine fois », d’acheter une arbalète et de nous débarrasser des corps en les jetant directement dans le fleuve. C’est plus simple, « car on ne fera pas d’enquête »). Ensuite, donc, je n’aurai plus qu’à enjamber le mur, refermer le tout sans bloquer le mécanisme, courir sur la pointe des pieds, sauter par-dessus la grille, et le tour sera joué.
Mon père se trouve dans la chambre au fond du cou- loir, juste après la salle d’eau, une diagonale d’exactement sept mètres sépare nos deux portes. Contrairement à la mienne, celle de mon père est toujours ouverte, je dois en tenir compte, car cette configuration lui permet de tout entendre et d’agir par surprise comme Schwarzenegger dans Commando. Il dit qu’il a trop chaud, qu’il n’aime pas dormir comme en prison, je crois surtout qu’il aime avoir l’œil ouvert, même s’il le tient fermé.
Je reste sur mes gardes, mon plus grand ennemi, c’est moi. Il m’est arrivé de fuir un équipage de policiers après avoir tagué un immeuble d’avocats, et de trébucher sur des ordures à la dernière minute, et d’être rattrapé par une main de fer, tenu par une main de fer, et conduit au poste de police pour la prise des empreintes. « T’es con ! » m’ont dit mes amis. Je suis celui qui craque à la dernière seconde sous la pression, dont la cheville reste coincée dans la grille, qui perd une chaussure dans la course, celui qui glisse, qui vacille, qui s’arrête, qui abandonne, je suis celui qui craint les conséquences de ses actes.
Je ne veux pas que mon père me voie, et je suis sûr qu’il est équipé de capteurs sensoriels qui le rendent hypervigilant, le moindre battement de mon cœur pour- rait me faire repérer. J’ai peur d’être mis sous le joug de son regard et de sa voix d’homme qui porte, peur qu’il m’engueule et m’écrase, qu’il casse mes tasses, tape dans ma poubelle, cogne sur mon bureau, comme il le fait parfois, parce qu’il n’aime pas que je le prenne pour un imbécile, que je le dupe, en Guyane ou ailleurs, ce sont les mêmes lois qui règnent à la maison sous son ordre quasi divin, la fête il faut la réclamer, demander son autorisation, formulaire à faire signer pour un accord paternel tacite et non renouvelable. « Tu peux tout me dire », affirme-t-il parfois, en mode complice, amigo amigo, mais comment lui dire que c’est justement le secret qui emporte et embrase les fêtes d’adolescents ? Comment lui dire que c’est le secret, mon secret, ma vie secrète, plus que la joie de les trahir, lui et sa confiance, qui a raison de mes sorties clandestines en Guyane ou ailleurs ? Le secret, c’est la vie intérieure, c’est la pulpe de vie, l’essence vitale de la vie même, le seul domaine imprenable, l’endroit seul où nos propres pas sont faits. Voilà pourquoi les régimes totalitaires mettent tant de passion à arracher nos secrets, à détruire leur possibilité même d’enracinement. Le secret, c’est une rivière, c’est un fleuve, c’est le monde qui ruisselle intérieurement. Il faut fuir, je crois, de toutes ses forces la transparence et l’obligation de se dire. Il faut nourrir, nourrir la vie qui en soi croît, qui se planque sous des lames de vase, sous la langue, la salive, les pensées et les muscles. Il faut mentir, feindre, et sourire. En réalité, j’ai surtout peur de décevoir mon père.
Aucun bruit, rien, pas même les ronflements qui d’habitude servent d’assez bon indicateur de champ libre. La moustiquaire (elle sert à arrêter, théoriquement, la plupart des insectes qui vous rendent visite la nuit. Il y a les moustiques, certes coriaces, les pires ce sont les tigres, ces enfoirés gros, gras, épaissis de sang vous transmettent la dengue ou le chikungunya, parfois la fièvre jaune hémorragique – contre laquelle vous êtes obligatoirement vacciné avant d’entrer sur le territoire, question de vie ou de mort. Mais il y a aussi les moucherons, qui piquent en nuées, ou alors les mygales, comme la matoutou, qui fait la taille d’un poing, longue de quinze centimètres, velue, noire de chez noire, qui brille d’un bleu corbeau, avec des reflets électriques, et que l’on retrouve parfois dans le coin des chambres ou dans la salle de bains. Certains les élèvent, comme les boas constricteurs du fond du jardin. Moi, j’en fais des cauchemars. Il y a une problématique d’échelle du vivant en Guyane, tout semble plus gros, même les mouches ressemblent à des oiseaux. Je me souviens de ma belle-mère qui, de la terrasse, a cru voir un après-midi un chat dans le jardin. Un très joli chat au pelage marron. « Regardez le chat ! s’est-elle enthousiasmée. Comme il est beau, ce chat ! » Et mon père, qui connaît un peu la faune pour l’avoir caressée, de répondre: « Ce n’est pas un chat. C’est un rat. » La moustiquaire, c’est un barrage filtrant dressé entre vous et l’entièreté du monde vivant. Sauf que la mienne, évidemment, est trouée), cette moustiquaire, donc, située entre le haut de ma porte et le plafond, m’offre une vision assez nette de la luminosité ambiante.
Aucune lumière à proximité, non plus.
23h21 : alors ??
Je tape le plus silencieusement possible sur l’écran de mon téléphone portable, mon cœur s’emballe, l’oreille tendue qui chauffe, s’étire et s’installe dans le couloir où elle reste à l’affût du moindre grognement paternel.
23 h 22 : c’est bon !!! jarrive
Vite, je me tourne, me penche, me redresse et tire la poignée, passe par-dessus, atterris sur la pointe des pieds, son étouffé, attrape mes chaussures par le glissoir, les tiens à la main, « C’est bon », me dis-je, j’écoute par la fenêtre, tête dans la chambre, corps dehors, toujours aucun bruit, la voie est libre, je ferme le tout, j’avance sur le carrelage de la terrasse, marche sur un insecte qui craque sous mes orteils, beurk, je sursaute, et saute carrément dans le jardin, cours sur la terre, me pique les pieds dans la nuit sur des herbes séchées, j’avance, écorces de fruits pourris, pourvu que les voisins ne me voient pas, j’avance, la tête penchée, la nuque cassée du criminel, j’avance, et me répète « À moi, à moi », et je continue, finis par heur- ter une forme fine et rugueuse qui glisse, s’enfuit, pas le temps de voir, mon cœur bat si fort que j’ai envie de faire demi-tour, je suis dans le mal, mais je pense à la fête, la fête, à moi, à moi la fête, j’arrive enfin à la grille et la saute, glisse, tombe la tête la première sur le sol mou, des chiens hurlent à la mort et des lumières s’allument sur la terrasse d’en face.
— Ce n’est rien ! C’est juste moi, dis-je au voisin.
De l’autre côté, Nicolas sourit sur son vélo, et j’exulte. Ça y est ! Ça y est, je suis venu ! Ça y est, je suis en vie !
Faire le mur, ce n’est pas sortir de sa chambre ou échapper à son sommeil, c’est plutôt entrer quelque part, dans la folie du monde. Un art semblable à celui du petit pont. Une affaire de kairos et de bonne occasion. C’est pratiquer l’escalade sans harnais, se sentir nu dans la ville, sans filet de sécurité. C’est être soi et personne d’autre, être justement libre.
« À moi, me dis-je encore, la nuit Cayenne. » — On y va ? lance Nicolas.
— Allez !
Nicolas est la plus grande tête brûlée que j’ai jamais rencontrée de ma vie. Un accélérateur de particules de problèmes, qui se fourre dans à peu près tous les mauvais plans possibles, champion de la plus mauvaise idée, qui va chercher au contact le danger – et Dieu sait que la Guyane en propose – mais s’en sort toujours vivant et sur ses deux jambes. Toujours à rire, qui jamais ne s’inquiète, toujours fourré dehors, toujours en fuite. C’est le fils d’un haut fonctionnaire, il habite une très belle résidence sécurisée avec le reste de sa famille bourgeoise. Je crois qu’il n’aime pas beaucoup l’ambiance grosse berline, chauffeur obséquieux et fauteuils en cuir. Un jour, j’ai vu sa mère, lors d’un déjeuner tranquille, lui jeter au visage son verre de vin rouge juste parce qu’il avait mal répondu. On lui a ordonné de rester à table, ensuite. Et il est resté comme ça, sans rien dire, calme malgré le liquide qui coulait et tachait ses vêtements blancs, son épaisse musculature contractée, comme sa mâchoire, les yeux baissés, figé. J’ai commencé à comprendre ce qu’il fuyait. C’est lui qui a eu l’idée de cette fête.
— Tu connais les sound systems ?
— Non, c’est quoi ?
— Une tradition ici, faut que tu en fasses au moins un.
Trois cents personnes réunies pour danser.
— Une boîte de nuit, quoi !
— Non, mieux que ça. On va y aller samedi. C’est à Piste Tarzan.
Entourée par le Brésil au sud et le Suriname à l’ouest, proche d’Haïti et de la République dominicaine, la Guyane attire comme un aimant. Un peu comme si vous aviez installé votre grande et luxueuse maison au milieu d’un quartier populaire de n’importe quelle banlieue. Votre mai- son est vide, parce qu’après avoir construit les murs vous n’aviez plus assez d’argent pour le reste. À l’intérieur, vous vivotez, mais ceux qui sont tout autour n’en savent rien. Vos portes sont ouvertes, ils entrent. Une fois sur place, personne ne se mélange, de l’huile, du vinaigre, et d’autres aromates qui grossissent comme des flaques. Chacun occupe un coin de cette grande maison, et certains vous regardent, un peu envieux. Même un simple professeur de métropole a une gueule de millionnaire pour celui qui n’a ni papiers, ni Sécurité sociale, ni eau courante, qui a traversé fleuves et jungles pour venir ici, qui a grandi au milieu des gangs et des coups de machette, pour qui la vie n’est rien d’autre qu’une carte à jouer, qu’une expérience à tenter. Il n’y a pas de brassage multiculturel, mais des terres pleines de cultures, ça oui. Comme le village de Cacao, construit dans les années 1970 pour accueillir les Hmong, appelés en Asie Miao, référence péjorative au miaulement du chat, censée décrire la sauvagerie natu- relle de ces hommes, femmes et enfants persécutés au Vietnam, notamment. Aujourd’hui, les Hmong s’occupent de l’agriculture, des épiceries, et pour certains des tables de poker clandestines.
Le site de l’INSEE indique que 53 % de la population vit sous le seuil de pauvreté ici. L’expérience quotidienne le confirme.
Juste derrière chez moi, au bord de la route, est ins- tallé un bidonville devant lequel je passe chaque matin pour me rendre au lycée. Une vingtaine de maisons en tôle, rouge-orange, rouillées. Des pneus, des bidons et autres objets de récupération. Au milieu de cela, la terre, ravinée, une dalle de béton. Quelques poules qui se pro- mènent à l’intérieur, et traînent derrière elles une armée de poussins piailleurs. Et des branchements sauvages au premier pylône électrique qui montrent, quand on lève la tête, un entremêlement anarchique de câbles pas si épais. Toute cette existence bricolée se cache au dos des troncs de ces larges arbres aux longues feuilles vertes, de ces bouts de jungle, soit par pudeur, soit par honte. L’un de mes amis haïtiens y habite avec sa mère, et ses quatre sœurs, qui me sourient à chaque fois qu’il me ramène à vélo, mon cul sur le guidon. Carl-Édouard m’appelle son « blada », son pote. En 2020, la préfecture a décidé de nettoyer la zone, un peu comme à Mayotte, plus tard. J’ignore ce qu’ils sont devenus.
La Piste Tarzan, c’est l’un des plus grands bidonvilles à flanc de colline de Cayenne. Une sorte de ville à l’intérieur de la ville, on évite de s’y rendre par hasard. La plupart des gens évitent de s’y rendre tout court. Le type qui nous fait entrer s’appelle Bryan, un autre camarade du lycée, qui prétend avoir notre âge mais qui en fait dix de plus. Un métis, japonais et brésilien. Lunettes Ray-Ban modèle Aviator, faux diamant à l’oreille droite, chemise noire et pantalon blanc. C’est un DJ, il connaît bien les sound systems.
— C’est par ici.
Marchant sur la route, Bryan devant nous, je traîne les pieds, apeuré, j’observe les murs de métal usé qui s’étendent à droite comme à gauche, sans comprendre ce qu’ils sont réellement. Sommes-nous déjà à l’intérieur de la fameuse Piste Tarzan ?
— J’espère que tu as pris ce qu’il fallait, me souffle Nicolas.
J’avais presque oublié.
— Bien sûr, j’ai tout !
Les yeux de Nicolas s’agitent, et son sourire s’ouvre sur
des dents qui luisent à la lumière de la lune. Je sors de ma poche un morceau de gâteau écrasé, enveloppé dans de l’aluminium.
— Tiens, le voilà.
Peu importe ce que vous cherchez en Guyane, vous le trouverez. J’ai découvert, dès le mois d’octobre, que mes voisins, un couple de rastas roux, infirmiers, venus de Marseille, ont une spécialité gastronomique un peu particulière : le gâteau magique. Un space cake que la NASA ferait bien de breveter rapidement tant une simple bouchée – et quelques minutes d’attente – suffit pour vous propulser dans l’espace et visiter Neptune, Vénus, et même d’autres galaxies, pénétrer de nouveaux espaces-temps, taper dans le tentacule d’extraterrestres extra-cools, et rejoindre le saint ciel des mille dimensions possibles, sans que Houston vienne vous casser les pieds avec ses histoires d’altitude ou de trajectoire défaillante.
La plupart des gens ici se fournissent à Balata. La drogue est un fléau en Guyane, et plus généralement dans les Antilles, grand port d’expédition de la cocaïne vers l’Europe, et qui dévore les hommes au moins autant que l’alcool. Place des Palmistes, où le vendredi soir sont installées des roulottes, j’ai vu un SDF poursuivre un homme sur plusieurs mètres avec un coupe-coupe. J’ai discuté avec Steve, aussi, à la terrasse d’un café. Steve, c’est un SDF blanc, un « métro », une autre de ces âmes errantes, qui ne se mêle pas des sales histoires avec le peuple des camés, se contente de faire la manche honnêtement. Grand, maigre, aux longs cheveux blonds, des poches noires, des sillons creusés sous les yeux, une mine de zombie qui témoigne de tous les coups, de tous les cauchemars qu’il a endurés depuis qu’il est ici, coincé.
— Comment t’es arrivé en Guyane, Steve ? lui demandé-je un jour.
— J’avais vingt ans, je me faisais chier à Montpellier. Je suis venu ici parce qu’on m’a parlé de l’or.
— T’as cherché de l’or ?
— Ouais, orpailleur mais pas longtemps.
L’orpaillage a fait tourner bien des têtes, il en a coupé aussi. Et dans la jungle, plus haut, impénétrable, qu’on ne peut surveiller, ce sont les mitraillettes des soldats français, gendarmes, légionnaires, qui font appliquer l’ordre et la morale contre les garimpeiros. Quelques pépites d’or contre des trous dans la peau. Au milieu des arbres, tout arrive et les soldats soufflés vous racontent de ces histoires, pendant les apéritifs, comme s’ils revenaient du Tchad avec dans les yeux l’abîme de la mort qui les bouffe en parasite.
— J’ai fait des grosses bêtises, continue Steve, à cause des substances – il dit « substances », et je remarque sur ses avant-bras des lignes de points sombres, la peau décolorée, violacée –, j’ai perdu mon argent, mes papiers, et ça fait au moins... vingt ans ! Vingt ans.
Steve a les yeux grands ouverts, stupéfait, vingt ans, doit-il se dire, déjà vingt ans qu’il est coincé dans ce cercle des enfers à répéter les mêmes rituels pour subvenir à son addiction. Vingt ans, il n’en revient pas, soufflé par cette révélation.
— On n’est pas si mal, reprend-il. Regarde-moi, je n’ai pas l’air bien ?
Et, face à moi, soleil dans le dos, il contracte ses deux bras veineux, gonfle les biceps comme un bodybuilder sur le podium, avec un large sourire. J’ouvre l’emballage, partage le tout en trois gros morceaux, et nous trinquons faussement au milieu de la route avant d’avaler l’ensemble.
Des formes ondoient, des ombres se décollent des murs, passent devant nous, traversent la route, un type manque de me percuter, un scooter fuse pleins phares sur le côté, je baisse la tête, j’entends pschitter, je respire le plus profondément possible pour ne pas laisser l’angoisse me prendre, une sonnerie de téléphone à droite me fait lever la tête, et je remarque de proche en proche, jusque sur les hauteurs, des lumières jaune orangé, on dirait la Voie lactée à portée de main, c’est la Piste Tarzan qui clignote de haut en bas, un étoilement de lucioles couchées sur la pâte du sol, d’existences précaires pourtant bien installées.
Soudain, une porte s’ouvre à quelques mètres de nous, je sursaute et Nicolas me tape dans le dos. Nous nous approchons lentement, des lumières de toutes les couleurs apparaissent, s’échappent des murs, même par-dessus, ambiance à ciel ouvert. Cette porte masque à peine l’autre monde, le monde des aventures secrètes et célestes, du désir porté comme une soif, le monde des susurrements, des glapissements et des claquements, celui du ti-punch, du rhum coco, le monde d’une fête célébrant l’ivresse de vivre pour tous les nyctalopes du coin.
— Putain, on dirait que ça vomit des arcs-en-ciel ! remarque Nicolas.
Comment ai-je pu ne rien voir ? Ne rien entendre, surtout. Car ici la musique est omniprésente, gigantesque.
BOOM. BOOM. BOOM. Elle vous tance, elle se ressent comme un phénomène surnaturel, passant par toutes les successives vibrations que les murs de tôle transmettent et libèrent, milliards de milliards d’atomes qui se frottent et se cognent à la vitesse d’un avion de chasse, incapables de contenir cette boîte à bruit géante, crachant dans l’air le seul, l’unique, l’immarcescible appel du dancehall. J’approche de la porte, où deux gros individus, grands comme quatre hommes, nous barrent l’accès. Bryan va pour les checker, poing contre poing et poing contre cœur, lorsqu’une sirène retentit de l’autre côté, dans la fête ; je me penche vers ce trou lumineux et entends une voix qui annonce sous la clameur :
— DJJJJJJ YANNICKKKKKK, MAN, CE SOIR EST LÀ POUR VOUS METTRE LA CHALEUR !!!!! FAITES DU BRUIIIIIIIIIT...
Il faut être entré dans la ronde du sound system pour comprendre ce qui se joue là, sous les yeux, à portée de main. La musique rendue palpable comme de grosses goyaves pleines de pépins, celles qu’on va ramasser entre copains en promenade. On veut mordre dedans – on est mordu. J’ai les poils qui se dressent dans la moiteur tremblante et hypnotique du lieu, équipé d’un large mur d’enceintes qui crachent et tambourinent contre le cœur. Une nuit sous pression parfaitement instable que des lumières pulsées, expulsées, stroboscopées découpent, tels ces troncs d’arbres qui flottent dans la mer guyanaise et qui vous assomment par vagues trompeuses aux reflets de terre (c’est la première chose que m’a racontée Mélanie, une autre amie, née en Guyane, quand nous étions à la plage de Rémire, juste au bout de ma rue, et que j’ai vu ses yeux se remplir d’inquiétude alors que je courais, heureux, en caleçon, vers l’eau. « Fais attention, mon père est mort noyé ici », m’a-t-elle lancé. Tout le monde respecte cette mer qui tend des pièges, avale au hasard les corps qu’elle vomit ensuite sur le sable, les poumons salés et la bouche pleine de bulles affreuses), sans parler des volutes de cannabis, le « kali », que l’on fume à tous les étages de la soirée, qui transforment ce lieu pourtant ouvert aux étoiles en une grotte au brouillard charmant qui se colore en rose au contact des projecteurs rotatifs, un peu comme la poudre acidulée des Big Baby Pop, et, par ce simple souvenir d’enfance, je me rappelle la faim intense qui m’a envahi, et l’envie d’ouvrir la bouche, et de sortir la langue, et de laper le monde.
J’ai de plus en plus chaud, le souffle cosmique du gâteau m’écrase le crâne et mes rétines se resserrent, focale limitée, je ne vois plus que des formes et des halos qui grossissent, s’illuminent, avant de disparaître, jetés dans un coin d’ombre ou vers le ciel. Il faut que je me rapproche, Nicolas a disparu, je suis seul et j’ai les yeux qui veulent rouler par terre, rebondir sur le sol au rythme imposé par le DJ.
Ce n’est pas la Crique, ici, pourtant, ce quartier de Cayenne où les plus anciens, ceux qui ont connu la Guyane du xxe siècle, ex-métropolitains, Blancs cramés, Guyanais, Créoles, Haïtiens, Brésiliens, même mon père, ont vécu des aventures qu’ils m’ont racontées, de la vraie nuit jusqu’au bout, dévalée, et mieux qu’à Paris et n’im- porte où ailleurs – « Comme tu n’as pas idée », ajoute mon père –, où les orpailleurs sortis de leur vert enfer payaient au comptoir, avec des pépites d’or durement arrachées à la terre, des coups à tous leurs potes éphémères. C’est à la Crique, en octobre 2017, que le président français est venu jouer de grands discours, chemise blanche transpirante, semi-ouverte, pour expliquer aux oubliés locaux qu’on ne les oubliait pas vraiment, que lui, E.M., initiales de la République française en marche et en avion et pour- quoi pas en pirogue vers Grand-Santi, village du bout du bout, se souviendrait de les aider, de les soutenir, tout en soulignant qu’il ne ferait pas de miracle. « Je ne suis pas le père Noël. »
J’admire la dignité des Guyanais, qui savent offrir des sourires, et qui savent en temps voulu – après discussions et promesses – tout embraser. Je m’avance dans cette ronde, frêle adolescent inca- pable de plier les genoux, petit Blanc de la cour de récré à qui les autres reconnaissent toutefois une qualité qui le différencie de ses cousins « métros » : je suis curieux. J’ai presque honte d’être présent ici sans avoir demandé l’autorisation, mais je suis fasciné par tous ces corps qui se provoquent et se caressent et s’embrassent. J’essaie de faire celui qui maîtrise les codes, l’habitué, je checke un premier type, me trompe de main, un second refuse de me saluer et me tire la langue, je baisse la tête et crois être repéré, je me dis que si les gens savent, ils vont me virer d’ici à coups de savate et m’écraser sur la route comme un corossol pourri. « Si les gens savent », mais quoi ? Car le sound system, c’est la fête à tout le monde. Un autre type me bouscule, m’insulte par-derrière, « Pousse-toi, moun ! », j’ai les oreilles qui chauffent, m’en tiens au conseil de mon instructeur de krav-maga, un militaire très maigre mais très fort : « Ne réponds que si tu es prêt à mourir. » Mon regard tombe vers la gauche et descend le long d’un dos à moitié nu, débardeur blanc ficelé au niveau des omoplates, que la sueur fait briller, jusqu’à rejoindre des fesses rondes qui remuent divinement dans un short en jean très court, tenue traditionnelle de cette soirée. Je ne peux m’empêcher de regarder vers la fente, l’océan séparé en deux par Moïse, au moins !, avec cet œil adolescent qui voudrait tout voir de près, mais n’observe que de loin, des gradins, que la moindre image paralyse de désir, toute cette densité de la chair qui se soulève me sature l’esprit. Soudain, la jeune fille se redresse et me souris, et moi, comme si c’était un doigt d’honneur, je baisse les yeux, attrape le premier verre venu au bar, engloutis le rhum qui me brûle la gorge et me fait tousser. Toute ma vie, je crois, j’oscillerai entre la tentation de relever la tête et de répondre à ce sourire, qui n’est rien d’autre qu’un sourire, et l’envie au contraire d’enfoncer ma tête jusqu’au fond de ma cage thoracique, coincée entre les tripes, par réflexe de tortue, par timidité, peut-être aussi parce que ma mère, un jour, a répondu à ce sourire et qu’elle s’est retrouvée dans la merde.
Contre un coin du mur, ivre et défoncé, je balaie l’espace et enregistre tous ces emboîtements stupéfiants de bassins, ces cuisses qui s’accrochent acrobatiquement à tous types de hanches.
On danse ici le back back.
Gestuelle obscène, obsédante.
On pourrait être mal à l’aise : quel genre d’image cette chorégraphie renvoie-t-elle de la femme ? Hypersexuelle, animale même, peut-être. Celle de la culture machiste, aussi, que je suis incapable de reconnaître à cette époque, rêvant d’être un homme fort et musculeux, faisant dans le jardin des pompes avec quatre chaises, un homme qui a confiance, et qui peut s’emparer du corps des femmes parce qu’il est désiré. Je sais aujourd’hui quel est le prix de cette espèce de virilité, fondamentalement agressive. Il y a deux ans, d’ailleurs, une bonne amie du lycée recroisée à Bordeaux m’a raconté la façon dont elle avait été agressée sexuellement par trois hommes dans l’un de ces sound systems, sous les ricanements et encouragements d’une poignée de témoins.
On interpelle en tout cas le regard, dans une sorte de compétition implicite entre tous, par des mouvements et des pas et des cambrures qui vont et viennent sans cesse entre la stricte imitation de l’acte sexuel et la pure communion d’une joie de vivre collective, carnaval réduit où tous les signes (à peu près) se renversent, où l’on se dépense. Le carnaval de Guyane est d’ailleurs l’un des plus longs du monde : plus d’un mois de fête. Je suis fasciné par la coulée effervescente des grands cortèges bariolés qui transpercent les rues, à l’assaut des routes et trottoirs, qui lancent vers le ciel leurs costumes de plumes vertes et jaunes, qui avancent et claquent des pieds au rythme du Kasékò, musique traditionnelle, battue par le tambour foulé.
Je finis par apercevoir Nicolas dans le fond, accompagné de Lara, pas vraiment prévue au programme. Lara est folle, amoureuse de Nicolas. Ça crève les yeux, et ça me crève le cœur, parce que j’aime beaucoup Lara. Elle est grande, elle est blonde, elle a les yeux bleus. C’est la plus belle femme que j’ai jamais vue de ma vie. Une beauté rare en Guyane, contre laquelle elle lutte au lycée, dans la rue, et même ce soir, on dirait. Lara pratique l’enlaidisse- ment, se maquille et se fringue à peu près pour les raisons inverses à celles de la plupart de ses amies. Elle porte des vêtements amples, gros joggings volés à son père ou à son grand frère, elle garde les cheveux attachés, parfois un peu gras, noircit vulgairement ses yeux, porte des baskets crades, et se cache le visage sous sa capuche. Sa beauté, on la croirait en cavale, et quand elle est reconnue, elle ne compte plus les regards collants, insistants, les mains baladeuses ou les sifflements dans la rue. À cause des garçons, mais pas que, la beauté est une malédiction pour certaines femmes, un sort trop lourd, qu’elles aimeraient conjurer. Lorsque Lara retire son espèce de déguisement, à la plage, ne portant plus que ce maillot de bain bleu, du même bleu que chez Air Caraïbes, ou dans les soirées plus safe des lycéens, chez Emma par exemple, sa plus ancienne amie, fille de gendarmes qui vit dans la caserne, elle impose le silence.
Ils font tous les deux d’étranges allers-retours entre le second bar et ce qui semble être un mur grillagé donnant sur une ruelle du bidonville. Ils ont l’air si concentrés que je les trouve immédiatement suspects. Je traverse la foule pour les rejoindre.
— Ça va Lara ? Qu’est-ce que vous foutez ?
Les deux ne bronchent pas, froncent les sourcils, contractent leurs mâchoires et envoient quelques regards furtifs à droite, à gauche.
— Chut, tu vas nous faire repérer. Suis-nous, me lance Lara avec un léger rictus.
J’ai oublié de le préciser, Lara est aussi la plus dingue de la bande, plus dingue encore que Nicolas. Alors, ensemble, ils sont capables de fracturer n’importe quelle cloison du réel, de violer n’importe quel commande- ment, au motif que ça les amuse. Deux incontrôlables et intranquilles qui me font toujours rire. Mettez-les dans un EHPAD, vous aurez une émeute. Au Vatican, une nouvelle guerre des religions. À Wall Street, le plus grand krach boursier de l’histoire du monde. Bien obligé, je les suis sans comprendre et avec un très mauvais pressentiment. Ils atteignent le mur et je les vois tous les deux extraire de leur pantalon deux grosses bouteilles de rhum, avant de les faire glisser discrètement sous le grillage. Ils se tapent dans la main – «Bien joué !» – et se marrent de plus belle. Je me retourne, pris par une bouffée d’angoisse à l’idée qu’on soit repérés, mais les gens dansent, ne se parlent pas trop et se regardent à peine. Cette fois, ils ont un bon motif pour nous foutre dehors et nous flinguer à coups de barre de fer. L’excitation me monte dans le cœur et les tripes.
— Victor ? Tu nous aides ? me demande Lara, à qui je ne refuse jamais rien.
— Vous êtes des fous ! Allez !
Trois petits Blancs arrivés par effraction dans ce monde d’adultes, et nous allons jouer à la petite souris. Allons braquer la fête.
Nous fonçons vers le bar, un gros gobelet rouge à la main, comme sur les campus américains, et nous multi- plions les allers-retours, depuis la table où les bouteilles sont rangées, sans surveillance, jusqu’au grillage. Un, deux, trois, quatre. C’est à celui qui rapportera d’un coup le plus de bouteilles possible. Tout y passe, vin, gin, sodas, même des paquets de chips trouvés à côté dans un carton. Lara esquive quelques mecs qui lui lancent des « Tu vas où comme ça, ma chérie ? », avec main sur l’épaule et dans le bas du dos. Elle danse un peu avec un type que je regarde jalousement, comme Nicolas, et nous continuons notre vol dans une parfaite surenchère amicale, une effusion de sourires que nous voulons aussi discrets que possible afin de ne pas être pris l’alcool dans la poche. Nous savons tous les trois que c’est déraisonnable : jamais nous ne transporterons autant de bouteilles. Mais l’adolescent n’obéit qu’à une seule règle : l’exigence de la vie qui lui bat dans la tête.
Je suis un être irradié, contaminé par l’exposition à la violence de Guyane. Je sais le goût du revolver enfoncé dans la bouche, qui vous tape contre les dents, qui vous écorche le palais, ce métal froid de la mort, âcre, rance, qui ne laisse aucun souffle, rien que la terreur de mourir et des larmes pour supplier.
J’ai vu un ami se prendre un coup de cutter dans le ventre parce qu’il ne voulait pas donner son portefeuille. J’ai rencontré le fils d’une professeure qui s’est fait trancher le bras parce qu’il roulait en scooter et que les bandits locaux aiment bien récupérer de force le scooter des gens.
J’ai connu sur le parvis du lycée les pluies de pétards qui tombent sur le visage et les grilles dans notre dos qui se referment, les « Y avait qu’à pas sortir » du surveillant, du CPE, nous laissant à la merci de ces types des Âmes Claires, la cité juste en face, tous en scooter et à vélo, qui s’amusent avec des « Ben Laden », pétards interdits en Europe mais achetés au Suriname – il suffit de traverser le fleuve en pirogue. Tout le monde en parle, du fléau de cet autre « boom boom ». Ce n’est pas un jeu, les murs de notre lycée sont recouverts des photographies de jeunes de notre âge, doigts ou oreilles arrachés, yeux percés, bouche ouverte en quatre morceaux, etc.
Je suis rentré en France avec un sentiment d’insécurité tenace, la peur qui naît au moindre bruit de scooter, comme s’il s’agissait d’un rugissement de dragon, annonciateur du crime, du danger, comme si c’était le cri d’une bête sauvage à craindre, ces mêmes bêtes sauvages que l’on trouve lorsqu’on soulève les branches de l’Amazonie.
On dit que chaque fête connaît son point de bascule, que l’on situe généralement après minuit, quand l’ivresse coule bien dans le sang, arrose les rivières intérieures jusqu’à inonder l’esprit. Les points de bascule m’intriguent, cette espèce de fracture de l’espace-temps qui vous fait soudain entrer ailleurs. Cette déchirure dans le continuum d’existence, irréversible, qui reconfigure les voies envisageables, vos possibles. L’expérience insensée, extraordinaire, miraculeuse en un sens, de l’irréversible.
Je n’ai le temps ni de voir ni de dire quoi que ce soit.
On s’agite dans mon dos, je recule, verre à la main, et sous mes yeux se forme une masse d’hommes, immédiate, opaque comme un caillot de sang. La musique continue, mais je lis sur les visages l’angoisse avec des traits tordus, comme sur les masques japonais. Je ne comprends pas. Une fille hurle sur ma droite, je la regarde, une autre tient ses mains devant sa bouche, stupéfaite et haletante.
— Mon Dieu, mon Dieu..., j’entends.
Je m’avance prudemment et, entre les bras et les jambes de ces gens rassemblés, certains juste penchés, d’autres debout, j’aperçois des pieds, tendus comme des piquets vers le ciel, et, un peu plus haut, le sang qui coule d’un ventre auquel ces membres tout droits se rattachent. Un ventre troué par une lame jetée par terre quelques instants plus tôt, sans que l’on sache vraiment par qui, et les choses s’accélèrent. Les visages se voilent, un drame étrange contamine l’espace où les yeux se percutent tous à la recherche d’éléments de réponse, la nouvelle se propage et la foule regarde entière dans la même direction. Je vois la colère qui peu à peu déforme cette masse, j’entends la répercussion des insultes, qui se répètent, se multiplient, s’amplifient et grossissent comme une énorme boule de boue, tandis que la musique continue encore, en mode automatique, assourdissante, tragique, asphyxiante, en total décalage. Il faut couper la musique, il faut que ça s’arrête, des gens crient dans le fond avec leur tenue de fête, certains s’en prennent au DJ, les deux bras en l’air, qui ne voit ni n’entend rien. Stop, stop, il y a un problème, je répète, il y a un problème. Un peu plus loin, devant moi, trois hommes se poussent, s’empoignent, et un type balance une énorme patate dans le visage d’un second gars qui s’effondre à terre, se relève et se jette sur les autres. Nouveaux hurlements. Je ne vois que cela, des problèmes, de partout, qui tombent en cascade, qui, au contact des uns et des autres, s’enroulent et s’amplifient. J’entends :
— ATTENTION !
Je n’ai pas le temps de réagir : un autre homme, sur ma droite, vient de sortir une arme à feu et se tient prêt à en découdre, ou alors à rétablir l’ordre, je ne sais pas trop. Nos regards se croisent par erreur, et je le sens aussi nerveux que moi, on croirait qu’il tient dans ses mains une bombe prête à nous sauter au visage. Il lève son bras, tend son arme droit devant, dans ma direction, et je ferme les yeux, il tire. BAM. Mais la balle part dans le ciel, finalement dans le ciel.
Quand je me sens en danger, je me fige, comme devant une voiture qui fonce, réflexe stupide, plus dangereux encore.
Nicolas m’arrache à cette scène en m’attrapant par le t-shirt, je me laisse faire, tracté de force, suivi par Lara qui me couvre le dos. Je n’arrive plus à respirer, je panique, je suffoque, on se regarde tous les trois, on ne peut plus rire, et l’on avance droit vers la sortie sans penser à nos bouteilles, en priant pour que personne ne les remarque, pour que personne ne fasse plus jamais attention à nous. Quelqu’un vient de couper la musique, et les percussions assourdissantes, les notes de synthé et les voix autotunées sont remplacées par des bruits de bouteilles que l’on casse, par des cris, des plaintes et des implorations, par le bruit des coups, des menaces, par des promesses de vengeance.
Des types, les videurs, nous interdisent de passer, mais comme ça se bat derrière nous, et qu’il y a sûrement déjà un mort, nous passons quand même, de force. On se barre le plus vite possible, propulsés comme la fusée Ariane vers l’avant, quitte à paraître suspects. On détale à toute vitesse dans les rues étroites et obscures de la Piste Tarzan, on s’enfonce toujours plus loin, on fuit avec le silence glacé de nos êtres en se jetant des regards furtifs pour vérifier que nous sommes toujours en vie, bien tous les trois, et d’autres détonations retentissent au loin derrière nous. Mes épaules se cabrent, mes membres se tendent et des oiseaux s’envolent, et le bruit des scooters et des motos et des voitures descend le long de la colline comme une rumeur. Une sirène de police, un fa appuyé, résonne quelque part, perce la nuit.
On court, sans rien se dire, avec l’impression d’être chassés par un poids lourd qui nous écrasera comme des insectes, en résistant à notre poitrine comprimée, à nos poumons qui s’enflamment en même temps que tirent nos cuisses. Les aventures ne sont pas faites pour moi, et je pense à mon père, qui n’a peur de rien, lui, et j’aime- rais bien avoir son courage, ou son inconscience, cette confiance-là, cette sérénité lucide, qui est d’abord affaire de rapport entre soi et soi, et qui fait qu’en toute situation, face au moindre danger, on est prêt à mourir. Je sais que mon père pourrait mourir pour nous protéger, moi, je ne suis prêt à mourir pour personne, je crois.
Lara ralentit la course en premier, très vite suivie de Nicolas et moi.
On reste là, à former une espèce de triangle ou de cercle, sur l’asphalte chauffé par une nuit à 42o C, essoufflés, sous le choc, sidérés. Autour de nous, de rares habitations, avec sur chacune une petite parabole, sorte de champignon métallique, vaguement rouillé. Et puis un chien, type berger allemand, allongé au bord de la route, la gueule levée distraitement et les yeux qui luisent. Nous avons dû l’arracher à son sommeil. Aucun lampadaire pour éclairer la zone, juste un tapis de nuances de nuit, depuis le noir total jusqu’au bleu foncé. Il y a tous ces arbres, formes obscures que le vent bat comme des drapeaux, sous le chant de quelques grillons et de voix étouffées qui glissent comme la brume sur les feuilles de la colline.
Quelques jours plus tard, Bryan nous racontera que le type s’en est tiré malgré les huit coups de couteau dans le ventre. Il aurait dû faire attention à son mauvais regard.
Je devrais rentrer chez moi, mais je ne me sens pas si mal avec eux, le corps suant. Quelque chose d’étrange, dans cette paix après la mort, nous attrape tous les trois. Sans trop savoir pourquoi, nous nous mettons à rire en nous serrant dans les bras, tandis que le chien se rendort.
— On est perdus, non ? demandé-je.
— On devrait faire demi-tour, y a qu’à suivre les lampadaires, propose Nicolas en pointant du doigt ce qui ressemble, au loin, à la route principale.
— Très bonne idée, souffle Lara.
— Allons-y.
Je m’apprête à repartir, l’esprit plus détendu, quand
Nicolas s’écrie :
— NON ! Attendez !
— Quoi ?
— Regardez là-bas.
— Je ne vois rien, tu vois quelque chose, Lara ?
— Hum... Non... Oh putain ! On est à la base !
— À la base ?
— Oui !!! me répondent d’une même voix Nicolas et
Lara, préparant déjà leur nouveau plan.
La base, c’est le nom qu’ils ont donné à cette portion de
caserne militaire, résidentielle, censée les héberger, eux et leurs familles. Le lieu est en travaux, parce que l’humidité ici bouffe tout, même les murs. Mais il y a toujours cette grande piscine, remplie, avec un plongeoir haut d’au moins cinq mètres, qui sert à l’entraînement, et puis des chambres, nues, avec un trou à la place des fenêtres, dans lesquelles on peut squatter pour prendre un verre, danser et taguer. Faire tout ce qui nous semble bon de faire. L’ennui, c’est qu’il faut entrer ici par effraction, et qu’une grosse tête de mort prévient que le lieu est gardé, l’armée ne plaisantera pas avec ceux qui plaisantent.
— Mauvaise idée, finis-je par dire.
— Arrête ! On ne va pas se quitter comme ça, souffle Nicolas.
— Euh, je crois que ça me suffit pour ce soir, pas besoin de me prendre, en plus, une balle dans la tête.
— Et toi, Lara ?
— Comment on entre ?
— Rien de plus simple : si on remonte le chemin, y a
un mur facile à escalader. Faut juste pas faire de bruit au début, car le premier bloc est encore habité. Après, c’est tranquille !
— On n’a même pas d’alcool !
— J’ai gardé une bouteille de rhum, corrige Lara, la sortant de la poche kangourou de son sweat.
Je n’en peux plus des plans soi-disant tranquilles et simples de Nicolas, qui à chaque fois dégénèrent, mais puisque tous les deux me sourient comme de fiers idiots, puisqu’ils ont déjà choisi, puisqu’ils ont en plus de quoi boire, et que je ne peux pas me défiler, je réponds :
— OK. Allons-y.
Nous poussons la nuit dans cette base, profitant de l’atmosphère clandestine pour nous prendre pour les héros d’un film d’action et d’aventures, évitant les rondes des gardiens, savourant le bon rhum volé au sound system dans une chambre avec vue sur le grand bassin, puis plongeant dans la piscine aux alentours de 3 heures, discrètement d’abord, puis de plus en plus bruyamment. Nus, sautant dans l’eau du plongeoir avec des chaises en plastique qui se brisent, et tout objet trouvé aux alentours – ne me demandez pas pourquoi –, nous jetant chaque fois au visage un nouveau défi, incapables de nous arrêter, de mettre fin à la fête. Incapables, surtout, de nous déclarer notre amour, trop prudents pour le faire dans l’eau chlorée et tiède, translucide, conscients qu’un mot de trop, à cet âge, plus que tout ce que nous avons vécu, plus que tout ce dans quoi nous nous apprêtons à plonger, pourrait nous être fatal.
Février 2023
Je suis retourné à Cayenne au mois de février 2023, pour assister à la fin du carnaval. Là-bas, j’ai retrouvé Bryan, qui n’a pas changé d’un iota, avec son check à l’ancienne et son sourire des Caraïbes – bleu paradis, lui aussi.
Il est aujourd’hui vendeur de voitures du côté de Kourou.
C’est de Kourou que les fusées partent. Les ingénieurs qui travaillent au Centre spatial guyanais (CSG) pour l’Agence spatiale européenne (ESA) y vivent barricadés, avec un pouvoir d’achat très largement supérieur à la moyenne locale.
Ce sont eux qui achètent les Mercedes intérieur cuir de Bryan.
Depuis la guerre en Ukraine, après vingt-sept lancements, les fusées Soyouz ne décollent plus de Guyane. La base, à quelques kilomètres de Sinnamary, copie quasi conforme du pas de tir de Baïkonour, d’où partent actuellement les fusées russes, est à l’abandon, et les singes hurleurs et les jaguars et les boas doivent se demander, lorsqu’ils la visitent, à quoi ont bien pu servir ces rampes étranges, immenses, ce béton ravageur, dévoreur, qui a coulé sur les arbres, noirci par les successifs crachats de feu, comme une sale malédiction.
Là, dans un bar de la place des Palmistes, alors que les rues se remplissent de couleurs, que défilent hommes, femmes et enfants dans une atmosphère de fête survoltée, Bryan m’annonce que Lara, dont je n’ai pas eu de nouvelles depuis huit ans, a été retrouvée morte chez elle. Elle se serait suicidée.
Je me souviens alors qu’un jour, presque au même endroit, peu avant mon départ, elle m’a dit :
— Je resterai toute ma vie en Guyane.
— T’es pas cap ! lui ai-je alors répondu.
Est-il possible que Lara ne soit restée ici que par défi,
par promesse de lycéenne ? J’en doute.
Peut-être à cause du soleil, de l’alcool, de la musique très forte dans les rues, j’ai soudain la tête qui tourne. Une intense nausée m’envahit et des flashs de lumière me trouent les yeux. Je ferme les paupières, déglutis, et vois dans ma tête tourner en spirale le visage de Lara, au bord de la piscine, avec son grand sourire, sa volonté tenace de pousser les limites, de vivre, surtout. Un être de feu auquel j’aurais dû écrire mille fois, à qui j’ai mille fois imaginé écrire, mais dont la séparation géographique, brutale, a justifié une sorte d’endormissement des relations, d’amitié ou d’amour.
Le silence me brûle et me donne envie de vomir.
Je n’arrive pas à retenir mes larmes et Bryan, pudique- ment, détourne le regard vers les longs et larges palmiers de la place.
Juste devant nous, un cortège de Touloulous surgit, groupe de femmes à robes colorées, jaune, vert, orange, rouge, d’ancienne époque, avec jupons, longs gants, masques et perruques. Elles font partie du patrimoine local, et peut-être bientôt mondial. Des esprits de la fête et de l’identité guyanaise. L’une d’elles me fait signe de la rejoindre avec sa main couverte de coton blanc.
— Tu devrais aller danser, finit par dire Bryan. Danser – avancer.
Il n’existe pas, je crois, de meilleur moyen pour faire
son deuil. Les remords, c’est la bonne conscience que le lâche se donne pour ne pas se sentir coupable deux fois. Sortant du bar, j’entre dans la rue en plein soleil, suant, au milieu des voitures, des Touloulous, et du cortège qui plonge vers nous. Les gens dansent, rayonnent, ils ont les yeux fermés, déployés au fond d’eux-mêmes, certains me poussent, d’autres me frôlent, d’autres encore me prennent par la main et m’invitent à les rejoindre. Il faut danser, danser... Je finis par taper du pied, pris au jeu, et
m’introduis dans le cortège.
On est mordu à vie par la Guyane. À vie.