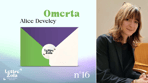Volets ouverts, Kalindi Ramphul
Lettre Zola n°21, novembre 2025 À dix-sept ans, dans le wagon-bar d’un train, Kalindi rencontre un homme plus vieux qui l’emmène fumer une cigarette dans les toilettes. Naît une longue histoire d’amour qu’elle qualifie de « banale ». Pourtant, celle-ci ne l’est pas...


Prologue
Dans sa chambre d’enfant, Ariane, huit ans, fabrique la nuit. Au-dessus de son lit, dans le toit mansardé du nouvel appartement, un velux doté d’un store en toile foncée confère à son seul index le formidable pouvoir de faire cesser le jour. Ariane lève et baisse le store mille fois pour voir briller au plafond ses étoiles phosphorescentes.
À dix ans, Ariane craint l’obscurité, mais elle l’attend aussi, car c’est en son creux qu’il est permis aux insomniaques de rêver ou de lire. Sous sa voie lactée faite de plastique bon marché, elle se renseigne sur l’amour, même si les romans disent qu’il arrive bien plus tard, et parfois trop tard, juste avant qu’on meure, de vieillesse ou d’ennui. Ariane espère qu’elle sera, au contraire, vite amoureuse et que ça fera aussi mal que dans les livres qu’elle pique dans la bibliothèque de sa mère. Qu’elle finira meurtrie, saignée, laide d’avoir consacré toute sa vie à aimer.
Ariane aime fabriquer la nuit pour attirer les papillons dans le mirage des lumières électriques. C’est joli de les voir s’abîmer les ailes en confondant bêtement néons et soleil. Depuis qu’elle est petite, Ariane se réveille souvent en sueur vers 3 heures du matin, en proie à des terreurs nocturnes. À son plafond grouillent des têtes difformes, les joues déchiquetées, les paupières trouées, les dents rabotées au ras des gencives, les yeux sans pupilles, globes cireux qui font miroiter la mort. Ariane apprend d’ailleurs à l’école que « mourir » ne prend qu’un « r ». « C’est parce qu’on ne meurt qu’une seule fois », lui explique sa maîtresse. Merde, on n’a donc droit qu’à un tour ?
Forte de cette nouvelle information, Ariane réfléchit à deux fois avant de baisser le store du velux parce qu’elle a l’intuition que c’est dans le noir que le pire peut arriver, quand on n’est préparé à rien d’autre qu’à l’abandon et qu’on risque d’y laisser sa peau, la peau à laquelle on n’a droit qu’u n e s e u l e f o i s.
1
Si vous demandiez à mes amis : « Quel est l’adjectif qui décrit le mieux Kalindi ? », il est certain que la majorité répondrait : « Marrante ». Personnellement, j’aurais choisi « géniale » ou « sublime », mais que voulez-vous, on ne peut décemment pas choisir sa propre légende.
« Marrante ». Un drôle de mot pour une ancienne enfant sinistre. La première fois que quelqu’un l’a utilisé pour me désigner, j’avais six ans, j’étais en CP, et je venais de jouer la pièce Delphine et Marinette devant un parterre de parents bouffis de fierté d’avoir poussé leurs enfants à prendre théâtre en activité extrascolaire. Moi, je n’incarnais aucune des deux héroïnes à ce point cool que leurs prénoms avaient atterri dans le titre, mais un sombre sidekick, sans doute le plus lamentable et le moins charismatique qui soit : le poulet. Un vulgaire rôle de basse-cour qu’on m’avait refourgué parce que je m’étais révélée d’une nullité accablante en impro. Ma prof avait donc rendu son verdict : j’avais à peine l’étoffe d’une vieille volaille.
La mort dans l’âme, j’avais demandé à ma mère si je pouvais arrêter les cours de théâtre. Elle m’avait répondu : « Quand on commence quelque chose, on le termine », alors j’avais suivi les mêmes conseils qu’elle me prodiguait quand j’avais la gastro et qu’il fallait me faire avaler du Smecta : j’avais fermé les yeux et pensé à l’Angleterre. Ma mère, qui tenait le théâtre pour une activité d’une importance capitale, s’était mis en tête de m’offrir un costume à la hauteur de mon rôle. Un costume nul, donc. Ainsi, le jour du spectacle de fin d’année, moment où j’éprouvais autant l’envie de monter sur scène que de faire le tour de Guantánamo à cloche-pied, elle s’était retirée dans la cuisine et en était revenue munie d’un bonnet de bain vert foncé, sur lequel elle avait agrafé un gant de vais- selle Mapa. C’était bien sûr censé représenter la crête du poulet. Affublée de mon magnifique déguisement maison et de ma non moins superbe honte, j’avais incarné sur scène une volaille de caractère, retranchée dans sa fierté, au point de délivrer mon (rare) texte d’une manière iné- dite et époustouflante. C’était là qu’une chose dingue s’était produite : la salle s’était esclaffée. Non par politesse mais par hilarité joyeuse et sincère. La mère de Sophie, la gamine qui avait un cheveu sur la langue et que tout le monde appelait donc « Fofie Favier », avait accouru vers mes parents et leur avait lancé : « Cette gamine est douée, il faut qu’elle devienne actrice ! » Ma mère, gonflée de vanité, avait acquiescé gravement. Il convenait manifeste- ment de prendre avec le plus grand sérieux tous les com- pliments relatifs au talent supposé de sa fille.
Voilà donc comment mon destin a été scellé par la mère de Fofie Favier. Voilà aussi comment, galvanisée par la sensation d’avoir été drôle au moins une fois dans ma vie, j’ai décidé de tout miser là-dessus pour le restant de mes jours. Pourtant, Dieu sait qu’avant l’épisode « poulet digne sous gant Mapa », j’avais été une enfant taciturne, qui n’aimait jouer ni seule, ni avec les siens. Et pour ce menu défaut qu’est ma mélancolie, je tiens à blâmer mes parents. Déjà parce que ma psy m’a bien expliqué que tout était leur faute (ça et le reste), ensuite parce que je n’ai aucune autre cible en tête et que je tiens absolument à décliner toute responsabilité pour mes sales traits de caractère.
Il paraît donc que je suis marrante. Depuis une dizaine d’années, on me paie pour l’être, d’ailleurs. Il faut que je le sois dans mes articles, dans mes romans, dans mes podcasts, au cours des dîners où l’on m’invite et au sein même de mon couple, rire et faire rire constituant 88 % de mes activités conjugales. Si vous me rencontriez aujourd’hui, vous vous diriez : « Elle est marrante, cette fille, elle est bien dans sa peau. » Et je rirais. Je ne le montrerais pas, mais je rirais. Intérieurement. Dans le secret de mon âme, je rirais.
Dans l’école de petits blancs-becs où j’ai passé ma scolarité, à Levallois-Perret, avec ma gueule sortie de nulle part, ou plutôt d’on ne sait où, qui racontait que je n’étais ni noire, ni blanche, mais une couleur entre les deux, avec mon pif de marsouin et mon nom à coucher dehors (comme me l’a dit un prof au collège), j’ai appris à défier ma timidité naturelle, à décapiter le bébé pleurnicheur des cours d’impro et à faire marrer les autres, comme lorsque j’étais sur scène. C’est comme ça que j’ai réussi mon infiltration chez les petits bourges, passant souvent pour plus grande gueule, plus cultivée (ma mère m’avait appris à lire et à écrire avant le primaire, me condamnant à une existence presque uniquement faite de lettres et de mots) et plus drôle, surtout, que mes camarades. J’ai appris à me mettre dans la peau d’une autre, dans la peau d’une fille costaude, qui invective et fait marrer.
Pourtant, si d’aventure quelqu’un me soufflait les bons mots, le masque tomberait, et je redeviendrais alors une gamine avec un gant Mapa sur la tête. Il en faudrait pas mal quand même, juste assez mais pas tant, pour dissiper des années d’illusion, un travail méticuleux de faux- semblants. Il en faudrait, oui, pour épousseter, nettoyer, faire luire et exposer les vicissitudes enfouies au plus profond de mes organes encrassés par les clopes et le côtes-du-rhône. Sans ça, je continuerais à faire croire que je ne suis qu’une fille « marrante », avec tout ce que ça implique de légèreté, de sourires et de bonnes blagues.
D’ailleurs, je préférerais ne jamais entrer dans la partie sérieuse de ce texte. Je voudrais retarder au maximum l’échéance. J’aimerais bien vous raconter la blague du mec qui a une banane dans l’oreille, par exemple. C’est l’histoire d’un mec qui a une banane dans l’oreille...
2
Mais il est temps d’en venir au fait. Ce que je souhaite raconter ici, c’est le moment où j’ai cessé d’être une fille marrante. C’est arrivé une seule fois. Seulement, ça a duré des années.
L’histoire est toute bête, terriblement banale. À dix- sept ans, en 2009, durant l’été le plus caniculaire de la décennie d’après Sébastien Folin, j’ai rencontré le mauvais mec. J’aimerais dire que je suis « tombée dessus », que c’était le fruit du hasard. Mais je crois surtout que tout ce que j’avais lu dans ma vie, tous les romans, toutes les pièces de théâtre, tous les films que j’avais vus, aussi, avaient modelé mes attentes pour me faire désirer pro- fondément, intrinsèquement une relation tempétueuse. Avant, on disait « passionnelle ». Aujourd’hui, on dirait « toxique ». D’après moi, c’était tout simplement une relation de merde.
Cette relation, que j’ai entretenue de mon plein gré avec un homme de onze ans mon aîné, j’ai essayé de l’écrire à plusieurs reprises. J’ai rédigé trois versions antérieures à celle-ci où je racontais ma première « histoire d’amour » à la troisième personne du singulier, en choisissant de me cacher derrière un personnage : Ariane.
Ainsi que vous avez pu le lire dans le prologue, je parlais donc d’Ariane comme si elle n’était qu’une héroïne de fic- tion. Alors qu’elle était moi. Ou plutôt que j’étais elle. Et si je trouve un certain charme littéraire à l’utilisation de la troisième personne du singulier et au prénom « Ariane », mythologiquement chargé d’une destinée tragique, écrire cette histoire comme si elle n’était pas la mienne me semblait être une erreur. J’en avais l’intuition. Intuition qui s’est confirmée : en terminant mon texte, au début de l’été, je n’en étais pas satisfaite.
En relisant les premières moutures, j’ai finalement compris ce qui n’allait pas. Je voulais tout raconter. Je voulais être exhaustive. Je voulais détailler de A à Z mon histoire avec cet homme pour me délester de son poids et pour que d’autres femmes puissent reconnaître les mécanismes de l’emprise, de la violence morale, physique et sexuelle. Je voulais dresser la liste de toutes les misères qu’on m’avait faites car n’en décrire qu’une partie me semblait équivaloir à trahir ma propre mémoire.
Or, hier soir, j’ai lu le dernier livre de Nathacha Appanah, La Nuit au cœur. Et l’évidence m’a sauté aux yeux : il ne sert à rien d’être exhaustif. Personne ne veut ni ne peut remporter le premier prix de l’horreur conjugale. On n’est pas là pour comparer ses misères à celles des autres. J’ai appris plusieurs choses en lisant ce texte, notamment que j’avais vécu une expérience très similaire à celle de l’écrivaine. Trait pour trait, les mêmes mécanismes. Ce genre d’histoires, bien que toutes soient différentes, présentent souvent des ressemblances car les prédateurs ont les mêmes tares et agissent selon un modus operandi bien précis.
Oui, tant de choses m’ont marquée à la lecture du récit de Nathacha Appanah, à commencer par la narration, si intime et personnelle, de l’autrice. J’ai finalement com- pris que je devais d’une part écrire à la première per- sonne du singulier et d’autre part renoncer à raconter tout ce que j’avais vécu pour me concentrer sur quelque chose d’infiniment plus important que l’exhaustivité : les conséquences d’une telle histoire sur mon comportement actuel, mes haines placées au mauvais endroit et mes souvenirs tronqués, surtout.
Voilà ce que je vais raconter. Pas entièrement. Juste des fragments. Des éclats sinistres qui s’articulent autour de trois étés. Trois étés fondamentaux. Trois étés qui ont transformé une fille marrante en une femme plurielle. Il me faut donc réviser mon aversion pour tout ce qui est procédurier et commencer, comme le veut la tradition, par le début.
3
Premier été : 2009. Le mois d’août est là et il est impi- toyable. Dans les rues, aux terrasses des cafés, dans les appartements sans clim, tout le monde rôtit. Moi, j’ai dix- sept ans, je pars une semaine chez ma copine Heloïse, en Bretagne. Dans le train, au wagon-bar, je fais la connais- sance d’un quasi-trentenaire dégingandé qui me drague en usant de mots provocants. Je suis vierge, je n’ai même jamais embrassé un garçon. Et, bien sûr, je ne désire que ça. L’inconnu porte un chapeau gris à fines rayures blanches. Je lui dis que son couvre-chef me fait penser à un objet, mais je ne trouve pas lequel. Plus tard, dans mon premier roman, j’écrirai que ce chapeau ressemblait à une cheminée. Cet homme s’appelle Jordan. Il est arrogant, s’adresse aux voyageurs comme s’il les connaissait tous, me parle politique. Je n’y connais rien, évidemment. Je perçois, en quelques minutes seulement, comme on le sait toujours au fond, que ce type va précipiter mon existence paisible dans un endroit inédit et inconnu, et que ça fera du mal à tout le monde. Jordan me propose de fumer une cigarette dans les toilettes. J’accepte, en tremblant à l’idée de cumuler les interdits : la cigarette, l’homme plus vieux, les toilettes, la bière dans l’estomac. Je me sens comme la fois où j’avais volé un CD d’Avril Lavigne à la Fnac. Ça m’avait tellement excitée que, comme les enfants, j’avais fait quelques gouttes dans ma culotte.
La tête pleine de bouquins et de films qui romantisent la passion amoureuse, je fonce tête baissée dans ce que je crois être la plus grande aventure de ma vie. Avec Jordan, je perds ma virginité brusquement et brutalement, dans un hôtel dont on s’enfuit sans avoir payé. Très vite, notre relation devient sérieuse, alors je le présente à ma famille. Ma mère le considère rapidement comme un fils. Mon père le hait, mais il hait les trois quarts de l’humanité, alors, bon, pourquoi en prendre ombrage ?
Jordan est artiste et vit à Berlin, dans un atelier où il compose de la musique électronique. Je m’installe quant à moi à Munich pour un échange linguistique de quelques mois. Étonnamment, Jordan est tout le temps chez moi. Dès que je veux passer un week-end à Berlin, dans son appartement, il se dérobe, trouve des excuses. Quand mon argent disparaît mystérieusement de ma chambre d’étudiante, il m’accompagne pour porter plainte. Au bout de six mois de relation, j’apprends que Jordan n’est pas artiste mais sans emploi. Que l’argent qui s’évapore régulièrement de mon sac à main n’a pas été piqué par mon con de coloc mais bien par lui. Jordan vit en fait en Auvergne, chez sa mère malade. Il n’a jamais eu d’atelier à Berlin. Il n’a jamais été musicien. Il n’a même pas de carte d’identité ni de passeport.
Évidemment, parce que j’ai dix-sept ans, j’excuse ce gros et long mensonge. Je le comprends, même. Pauvre Jordan, obligé de mentir pour cacher sa vie de merde, avec sa mère folle et rongée par la maladie, dans sa maison qui sent la pisse de chat et la colère. J’excuse bien d’autres choses d’ailleurs : la mythomanie permanente, les crises de jalousie ridicules, la paranoïa, les menaces, les cris, les crachats, les pratiques sexuelles étranges et extrêmes, les regards fous dans lesquels la haine a, au fil des mois, remplacé l’amour. Impossible pour moi d’aller au cinéma sans être suspectée d’avoir couché avec un pote de l’école, un prof, un inconnu, n’importe qui. Et sans subir un long interrogatoire pour avouer des choses que je n’ai pas faites. Pourtant, Jordan rêve de me voir au lit avec Étienne, son seul ami. Sous ses yeux. Le jour où, me sentant forcée, j’accepte et passe la nuit dans les bras d’Étienne devant Jordan, ce dernier voit rouge, tape dans une fenêtre, la brise en mille morceaux, piétine les éclats de verre, finit à l’hosto. Le verdict tombe, sans appel : je ne suis qu’une pute. Les insultes ne suffisent pas à me faire partir. Au contraire, elles me verrouillent.
En revanche, la première fois que Jordan m’étrangle parce que j’ai frôlé le bras d’un copain à table – j’apprendrai dans le livre de Nathacha Appanah que, dans 60 % des cas de meurtres conjugaux, les victimes ont été, à un moment, étranglées –, puis me jette sur le lit, me maintient les mains et me force, je me jure de le quitter. Et puis, le lendemain, il me couvre de cadeaux volés çà et là, présente ses excuses de mille manières, alors je pardonne et la ritournelle dure ainsi pendant des années.
Jordan n’a pas de travail. Dès qu’il trouve un petit boulot, il se fait virer, notamment pour propos antisémites. Il passe son temps dans l’appartement que loue ma mère, à vivoter dans l’obscurité, volets presque clos. Il fabrique, dans cette nuit diurne, un site complotiste qui lui rapporte de maigres revenus. Lui et moi, on s’engueule violemment, et très souvent on en vient aux mains. Un jour, il lance du haut de son mètre quatre-vingt-douze un ordinateur que je lui ai acheté en travaillant chez Quick. Pour me venger, je casse des objets au hasard. Il jette alors mon argent dans les toilettes, coupe en deux ma carte d’identité avec des ciseaux. On détruit tout dans l’appartement de ma mère. Un comportement digne d’adolescents. Pourtant, Jordan est un adulte. Pourtant, Jordan est brillant, c’est même ça qui m’a attirée, au départ. Il n’a jamais fait d’études, il écrit mal, mais il est foutrement brillant. D’après ma mère, c’est son intelligence qui est à blâmer pour ses dérives. Pas le fait qu’il soit frustré, malheureux, en colère. Pas le fait qu’il soit malade, en fait. Ma mère lui offre même le livre Trop intelligent pour être heureux ?. Parfois, tout est au beau fixe entre nous. En dépit des problèmes d’argent, de papiers, de jalousie. Dans ces moments-là, on sort boire des bières avec les quelques amies qu’il me reste. Des 1664 Blanc, je me souviens. On fume des cigarettes au parc et on discute longuement, de manière profonde et épiphanique, et il finit par dire de mes copines qu’elles sont connes ou grosses ou laides ou folles. Au fond de moi, toujours la même certitude : je suis avec le mauvais type. Pourtant, l’illusion du sentiment amoureux ne me quitte jamais. Je me mets à perdre du poids, à fumer et à boire énormément, à faire des malaises dans la rue. Je finis à l’hôpital, un jour où ma mère est en déplacement à l’autre bout du monde. C’est le père d’Heloïse qui vient me chercher. Il faut me donner des anxiolytiques et des antidépresseurs. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais je ne vais pas bien. Ma mère voit tout depuis le début. Ou plutôt, elle voit ce qu’elle veut voir. Elle sait que, parfois, ça va trop loin. Elle sait qu’on se hurle dessus, qu’on se menace. Elle ne nous a jamais vus en venir aux mains, en revanche. Quand les disputes sont orales, elle congédie son gendre. Et puis elle pardonne, comme moi. Par pitié, par emprise. Il est pos- sible d’être plusieurs à vivre sous le joug d’un pervers. Cela, ma mère ne l’admettra jamais.
Je pars m’installer à New York quelques mois. Là-bas, rien ne se calme : c’est pire que tout. Jordan me menace, cesse de me parler pendant des jours, me dit qu’il a trouvé un travail qui l’empêche de me donner des nouvelles. C’est comme ça qu’il agit pour me rendre folle : il est écrasant, omniprésent, contrôlant, puis il disparaît, et le cercle vicieux se remet en place. Ma mère le suit jusqu’à son prétendu travail. Elle enquête : il va en réalité chez Étienne chaque jour. Il n’a trouvé aucun emploi. Je me rends malade, je n’ai plus aucun pouvoir sur ma vie. Je suis dépossédée de tout libre arbitre. Je ne suis plus que sa chose, alerte, prête à me sacrifier sur l’autel de sa concupiscence ou de sa détresse. Je mens à tout le monde pour cacher ma situation, pour sauver la face devant mes amis. Mon seul refuge, c’est Radiohead. C’est con, mais c’est vrai. C’est Thom Yorke qui me sauve la vie, une nuit où je suis à Times Square, traversée par des idées noires. Idées noires que je pourrais, à cet instant-là, mettre à exécution. J’écoute Reckoner, et je me dis que je vaux la peine de sur- vivre à cette histoire. Qu’un jour, je serai de nouveau une fille marrante. C’est l’histoire d’un mec qui a une banane dans l’oreille...
Je quitte New York car Jordan me mène une vie d’enfer (au téléphone, par Skype, SMS, mail) depuis que j’y suis, avec sa jalousie maladive dont il se sert pour me menacer de tout et surtout de mort. Enfin, c’est plus insidieux que ça. Il ne me menace pas, il me souhaite la mort. Il la souhaite à mon grand-père aussi. À mes proches. C’est ce qu’il m’écrit dans un mail. Quand je rentre, il ne se passe rien pendant des mois, sinon l’impression du bonheur, d’une parenthèse où il est formidable, moi aussi, nous ensemble et, d’un coup, c’est la rechute : les hurlements, les menaces, les mains autour du cou, les violences sexuelles. Ma mère me supplie de tout arrêter. Souvent, elle le fait mal. « Retournes-y, alors, je viendrai te voir à l’hôpital quand il t’aura cassé la gueule. » Et puis ça passe. Ma mère pardonne. J’oublie. Et puis ça revient. Et puis ça passe. Ma mère pardonne. J’oublie. Ou l’inverse. Jusqu’à ce qu’un énième débordement agisse comme un déclencheur. Je vois clair désormais. Je fous Jordan à la porte de chez moi. C’est fini. En tout cas, pour la partie émergée de l’iceberg.
4
Voilà pour le rapide tableau. Cette histoire n’est pas une grande fresque peinte dans son entièreté. Elle n’est composée que de petits coups de pinceau, à droite ou à gauche de la toile. Des petits morceaux de trucs indépendants les uns des autres, qui constituent le squelette d’un fantôme évaporé, loin, mais toujours derrière moi. Et entre ces petits morceaux de souvenirs : des vides étranges.
Pour rédiger les premières moutures de ce texte, je suis retournée lire des échanges vieux de plus d’une décennie avec Jordan, et j’ai eu un choc : j’avais oublié des pans entiers de ces années-là, comme si elles avaient été vécues par une autre jeune femme. J’avais donc mentalement effacé ou réécrit certains détails de mon histoire afin d’en atténuer la gravité. Je m’étais arrangée avec la vérité, comme on le fait tous. Ce que j’avais jusque-là écrit dans Ariane fabrique la nuit se nourrissait essentiellement de bribes de souvenirs, mais peut-on se fier à eux ? Il paraît que l’on se souvient rarement d’une action, par exemple, avec précision et véracité. On se rappelle plutôt la dernière fois que l’on a raconté cette action, avec ce que ça implique d’émotions nouvelles et d’inventions. Le souvenir parfait, absolu, n’existerait donc pas. La preuve en est que, en com- mençant à écrire la première version de ce texte, j’étais persuadée que le fait de mettre Jordan à la porte avait été un geste émancipateur sur lequel je n’étais jamais revenue. Je l’avais foutu dehors pour de bon. J’avais été la femme indestructible que je m’imagine être aujourd’hui. Il n’en a pas été ainsi, d’après les textes retrouvés sur mon disque dur. En vérité, Jordan et moi nous sommes écrit de nom- breuses fois après notre rupture. Souvent à mon initiative. Il m’a notamment raconté qu’il était en train de mourir d’un cancer et toute une palanquée d’autres mensonges, certains dérisoires, d’autres extrêmement graves.
Il est même revenu vivre chez nous, quelques mois après son départ. Nous ne nous étions pas remis ensemble, mais ma mère et moi avions appris, je ne me souviens plus comment, que Jordan vivait dans la rue, alors nous l’avions hébergé. Il n’y avait plus d’hommes chez nous. Mon père était parti, mon grand-père, avec qui nous habitions depuis des années, était mort. Jordan était resté quelques jours sur le canapé du salon, avant d’essayer de voler une grosse somme d’argent à ma mère. Elle l’avait alors viré de chez elle pour de bon. Il avait fallu qu’il la vole pour qu’elle le congédie enfin. Il faut croire que c’était une faute supérieure à celle d’avoir abusé physiquement et psycho- logiquement de sa fille pendant des années. Oui, j’ai donc longtemps continué à écrire à Jordan. Des mots de haine et des mots d’amour aussi, parfois suppliants, avant de reléguer cette histoire dans la cave des souvenirs imprécis.
Parmi toutes les choses que j’avais oubliées, il y a aussi les autres femmes de la vie de Jordan. J’avais pourtant été en contact avec sa compagne suivante, qu’il avait littérale- ment martyrisée. Nous nous étions skypées un jour, elle et moi, et elle m’avait raconté qu’il l’avait violentée, un soir, et qu’elle l’avait quitté. Il s’était ensuite introduit dans le restaurant où elle officiait à la cuisine et avait éjaculé dans ses préparations, laissant des œillets de sperme partout dans la nourriture. J’avais aussi oublié les mails échangés avec sa précédente compagne, dont le témoignage était tout à fait similaire au mien. Il y avait là un pattern, un modus operandi, des gestes caractérisés. Et tout cela avait fini, tout de même, par prendre une tournure judiciaire. La femme d’avant avait porté plainte pour coups et blessures. Enfin, je crois. Ma mère avait porté plainte pour vols. Enfin, je crois. En tout cas, un matin, la police était venue toquer à notre porte. Elle voulait savoir si nous avions eu des nouvelles de Jordan. Il était recherché. Ça aussi, je l’avais plus ou moins oublié.
Tout comme j’avais refoulé, dans l’hyperespace de mon cerveau, que j’avais moi-même été violente avec Jordan. Oui, très régulièrement, alors qu’il se contentait de me maltraiter mentalement, c’était moi qui perdais les pédales
la première, lui collant des gifles, le griffant, cassant les rares objets qu’il possédait. Très souvent, j’ai tapé dans les murs, l’ai menacé avec une ribambelle d’objets, l’ai poussé, frappé de mes poings, lui ai tiré les cheveux. Dans ces moments-là, il demeurait stoïque, me démontrant par son calme feint que c’était moi, la folle. Cette violence ne m’a jamais quittée. Elle est toujours en moi. Il m’arrive de vouloir provoquer des disputes avec des inconnus, dans la rue par exemple, dans l’espoir d’en venir aux mains. De me défouler. Cette violence que Jordan m’a insufflée n’a jamais disparu. J’ai longtemps nié ces gestes auprès de mon tribunal personnel, mais plus j’écris, plus je sens que je dois faire face à ces comportements qui ont été les miens. Même s’ils m’ont été enseignés par quelqu’un d’autre.
5
Il y a les choses que j’ai oubliées et il y a celles que j’aurais aimé oublier. Certaines conséquences étonnantes de ces années-là. Notamment ma colère, j’en parlais plus haut, et ma haine aussi. Mais pas n’importe laquelle. Ma haine dirigée contre les autres femmes.
Il y a huit ans, alors que la vague du mouvement #MeToo déferlait, j’ai éprouvé une misogynie brutale. J’ai honte de l’admettre, et encore plus de l’écrire, mais la première émotion à avoir fait surface, à ce moment pourtant formidable de libération de la parole, a été la haine pour les femmes. Pas toutes, bien sûr, mais certaines. Les victimes de violences, en fait. En 2017, alors que je travaillais comme journaliste pour un média féministe, le raz-de-marée #MeToo m’a obligée à regarder le monde par une autre lorgnette. Les choses changeaient, les femmes parlaient et... je me suis sentie bafouée. Pendant toutes ces années,
mon silence quant à la dureté de ce que j’avais subi à un moment essentiel et même fondateur de la vie d’une jeune femme constituait non pas tant un fardeau qu’une fierté. J’avais eu « l’élégance et la force » – ce sont les mots auxquels je pensais alors – de vivre mes misères intérieures sans en faire étalage où que ce soit. Or, toutes les jeunes femmes qui m’entouraient, enfin libérées par #MeToo, commençaient à témoigner d’histoires similaires dans des articles, des blogs, des vidéos. Les stars, mes collègues, mes amies, tout le monde se racontait. Il ne s’agissait plus de vivre nos drames dans l’intimité, en les considérant encore comme rares ou uniques, mais collectivement et à voix haute, chose absolument insupportable pour moi. Je me suis sentie dépossédée de ma douleur enfouie. Je n’étais plus qu’une victime parmi tant d’autres. « Victime » est un mot que je n’ai jamais prononcé me concernant, d’ailleurs. Ce mot me dégoûte. Ce mot affaiblit. Ce mot rabaisse. C’est l’impression que j’avais à ce moment-là, en tout cas.
Les histoires des autres, de surcroît, ne m’horrifiaient pas : on n’est pas horrifié par la douleur d’autrui quand on a vécu la même. En revanche, elles ont fait naître de l’agressivité en moi. Je ne pouvais pas m’empêcher de mépriser les récits de ces femmes qui, estimais-je alors, avaient vécu des choses moins graves que moi. J’ai donc pendant long- temps œuvré à construire une hiérarchie (entièrement personnelle et péremptoire) de la douleur des femmes, en vertu de laquelle toutes celles que j’estimais inférieures à la mienne me semblaient consternantes et inutiles à dire.
J’avais même du mal à écouter mes amies. Elles racontaient, pour certaines, ce que je considérais comme de « petites violences », symptomatiques d’amours adolescentes, et avec des garçons de leur âge : une insulte, un crachat, une claque, mais c’était « tout », et ça ne me semblait pas mériter l’impudeur de l’oralité. C’est fou d’écrire ça, j’en conviens. Ça me choque moi-même.
D’ailleurs, j’ai mis des années à comprendre pourquoi les récits des autres femmes m’étaient tellement insupportables. Outre le fait que j’avais été élevée par un père extrêmement pudique, de cette pudeur hindouiste qui considère que la misère se vit sans se dire, outre l’éducation que j’avais reçue de ma mère, qui déteste qu’on fasse cas des drames personnels, ces récits m’insupportaient surtout parce qu’ils m’obligeaient à regarder en face ce que j’avais moi-même vécu... et tu. La parole des autres me renvoyait à mon silence. L’expérience des autres me renvoyait à l’universalité de mon malheur. Voilà la raison de mes honteuses détestations.
Le poids du silence m’a écrasée pendant plus d’une décennie. J’ai été en colère contre le monde, contre les autres, et plus précisément contre tous ceux qui s’exprimaient. Enfin, j’ai été en colère contre moi-même. Et pour- tant, j’ai continué à ne pas vouloir dire. Je le répète, pour moi, « dire » signifie « écrire ». Et je n’avais jamais vraiment écrit sur ce sujet. Je n’avais trouvé ni le bon moment, ni le bon angle, ni le bon format. Je repoussais l’écriture, encore et toujours. Persuadée, de toute manière, que le monde pouvait se passer d’un énième témoignage sur les violences faites aux femmes. Comme si cette « thématique » était passée de mode. Comme si elle était trop répandue pour souffrir un récit supplémentaire. Et puis, en 2024, douze ans après avoir mis Jordan à la porte, une chose étrange est venue bousculer la rigueur que je mettais à taire mon histoire, ou à ne pas la raconter par écrit, tout du moins : j’ai rêvé de mon père. Il m’est apparu nettement, dans son ensemble en lin blanc dans lequel on l’avait incinéré, des années plus tôt, et m’a susurré : « Ne le laisse plus revenir... »
C’était la veille de mon départ pour la Grèce, par un mois de juillet aussi impitoyable que celui où tout avait commencé. Oui, l’été dernier, le passé a ressurgi, physiquement. Et, avec lui, la nécessité d’écrire.
6
Deuxième été : 2024. Je viens à peine de rentrer de Finlande, où j’ai en partie écrit Greta et Marguerite, mon second roman. Je repars déjà à Syros, cette île des Cyclades qui me rappelle tant celle de mon père, pourtant à des milliers de kilomètres. Là, le même turquoise dur s’impose à l’œil sitôt qu’il s’ouvre, offert par cette mer grouillant d’aloses, de crénilabres, de poulpes et de rascasses. Si les paysages sont tout de blond grillé, contrairement à ceux de l’île Maurice, où la pluralité des verts l’emporte sur tout autre camaïeu de couleurs, il y a toujours dans les îles quelque chose d’identique : ce sentiment galvanisant d’être seul en étant au centre de tout. Amaury, mon conjoint, m’accompagne sur ce lopin de terre brûlée qui nous avale chaque été. Depuis des années, c’est la même ritournelle : la baignade à Achladi, le verre de vin frais chez notre copain Alexandros, la distribution de croquettes et d’eau aux chats à moitié crevés, et pourquoi pas un après-midi avec notre copain Fred sur le ponton, qu’on rebaptise le « pontonos », car il est toujours un peu drôle – bien que glottophobe – de prétendre qu’il suffit d’ajouter le suffixe « -os » à chaque mot français pour le traduire en grec. La vie est douce ici, comme elle l’est toujours ailleurs que chez soi, surtout quand il fait trop chaud et qu’on vit alangui, rassemblant le peu de forces qu’il nous reste pour boire de l’eau à petites lampées.
Bref, c’est le mois de juillet. Un matin, je reste long- temps sur la terrasse à peaufiner mon cancer de la tronche en m’exposant sans crème solaire. Amaury me rejoint. On a envie de prendre le petit déjeuner sur la terrasse de l’hôtel d’Alexandros. Il y sert quotidiennement du thé à la sauge et du cake aux olives noires. Nous descendons en scooter à la plage, comme deux gros feignants. La canicule s’est déjà abattue sur l’île, fournissant là une belle excuse à notre paresse. J’arrive sur la terrasse, devant ce que j’appelle « ma » plage, avec ce petit ton colonia- liste dont les Français ont le secret. Ma seule légitimité à l’appropriation de ce lieu ? J’y viens depuis des années et c’est là que j’ai écrit le début des Jours mauves, mon premier roman. C’est aussi là que j’ai trouvé un chaton mou- rant que j’ai soigné, adopté et qui vit désormais avec moi dans le Perche. Cette plage est ma plage parce qu’elle est importante pour moi, sans doute comme pour tous les vacanciers qui aiment à la retrouver année après année et avec qui j’échange toujours un geste poli de la main.
On ne se connaît pas mais on se reconnaît. Ce matin, je reste debout face à cette mer qui m’obsède tant que j’y plonge normalement avant toute chose, avant même de prendre un thé à la sauge ou une part de cake aux olives. Tout à coup, je sens une présence dans mon dos, que j’ignore simplement, toute à ma contemplation. J’ai néanmoins l’impression que la personne derrière moi ricane. Sans prêter plus d’attention à l’homme qui est allé s’asseoir de l’autre côté de la terrasse, à quelques mètres de moi, je discute avec Amaury. Soudain, mon regard se pose sur l’homme. Ce n’est pas tant son visage que ses gestes, qui opèrent comme la foudre...
Je n’ai pas besoin de regarder sa gueule, je sais qui est ce type grâce ou à cause de sa manière si singulière, jamais revue chez qui que ce soit d’autre, de se mouvoir, de faire craquer ses doigts, de se dandiner sur sa chaise, de secouer sa nuque de gauche à droite comme un vola- tile effroyable tout droit sorti du Mésozoïque, mais je ne peux m’empêcher de faire courir mes yeux sur son visage. Ce sont ses gestes désordonnés d’olibrius qui ravivent ma mémoire. Jordan n’a pas changé. Il a vieilli – il a pris douze ans depuis la dernière fois – mais son air est demeuré intact. C’est celui de quelqu’un qui prend du plaisir dans le malaise de l’autre. Jordan porte des Ray Ban Aviator. Quand je regarde dans sa direction, il ôte ses lunettes et plante son regard dans le mien. Puis il sourit avec perfidie et frotte ses mains l’une contre l’autre, signe par lequel il me fait comprendre qu’il est prêt aux hostilités si hostilités je souhaite engager. Et que ça le fait bander. Tout cela se joue en quelques secondes. J’étouffe un cri rauque, intesti- nal, un cacardement, en fait, en le reconnaissant. Amaury m’interroge mais il n’a pas besoin d’entendre ma réponse. Il est l’une des rares personnes à connaître tous les détails. Tous ceux que j’ai cachés à mes amis, à ma mère, à mes conjoints précédents et même à vous, parce que personne n’a besoin de description graphique de ma vie intime. Alors il dit : « C’est lui, n’est-ce pas ? » Il ne marque aucune hésita- tion. Les traits de mon visage ne peuvent se déformer qu’en la présence inattendue d’une seule personne sur cette terre. Je lui souffle : « On se lève doucement et on part. »
La suite défile très vite : Amaury me prend par la main, nous enfourchons le scooter et roulons jusqu’à la capitale de l’île, où nous nous arrêtons devant un restaurant qui surplombe une baie sublime. Je me dis que ça ressemble à Port-Réal dans Game of Thrones. Nous commandons des boissons et je m’éloigne un instant pour passer un coup de fil. Je marche rapidement jusqu’à un arrêt de bus où il n’y a personne. J’appelle mon ami sur la terrasse duquel je viens d’apercevoir Jordan gesticuler. Alexandros m’apprend que le quarantenaire habite bien là, sur l’île, avec une fille d’ici aux cheveux sombres, dans une maison qui surplombe la crique, où le vent s’insinue en octobre pour faire crier la roche claire. Il vit là depuis des années. Précisément depuis que j’ai choisi cette île qui me rappelle mon père, la faisant mienne. Je ne l’avais jamais croisé auparavant. Je ne l’avais jamais senti et pourtant il était là, toujours à quelques mètres de moi, à vivre une existence parallèle dont j’ignorais tout. Nous nous frôlions depuis des lustres. Nous fréquentions les mêmes lieux, avions les mêmes copains. Des amis d’été pour moi, des amis de toute l’année pour lui. J’appelle ma mère, la voix éraillée par une panique qui lui semble déraisonnable, et lui raconte ce qu’il vient de m’arriver.
Au téléphone, elle rit. « Ah tiens, il est là, celui-là. » Par la légèreté de sa réplique, elle néglige ma douleur, comme elle le faisait quand j’étais encore une adolescente sous emprise. Dans son rire, je décèle le déni de sa responsabilité. Je ne lui en veux pas. Elle ne connaît pas l’histoire dans son entièreté. Comme moi, comme vous peut-être, comme le monde entier, elle choisit de s’arranger avec la vérité. « Ah tiens, il est là, celui-là », c’est peu de mots. Ça contient pourtant tout le déni de l’humanité.
Brusquement, sans que rien m’ait préparée à une telle réaction, je m’effondre en larmes, de gros bouillons qui disent des détresses trop longtemps bâillonnées. Je n’ai pas pleuré après ma rupture. Il y a bien eu des moments où, en racontant un détail à une amie, j’ai eu les larmes aux yeux. Mais jamais il n’y a eu d’effondrement total. Comme lorsque mon père est tombé malade du cancer et comme lorsqu’il en est mort. La maîtrise de soi, la tenue, la fierté étaient autant de fondamentaux pudiques que j’avais appris à cultiver juste après cette malencontreuse première histoire d’amour. J’avais suffisamment perdu la face en cédant à mes émotions et m’étais juré, sans le conscientiser, qu’on ne m’y reprendrait plus. Et voilà qu’une seule minute face à ce géant tout droit sorti du passé me replonge dans le tumulte de ma jeunesse.
Au cinéma, il y a une technique qui s’appelle « l’effet Vertigo », découverte et théorisée par Hitchcock. Elle consiste à contrarier rapidement les effets simultanés d’un zoom et d’un travelling arrière, ce qui donne une impression de distorsion de l’arrière-plan et peut faire croire que le sujet immobile avance tandis que le paysage file. Ça désoriente. Ça colle le vertige. Voilà l’effet que vient de me faire l’apparition du visage de Jordan. J’ai la sensation que moi, le sujet principal du plan, suis demeurée inerte, tan- dis qu’à l’arrière-plan défilait toute ma vie, imposant à mon être perclus d’effroi le film de mon existence en accéléré. Un peu comme si j’allais mourir. Avec un seul « r ».
Tout revient. Enfin non, une partie de ce tout revient. Une scène, soudain. Une scène en particulier. Et je suis là, dans ce paysage grec qui ressemble au décor d’une série d’heroic fantasy, à subir la projection de mon propre passé. Par bribes. Comme si mon fantôme personnel perdait ses os devant moi et que je les rassemblais un à un, soumise à une vision sitôt que j’en attrape un nouveau. Je suis projetée en arrière, une décennie plus tôt, par l’effet Vertigo.
7
Troisième été : 2012. J’ai vingt ans. Je suis à l’ISIT, une école de traduction. En cours, je rencontre Léo, un Blanc à dreadlocks qui a de toutes petites dents. Quand il me sourit pour la première fois, je décèle, entre ses cils, une inoffensivité rêvée. Il sera ma bouée de sauvetage. Quelques jours plus tard, Léo et moi couchons ensemble chez lui, d’une manière qui ne peut faire de mal nulle part. Qui ne peut faire de mal à personne. Quand je rentre chez moi, Jordan est là, à préparer un gâteau. C’est fou mais ça me bouleverse. Tandis qu’il était à la maison, prêt à me faire la fête comme le font les chiens, j’étais au lit avec un garçon inoffensif. Je file prendre une douche.
Je suis déjà sous l’eau quand je me rappelle avoir négligemment laissé mon téléphone dans la cuisine, chose qui ne m’arrive jamais. Je connais la tendance de Jordan à fouiller dans mon portable. D’aucuns diraient que c’est un acte manqué. Au moment exact où je prends conscience de ma négligence, j’entends des pas de buffle battre le sol du couloir. Aucun doute n’est permis : Jordan a lu mes échanges avec Léo. Il sait ce que j’ai fait. Je me jette hors de la douche pour fermer la porte à double tour mais il est trop tard, il est déjà entré et a les yeux remplis d’un feu dont je ne sais que trop bien ce qu’il annonce.
En le voyant là, devant moi, furieux et désespéré, je me dissous. Je me dis tout simplement que je vais mourir – avec un seul «r» – et que c’est tout, que je l’ai bien cherché, à fumer une cigarette dans les toilettes d’un train avec un inconnu. Ce moment va modifier l’entièreté de mon caractère, même si, pour l’instant, je n’en ai pas conscience, les bras repliés sur mes seins, le dos voûté, les genoux fléchis, recroquevillée pour ainsi dire comme un animal. L’instant s’étire, dure des heures. J’ai l’impression que je pourrais découper chaque microaction, chaque geste de Jordan avec une précision de monteur de cinéma. Dans mon film préféré, Big Fish, le héros tombe amoureux d’une jeune femme dans un cirque, et le temps s’arrête alors : le pop-corn est suspendu en l’air, le cerceau d’une danseuse ressemble à un anneau de saturne immobile, les enfants sont figés dans un rire qui dit leur joie. Je croyais que l’immobilité du temps était la conséquence de l’amour. Il s’avère que c’est aussi celle de la haine.
Ainsi donc, je vis cette séquence au ralenti. Dans le couloir, Jordan m’étrangle en serrant comme un fou. Je ne me défends même pas. Il m’apparaît soudain que le papier peint, d’une affreuse couleur saumon, a viré au gris dégueulasse, comme à peu près tout dans cette baraque depuis la cigarette dans les toilettes du train. En haut du mur, un lé se décolle. Si l’on tirait dessus, on découvrirait le blanc nu sous la couche de couleur factice et je me dis que Jordan, comme ce mur, est composé de tant de couches de lés qu’il est impossible de savoir ce qu’il y a dessous. C’est un mythomane aux mille visages. C’est un arbre massif dont j’ignore toujours, après toutes ces années, l’essence.
Un bruit métallique me sort soudain de mon asphyxie méditative : une clé tourne dans la serrure. C’est ma mère qui rentre du travail. Ma mère qui, d’un clin d’œil, voit que la survie de tout son petit monde est en danger. Elle attrape le premier objet qu’elle trouve pour cogner sur son gendre : une baguette de pain. Elle frappe, frappe, frappe Jordan à coups de gluten. Dans ce couloir, dans la posture pathétique que nous arborons tous les trois, j’éprouve brusquement un changement interne. Je me sens intrinsèquement, moléculairement, physiquement modifiée. Dans la nacre moirée de mon iris virevoltent les têtes aux dents rabotées, aux joues déchiquetées de mon enfance. Elles luttent pour subsister, imposer leur existence à ce vaisseau en mutation, puis explosent et disparaissent. Elles ne reviendront pas. Mes pupilles deviennent celles d’une autre. Mes muscles deviennent ceux d’une autre. Mon sang devient celui d’une autre. Mes dents serrées, mes ongles courts deviennent ceux d’une autre. Oui, je me le jure au moment où naissent mon nouveau corps, ma nouvelle détermination : on ne m’étranglera plus. Jordan se répand en excuses. Le pauvre fou ne remarque même pas que je suis loin, dans mon monde intérieur, duquel seuls une poignée de tendres amoureux, bien plus tard, pourront me sortir.
Le lendemain, je rentre de l’école en écoutant l’album In Rainbows, et Thom Yorke, le désespéré Thom Yorke, malgré lui, m’aide à acquérir encore plus de clairvoyance. Je sais ce que je dois faire. Lorsque je rentre chez moi, Jordan est là, qui brique la maison pour se faire pardonner, comme si un chiffon humide pouvait effacer des années de démence. Le soir, je me couche seule, tombant de fatigue au point d’oublier de fermer les volets. Au matin, je suis réveillée par les premiers rayons du soleil.
Dans mon grand lit où j’ai dormi sans lui, j’ouvre les yeux sur un ciel clair. Pour la première fois depuis l’arri- vée de Jordan dans ma vie, j’ai laissé les volets ouverts. J’avais oublié à quoi ça ressemblait de se réveiller grâce à la lumière du petit jour. L’aurore agit comme l’ultime déclic. Je me lève tel un automate et, sans réfléchir, m’en vais au salon où je trouve Jordan, déjà réveillé, buvant un café accroupi sur un fauteuil, dans une position de grand singe. Je fonce vers lui, bien décidée à le jeter enfin dehors, même si son air tendre, qu’il adopte cinq matins sur sept, est à deux doigts de me faire changer d’avis. Mais je suis trop fatiguée pour continuer à le laisser là, à habiter mon existence. Surtout, je ne l’aime ni ne le hais plus.
Je le veux simplement hors de chez moi. Je ne me souviens plus précisément, aujourd’hui, des mots que j’ai prononcés. Je ne me rappelle plus son état à lui. Ma seule réminiscence réside dans le bruit de vêtements fourrés dans un sac en toile de coton, dans quelques derniers mots sous la forme de méchancetés et dans une porte qui claque. Jordan est parti. Je retourne dans ma chambre et reste longtemps à contempler un ciel auquel je me jure de ne plus jamais faire obstacle. J’ai fini de fabriquer la nuit. Je ne fermerai plus jamais les volets.
8
C’est cette scène qui s’impose à moi, quelques minutes après que j’ai revu Jordan en Grèce, avec une limpidité extraordinaire. C’est ce jour-là que, soumise à l’effet Vertigo, je décide d’écrire. Collecter mes souvenirs me permettra de maîtriser leur jaillissement. Je traîne encore un peu, néanmoins, déjà épuisée à l’idée de me replonger dans tout ça. Je traîne jusqu’à approcher d’une date fatidique pour moi : mon anniversaire.
Cette année, le 20 octobre précisément, j’aurai trente- trois ans. Ce qui est sidérant quand on sait que j’ignore toujours comment remplir ma déclaration d’impôts et que je n’ai pas de mutuelle. C’est sidérant quand on sait que je jette parfois les écorces de mandarine derrière le canapé parce que j’ai la flemme de les mettre à la poubelle. C’est sidérant quand on sait qu’en 2025 j’ai perdu huit paires d’écouteurs filaires, menti sur ma prétendue myopie
et mangé au moins douze paquets de Schtroumpfs. Cette année donc, je vais avoir trente-trois ans, et je déteste toujours autant fêter mon anniversaire. Enfin, ce n’est pas vraiment ça, c’est juste qu’il m’est arrivé un certain nombre de saloperies autour de cette date-là. Une fois, j’ai chopé une salpingite, une autre fois, ma trompe de Fallope a explosé, une autre fois encore, on m’a retiré ladite trompe malade. Chaque mois d’octobre, il m’arrive une merde. Et pas n’importe laquelle. Une merde qui est en rapport avec mon appareil reproductif. À ce qui fait en partie que je suis, biologiquement en tout cas, une femme. J’ai pas mal réfléchi à ça, d’ailleurs, ce qui faisait qu’autour d’une date censée me célébrer j’étais toujours malade au niveau du petit bassin, à un endroit qui pourrait être perçu comme le berceau de ma sexualité et de ma féminité. J’ai plusieurs théories à ce sujet, dont au moins la moitié impliquent ma première relation amoureuse. Psychologie de comptoir ou genèse réelle, allez savoir. Ce jour me semble en tout cas maudit. Pourtant, si j’étais une personne optimiste, de cette drôle d’espèce qui voit toujours le verre à moitié plein, j’écrirais que c’est aussi le jour de mon anniversaire que j’ai signé l’achat de ma maison, il y a trois ans.
Ma maison, mon plus grand bonheur. Elle n’a pas l’air de grand-chose pourtant, c’est une longère au milieu de rien. Mais pour moi, cette acquisition signifie beaucoup. Cette vieille maison de famille, qu’on rafistole comme on peut, mon compagnon et moi, raconte que j’ai construit un foyer sain. Ça a l’air de peu. C’est pourtant là l’essentiel. Désormais, tous mes matins sont clairs. Et si je garde quelques séquelles de ma première histoire dans ma chair, dans ma tête, dans mes colères régulières, dans mes mains qui jettent des trucs par terre toutes seules, je sais que je suis une femme qui a la pleine maîtrise de son libre arbitre. J’ai nettoyé mon crâne, je l’ai vidé, briqué, poncé. Il brille comme un sou neuf. Et si d’aventure une pensée impie se faufile dedans, elle est immédiatement traitée, déconstruite et détruite. À la rigueur, elle peut sortir sous la forme d’une vanne. Mais ça ne va pas plus loin. J’ai cessé d’établir une hiérarchie de la douleur des femmes, par exemple.
Bref, à quelques jours de mon anniversaire, je me mets enfin à l’œuvre. J’écris pour le salut de mes jeunes années, pour panser ces anciennes hostilités placées au mauvais endroit. Le fait d’avoir revu Jordan l’année dernière a agi comme le déclencheur parfait. L’argument idéal. Je m’enferme chez moi, à la Malbrou, et c’est un flux continu qui se déverse dans mon ordinateur, presque malgré moi, pendant des jours. Une version, deux versions, trois versions. Ça ne va pas. J’essaie d’être exhaustive mais je n’y arrive pas. Le texte ne me satisfait pas. Il me blesse. J’aimerais pouvoir raconter chaque détail de ces années- là. Or, pour abriter le récit complet des émotions, des mots et des gestes, mais aussi – je dois l’avouer, au risque d’être incomprise – certains bonheurs, il faudrait des livres entiers. Des rouleaux infinis pour expliquer l’ambivalence des cœurs, ou en tout cas du mien. Car n’en déplaise aux manichéens, je dois admettre que j’ai parfois vu de beaux bateaux voguer sous l’auvent des cheveux clairs de cet homme dangereux.
J’aurais aimé pouvoir détailler ça aussi, les quelques endroits de lumière qu’on s’évertue à trouver quand on va très mal, pour ne pas peindre un tableau trop dualiste de l’existence. Mais je ne peux pas. Il est trop tard dans mon monde pour une dissection si précise de ma première vie. Et surtout, je n’en ai pas besoin, ici et maintenant, dans ma paisible maison au fond des bois. Le récit de quelques souvenirs fondamentaux empêchera que l’histoire ne se répète. Le récit des souvenirs de trois étés, précisément.
Maintenant, revenons-en à ce qui a vraiment de l’im- portance : c’est l’histoire d’un mec qui a une banane dans l’oreille...
Titres parus
N° 1 — T9, Blandine Rinkel
N° 2 — Au pays de la bouffe, Mathieu Palain
N° 3 — Le premier cri, Abigail Assor
N° 4 — Ego Hugo, Arthur Dreyfus
N° 5 — La nuit Cayenne, Victor Dumiot
N° 6 — Le dernier twist, Frédéric Perrot
N° 7 — Entre les bruits du monde, Laura Poggioli
N° 8 — Les mots sont patients, Maylis Besserie
N° 9 — Entre chienne et louve, Julia Malye
N° 10 — Tu connaîtras la peur, Salomé Berlemont-Gilles N° 11 — L’odeur du sapin, Alexandre Galien
N° 12 — Le prix de la journée, Nadège Erika
N° 13 — Cath, Léna Ghar
N° 14 — Bolaño, Macron et moi, François-Henri Désérable N° 15 — Le point de félicité, David Fortems
N° 16 — Omerta, Alice Develey
N° 17 — Couleur Stanislas, Rachel M. Cholz
N° 18 — Tuer le courrier, Esther Teillard
N° 19 — La mer gelée, Célestin de Meeûs
N° 20 — 240 secondes, Margaux Cassan
N° 21 — Volets ouverts, Kalindi Ramphul
...