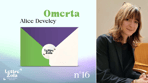La voix de Pilar, Olivier Liron
Lettre Zola n°22, décembre 2025 Le narrateur, Adrien, se rappelle son dernier repas de Noël passé avec sa mère et sa grand-mère – le seul dont il se souvienne. Ce soir-là, il avait décidé d’emporter un dictaphone pour enregistrer la voix de son abuela : des récits d’Espagne, le pays quitté, ses confessions sur son intégration en France...


Est-ce que je savais déjà que ce serait notre dernier Noël, et qu’un jour il me faudrait écrire ces mots en tremblant ?
Une table dressée à la hâte avec des serviettes fantaisie versicolores, des verres à pied dépareillés, des assiettes anciennes chinées à la brocante et sorties pour l’occasion. Sur la nappe sont dessinées des taches préhistoriques, pareilles aux continents d’une mappemonde inconnue. Le feu crépite dans la cheminée de la salle à manger ; la pièce sent les marrons chauds, le gras, la fatigue joyeuse. Trois générations dans la pièce. Pilar, ma grand-mère, rit déjà avant d’avoir parlé. Sa voix roule, grave, pleine de soleils anciens. Clara, ma mère, s’affaire avec la bouteille ; et moi, j’essaie d’aider, mais on me congédie aussitôt.
— Laisse, je m’en occupe. Tu vas tout renverser.
— Adrien ! Viens me voir, dit Pilar.
Au milieu de la table trône la fameuse bouteille, gevrey-chambertin 2001. Ma mère l’essuie avec le sérieux d’un conservateur de musée. Chaque année, la même tirade flamboyante :
— Tu te rends compte ? Soixante-quinze euros la bou- teille ! J’ai regardé sur Internet. Les dernières se vendent aux enchères. Une fortune. Si je m’en étais doutée, à l’époque, quand je l’ai achetée pour un prix raisonnable...
— Vale de l’argent, dit Pilar en haussant les épaules.
— Mais je ne la vends pas !
— Alors garde-la pour el recuerdo.
— Mais ça tombe bien, c’est aujourd’hui, la grande occasion !
Nous éclatons de rire. Ce rire-là, c’est notre grâce commune, notre manière d’exister un peu plus fort que le temps. Je ne dis presque rien. Je regarde, j’écoute. Le dictaphone posé près de la corbeille à pain clignote, diode rouge, minuscule. Pourquoi ai-je choisi d’enregistrer, ce jour-là ? Je capte les sons, les intonations, la musique du monde avant qu’elle ne s’éteigne. Personne ne fait attention à moi : j’ai toujours été celui qui observe, qui retient.
Pilar a mis sa robe bleu roi à fleurs, celle qu’elle garde pour les fêtes et les repas du dimanche. Elle s’assied lente- ment, avec la prudence des vieilles reines. Son rire, quand il jaillit, fait trembler les verres. On dirait qu’elle s’émerveille d’être encore là, d’avoir survécu à tant d’hivers. Ses mains bougent à peine, mais elles gouvernent la table. Ma mère la regarde, mélange d’admiration et d’impatience. Elles se disputent doucement, avec l’âpre complicité d’une vie entière :
— Tu mets trop de sel, arrête !
— Non, pas assez.
— Si ! Regarde !
— Ay madre mía, toujours pareil !
La cuisine devient un théâtre. On y joue la sempiternelle pièce de Noël, ennuyeuse mais rassurante comme tous ces films bidon avec des familles heureuses. Mais cette année, il y a quelque chose de différent dans l’air. Je les écoute parler, et suis pris d’une soudaine angoisse. Je sais déjà, avec une grande netteté, que ces voix-là, un jour, se tairont. Alors j’enregistre. J’appuie sur « Rec » comme on jure fidélité. Ce que je veux sauver, ce n’est pas seulement la voix : c’est la manière de dire, les petits ratés, les conversations qui s’enchaînent. Tout ce qui fait la vérité de ce moment.
Pilar parle beaucoup, mélange les langues, improvise une syntaxe de passage :
— Que j’ai mis du limón.
— Du citron ?
— Oui. Mais pas trop, hein, sinon ça pique.
— Combien de temps tu le laisses au frigo, ton saumon ? — Deux jours dans le frigo. Avec du gros sel. Après, c’est parfait.
Elle dit « frigo » avec un accent qui en fait un mot neuf, lavé des habitudes, presque joyeux. Quand elle ne trouve plus un terme, elle ferme les yeux, lève l’index, « Comment que vous l’appelez, déjà ? », puis elle rit, abandonne et passe à autre chose. Ma mère intervient, coupe, complète :
— C’était à Pantin, je me souviens, la première fois qu’on avait mangé du saumon ensemble.
— Oui, mais pas pareil. Là, c’est encore meilleur. — Parce que j’ai mis de l’amour !
— Et moi alors, j’en mets pas ?
— Pas assez ! On n’en met jamais assez.
Leur affection passe par la moquerie. Pilar se redresse, respire fort.
— Mon douleur de dos, ça ne va pas très bien.
— Tu veux t’allonger ?
— Non, non. Il ne faut pas le dire.
Elle prononce cette phrase doucement, presque en chantant. Un chuchotement. « Il ne faut pas le dire. » C’est sa loi morale, à Pilar : ne pas se plaindre, ne pas peser. Le silence qui suit est léger, respectueux. Ma mère change de sujet, ouvre le four, Pilar recommence à parler. Le moment est passé, comme une vague.
Je regarde la scène, et je me dis que tout ce que j’aime est là : le désordre, la lumière, le vin, la voix de ma grand- mère. Elle parle et je sens que chaque mot creuse un sillon dans le temps.
J’ai la prescience obscure, alors, que c’est la dernière fois que nous sommes là, tous les trois. Ce sera notre dernier Noël ensemble. Et je sais déjà que cette voix qui remplit la pièce comme une musique s’effacera bientôt dans le souffle du micro.
Pour l’instant, elle vibre encore, et cette vibration-là suffit à faire tenir le monde. J’ai toujours aimé l’écouter. Ses anecdotes, le dimanche, à table, dans le HLM à Pantin, qui commençaient toutes par une phrase d’accroche inégalable, prononcée sur un ton teinté de mystère : « Je vais te raconter une chose... » Sa technique pour s’attirer la bienveillance de l’auditoire – lequel se résumait généralement à cet enfant, avide de mots et d’histoires, qui attendait la suite avec gourman- dise. Après tout, « Je vais te raconter une chose », ça n’avait rien à envier à l’incipit de Moby-Dick.
« Appelez-moi Pilar. »
...