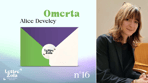Tuer le courrier, Esther Teillard
Lettre Zola n°18 - Numéro d'été 2025 Élégant, discret, alcoolique, Michel venait boire le matin et partait à midi, chancelant. Esther a commencé à le dessiner sur des serviettes de bar. Un jour, elle lui a offert un de ses portraits. Il lui a répondu par un poème, écrit au bic sur une serviette...


Marseille a plumé le confinement. Les bars sont restés ouverts, les restaurants servaient les mêmes cannellonis cramés. Les flics mangeaient à la même table que les frappes. Il suffisait de gratter à la grille, toquer trois fois à la porte. Derrière le rideau tiré, la vie, sans masque et entassée, odeurs de peaux, de tise, d’excès. Marseille est une ville de désir. Le désir est une forme parfaite de vitalité.
Un dauphin a été aperçu dans le port, les vieux sont morts. Le confinement a réussi à Marseille, experte en errance et branlette, ville de cages, de réclusion, déjà exercée à la quarantaine. Le couvre-feu comme terrain de jeu pour ses conneries : prétexte idéal pour défier les règles, enfumer les conditions. Ici, on repère le touriste au ticket qu’il composte dans le bus. Désobéir est une identité. Le signe de reconnaissance d’une fraternité secrète.
J’ai grandi à Vauban, le quartier en dessous de Notre- Dame de la Garde, petit village en autarcie sur les hauteurs de la ville. Quartier longtemps communiste, désormais bourgeois. Des adresses de mon enfance, il ne reste que Le Score, PMU sale, longtemps tenu par Arthur (Haroutiour) l’Arménien, puis Tom (Abderrahmane) le Kabyle. Aujourd’hui, deux Vietnamiens essaient, en vain, d’en faire une adresse où l’on peut grailler sans sortir malade. Le Score, bar de boloss, de rescapés, dernier campement d’un quartier qui n’existe plus. Le bar à frites est mort, le boucher est parti, la Maison du peuple, ancien QG trotskiste, s’est fait intimider par un bar branché, vin naturel, petites assiettes. Les vieilles familles juives, arabes, comoriennes ont laissé place aux trentenaires fortunés, bordelais, parisiens, biarrots, premier enfant, déménagement récent à Marseille, beaucoup de fric, des boulots incompréhensibles qui ne nécessitent aucun bureau, seulement un ordinateur, une terrasse nickel, une boisson verte.
Vauban ressemble désormais à Belleville, à Soho. L’odeur de poudre, la merde, les hurlements étouffés par une musique house. Ses habitants sont bien sapés et traversent au feu vert. Ils consomment leur capital dans des enseignes où les produits sont sourcés, décryptés, transparents. Ils ne vont pas au Score, adresse obscure, vestige crado du bastion rouge. Seuls les perdants, les derniers du quartier, s’y rendent tous les matins, tous les soirs, vieux cons sur la sellette, renforcés dans leur parano, persuadés d’être les derniers survivants d’un attentat jeuniste, bourgeois. Au Score, des hommes petits, nerveux, conspirationnistes, borderlines, célibataires. Leurs échanges sont à démêler, on ne sait jamais s’ils se castagnent ou se caressent. Le pédé sort facilement. Parfois, ils s’enlacent, s’épluchent des clémentines, se tapotent l’épaule, puis, soudainement, s’arrêtent, terrorisés par leur geste, frappés par l’éternel dilemme de l’homme méditerranéen, un virilisme dogmatique contre une inclination naturelle à la tendresse. Dans ce bar, les rapports humains sont à l’image de Marseille, ballottés entre claques et étreintes, vent qui arrache la gueule et soleil qui console. Marseille sait être douce. Il y a les journées de novembre, bénies, où la brutalité est invisible, dans la rue, les sourires gratis viennent d’une province irréprochable. Mêmes espoirs à Naples, à Alger.
Mars 2020, un printemps silencieux, affaibli par la maladie, qui a fait de Marseille une bombe, une terre attractive. Mer presque propre, soleil crâneur, nombreux sont ceux qui sont venus y passer leur confinement, se gorger de jaune, se vautrer dans le cyan, braver la mort, le masque, se défoncer dans des grandes colocs situées aux alentours des Réformés, continuer à vivre. Marseille a cet art de l’extrême, on y vit aussi bien qu’on peut y vivre mal, ville incompréhensible, sorte de Rubik’s Cube truqué, ville des contraires, aussi chaste que dévergondée, androgyne, terre de femmes, contrôlées par des hommes, contrôlés par leurs mères.
Pendant le confinement, j’ai passé mes matinées au Score. La grille métallique était tirée, je toquais, Tom, le patron, venait m’ouvrir, je m’asseyais dans un coin, commandais un café, ne faisais rien. J’avais le droit, tolérée par le contexte, période de pardon, d’indulgence. Le Score est un PMU fidèle à ce qu’on attend d’un PMU. Les murs sont sales même quand c’est propre, crasse infusée de l’intérieur par les clients, les habitués. Endroit hostile où les femmes ne sont pas faites pour rester. Les types s’excitent et s’énervent, se taillent et se blessent, marasme mâle, bruits de queues, coups de queues, rapports de force. Les discussions ne volent pas haut, dernière meuf serrée, bagnole accumulée. La une de La Provence décide de la conversation du jour, trois mer- deux braillent et ne s’écoutent pas, le pédé de rigueur acte le début de la fin. Tom doit intervenir à partir du pédé. Quand il l’entend, il arbitre, choisit celui qui partira, celui que l’on terminera devant les copains en le foutant dehors, coup de pied au fion. Tom sait que l’humiliation fidélise la clientèle, l’humilié revient toujours pour laver l’affront qu’on lui a fait. Le fantasme du PMU est obscène, les hommes y sont ivres et bêtes, gondolés dans leurs vêtements serrés, nerveux, impuissants, ils ne baisent pas, en veulent aux femmes, ils ont besoin d’elles, elles n’ont pas besoin d’eux.
Le Score tournait pleins gaz pendant le Covid, enfumé dès sept heures, chorale à refrain unique : pédé. J’y allais pour passer le temps. Je regardais les murs sales, la plante verte défoncée par les clopes et les gestes brusques. J’observais les clients. Le Belge qui n’était pas belge, ancien tenancier de maison close. L’Égyptien, obèse taciturne. Les deux frères corses, main dans la main, inséparables. Le dépressif au chien, fragile. Seulement deux femmes. Sandrine, tolérée car masculine, de celles qui s’en tirent en se déguisant en con. La Russe, alcoolo et vénale, suintante, abîmée, qui portait sur son visage la vie dans la rue, les galères, les bites sucées pour cinq balles et la première héro. Le Covid n’avait rien changé à leur vie, si ce n’est qu’ils jouaient au tiercé dans le noir, derrière un rideau baissé. Si un vieux ne venait pas, c’est qu’il était mort. Raison de plus pour se prendre une taule. Célébrer le défunt.
J’observais Tom, unique visage radieux de cette salle souterraine, son art de mettre le poivrot à distance tout en lui faisant croire qu’il l’écoutait, de doser le verre de trop, de virer l’imbécile, d’attraper le passant. Art local. À Marseille, les patrons de bar ont des rictus englobants, des gestes maternels. Je me sens liée à eux par une sorte de glu qui pourrait s’apparenter à du liquide amniotique, une colle dans laquelle tu peux nager longtemps et qui te retient jusqu’à l’expulsion finale. Impossible de quitter le bar sans résidus visqueux. Tom, en vérité, son prénom,
c’est Abderrahmane. Je l’avais vu sur un papier de livrai- son qui traînait sur le comptoir. Ça l’avait fait chier que je tombe sur ça. C’était touchant de voir ce grand Kabyle se confondre devant moi, fuir mon regard. Je savais de lui quelque chose dont il avait honte. Son associé, Soso, avait une sale gueule, père de famille partouzeur, propriétaire d’un camion blanc, expert dans l’art du compartimentage : séparer très clairement sa vie de daron de sa vie nocturne, alcool coupable, coke pourrie, putes, accès de colère. J’ai toujours eu peur de la manière dont il essuyait les verres. Comptoir sinistre éclairé par les yeux bouillants de Tom, jamais loin. Et de Michel.
Michel était installé au fond à gauche, à côté de la plante usée. Une soixantaine d’années, une moustache noire, ponctuellement gracieux : manteau bleu, écharpe rouge. Son physique était hors sol, incompatible avec les jogs pleins de pisse des autres habitués. Un homme dont la délicatesse évidente et assumée témoignait d’un amour total et inassouvi pour les femmes. Un puceau, m’avait dit Tom, l’ancien postier du quartier. Michel n’avait rien d’un homme. Il était silencieux. Je ne l’ai jamais vu autrement que vêtu de son manteau bleu et de son écharpe rouge, aucun contact avec les autres, pas pour autant détesté, il faisait partie du paysage, les autres teignes l’acceptaient comme on accepte la plante usée. Là à huit heures, tous les matins. Première bière à huit heures cinq. Il en buvait une douzaine. Repartait à midi. Son rituel de boisson
consistait à laisser sa bière sur le comptoir, se lever à chaque gorgée, se rasseoir entre chacune d’elles. Pourquoi une telle mise en scène ? Probablement pour s’obliger à savourer sa gnôle. Sur dix bières sirotées, un va-et-vient permanent de sa chaise au comptoir, du comptoir à sa chaise, en traînant sa jambe droite qui tronchait sa jambe gauche. Le bordel se compliquait vers dix heures, la cinquième bière, plus seulement sa jambe droite qui pleu- rait mais son corps tout entier qui boudait sa beuverie. L’acrobatie chaise/comptoir devenait triste, Tom entrait en jeu, il refusait de lui servir la prochaine bière. Accord tacite, pudique, Tom garant de Michel, aucune parole, seulement un geste négatif de la tête qui signifiait que Tom refusait que Michel meure. Face au non silencieux de Tom, Michel s’en allait. Les hommes méditerranéens prennent soin les uns des autres, s’épluchent des clémentines, s’enlèvent la peau des raisins, des kiwis, se servent des bières, refusent celle de trop, se sauvent la vie.
J’étais fascinée par Michel. Ses gestes ritualisés, la douceur de son alcoolisme, l’absence d’éclat de son addiction. J’observais, captivée, Michel enchaîner les bières et partir à temps. J’observais son rituel avec Tom. Son incapacité totale à mesurer le verre de trop sans lui. Le lien vital qui les unissait. Michel, raide à midi, de la meilleure espèce, sans dérive, dépendance gracieuse, celle qui n’endort que légèrement, rougit la peau, ne fait ni baver, ni vomir. L’alcool des hommes timides, vierges.
Par Tom, j’ai appris que Michel avait été le postier en titre du quartier pendant quarante ans, quarante ans à distribuer des courriers, des lettres de rupture, des pubs pour des serruriers et des volets cassés, des avis d’imposition, des lettres d’insultes, des programmes politiques de blondes peroxydées, des lettres gondolées par des clefs, des gros chèques, des godes, des échantillons de sable. J’imaginais que Michel s’était trompé, qu’il avait plusieurs fois livré le mauvais courrier à la mauvaise personne, créé des malentendus, des bastons, des drames. Michel avait passé sa vie à poster des amours naissantes, pointer des romances usagées, puceau éternel enseveli sous les préliminaires amoureux, garant de la vie sexuelle du quartier. Je pensais au vocabulaire de la poste, coquin et meurtrier, avec lequel il avait dû composer pendant quarante années. Michel et sa virginité face à ces mots féroces.
Boîte à cocus : courriers restants.
Cocotte : boîte à tri.
Prendre la culotte : se faire submerger par un trop gros volume de courrier.
Mondaine : brigade des postiers de nuit. Nénette : tampon du postier.
Passe : acheminement en transit.
Trousse-couilles : siège mobile des trieurs.
Tuer le courrier : retourner un objet postal à son expéditeur.
L’immaculé Michel avait tué des courriers, buté, pendant quarante ans, des écrits de suicidés, demeures sous scellés, au cœur de la merde des autres, pas si blanc finalement, corrompu malgré lui par les histoires de fesses et de fric d’un quartier méditerranéen. J’imaginais sa vie de postier, vie nomade dans les ruelles de Vauban, femmes à poil au balcon, peaux dorées ou couvertes de bleus, hommes cocus, à cran, vie partout, et Michel, au milieu des coups, assis sur son trousse-couilles après une journée à insérer des feuilles dans les fentes d’une ville infernale, Michel face à Marseille, la pire des villes, daronne tordue, paranoïaque, baratineuse, ses promesses de joies, tous ceux qu’elle déçoit.
Je voyais Michel comme l’incarnation même des contra- dictions de Marseille. Les deux étaient inabordables et alcooliques, à côté de leurs pompes, pathologiquement mélancoliques, leur passé collé sur la gueule. Impossibilité totale de faire corps avec ses congénères pour Michel, avec son pays pour Marseille. Deux autistes. L’un plus pur que l’autre. Michel était devenu mon ambition du confinement.
Certains se butaient sur des manuscrits, transformaient leur apparence physique, apprenaient à faire des cakes. Moi, je matais un poivrot précautionneux et délicat, un homme de lettres. J’étais touchée par Michel, le périmètre restreint qu’avait pris sa vie aujourd’hui face à l’ampleur des distances qu’il avait eu à parcourir. J’avais pris l’habitude de le dessiner sur un coin de serviette, modèle particulièrement agréable à croquer, sa moustache, au stylo Bic noir, venait parfaitement onduler dans les recoins du petit papier carré. C’était devenu mon rituel, chaque matin, je dessinais Michel sur une serviette grasse, prise facile, une seule tenue, manteau bleu, écharpe rouge, et deux mouvements, debout, assis.
Tom, qui assistait à la scène quotidiennement, m’avait plusieurs fois suggéré d’offrir l’un de mes dessins à Michel. J’avais refusé. Qu’allait-il foutre d’un portrait de lui fait par une inconnue sur une serviette salie ? Rien, sinon me sourire poliment et continuer à s’enquiller des bières en attendant que Tom lui indique celle de trop. Tom avait insisté. J’avais cédé. Personne ne peut résister à un barman marseillais, yeux trop chauds, mains directives. J’avais fini par déposer sur la table de Michel une serviette : son portrait.
Je me souviens parfaitement du visage de Michel. Ses traits, cloisonnés par l’alcool, se sont ouverts comme une écluse. Son visage, très rouge, s’est rapproché d’une teinte humaine : l’addiction brutalement gommée de sa physionomie. Vieux garçon observé pour la première fois, lumière soudaine, comme si la plante assoiffée avait reçu une rasade d’eau fraîche en pleine gueule. Michel venait d’être arrosé. Il a précautionneusement placé le dessin dans la poche de son manteau bleu et m’a remerciée silencieusement, en inclinant la tête. Le lendemain, il avait une serviette pour moi. Dessus, une phrase, peu compréhensible.
Dans cette voie, le seul qu’on remarque ; c’est le camouflet.
À partir de ce moment-là, ça n’a plus été que des rasades d’eau respectives, un dessin contre un poème. Michel et moi ne nous sommes jamais parlé, il restait à sa place, moi à la mienne. C’était un échange de serviettes. Chaque matin, un dessin déposé sur sa table. Un mot sur la mienne. Je ne connaissais pas la tonalité de la voix de Michel, et encore moins son odeur ou la forme précise de ses mains, cachées dans son long manteau bleu. Nous nous donnions du mal, chacun avait envie de viser l’autre, de dessiner droit, d’écrire juste. C’était un échange absolu, exempt de corporalité, d’érotisme, une transaction qui reposait sur un matériau frugal : la petite serviette carrée, un instrument cheap : le stylo Bic noir. Seul le confine- ment pouvait donner naissance à ce genre de passions bizarres. La période avait ramené l’autre à son état de sujet narratif, de personnage à conquérir. Le voisin de table était devenu un but en soi, un poème à livrer, un dessin à offrir, un bout de serviette, une immensité, un champ des possibles.
Pendant ces deux mois durant lesquels Michel et moi nous sommes mutuellement arrosés, je l’ai observé accorder une importance grandissante à ses écrits. J’avais donné à Michel une autre mission que celle de rentrer chez lui en rampant à midi. Ses mots étaient de plus en plus appliqués, il lui arrivait de les écrire au préalable, probablement de sa piaule, et de me les apporter le matin, toujours sur des serviettes en papier, comme si utiliser une feuille avait été une insulte à notre mode opératoire. Je me surprenais également à m’appliquer à la tâche, à tailler mes crayons fin, harmoniser ses traits, l’embellir, redresser sa posture, affiner son nez d’alcoolique, réduire l’étendue de ses cernes, le dessoûler au stylo Bic. Dessiner Michel, c’était essayer de comprendre Marseille, capturer la fin d’un quartier, la dérive d’un homme, le rouge de son écharpe contre le jaune sur sa moustache, attraper son pas de côté sur la vie, sa virginité.
J’ai dessiné Michel, chaque matin, du 17 mars au 10 mai. Les dessins étaient tous les mêmes, Michel ne portait qu’un unique vêtement et maintenait chaque jour la même posture, le même rythme liquide effréné, seuls ses yeux changeaient de teinte. Il y avait des matinées plus glaçantes que d’autres, des gorgées de trop et des plumes perdues. J’espérais, naïvement, que notre activité réduirait sa consommation d’alcool mais Michel continuait à boire comme un trou, toujours sous les ordres de Tom, soumis à son signe de la tête, le verre de trop, celui qu’il refuserait de lui servir. Si Michel portait élégamment sa défroque d’alcoolo, il n’en demeurait pas moins un énorme pochetron.
Évidemment, les autres merdeux autour avaient remarqué le manège et commencé à rire. Michel avait une poule, une poule de vingt ans avec qui il ne baisait pas, échangeait simplement des mots doux, des gribouillis, c’était trop tendre pour ce bar, Michel rougissait comme un con, retrouvait ses premières teintes, lui-même dépassé par la tournure des événements, conscient que nous avions créé ensemble, et ce sans nous parler, quelque chose de gracieux dans un endroit sinistre, intolérant à la poésie, à l’échange dénué de rudesse. Une conversation muette entre deux fous, systématiquement le même dessin contre des mots incohérents, les écrits de Michel, cut-up truffés d’évidences, ramassis d’aphorismes déjà existants, de poèmes, de dictons.
Il avait ses heures romantiques :
Vos traits disent la liberté.
Ses digressions :
Je sais qu’on ne le dit pas, c’est pourquoi je vous l’écris. Merde.
Ses quarts d’heure sardoniques :
Les arbitres de football sont des inter-mi-temps du spectacle.
Sa folie manifeste. Le jour de la fête des mères, ces deux phrases pour moi :
Il est un jour qui fait un grand écart avec tous les autres. C’est celui de ta fête, maman.
Pourquoi me souhaitait-il la fête des mères ? Probablement parce qu’il associait la femme à la mère, les seuls seins qu’il avait vus, goûtés. J’acceptais qu’il m’appelle maman comme on accepte parfois des inconnus n’importe quoi, précisément parce que c’est eux, que ce qu’ils sont pour nous est obscur, et que cette pénombre tolère l’improbable. Je repensais à un débile qui m’avait appelée maman alors que nous baisions. J’avais trouvé ça laid, lui avais dit de fermer sa gueule, il s’était vexé, nous n’avions pas poursuivi. Michel n’était pas mon amant, il était pourtant un sujet d’amour, un amour fait de serviettes et de silences qui rendait son maman génial.
Je gardais tous les mots de Michel dans une boîte à chaussures, ils s’accumulaient, petite pile de serviettes nectar inutilisable, posés sur ma table de nuit. Je dormais à leurs côtés, me réveillais le matin pour découvrir la phrase du jour. Une nuit entre nous à chaque fois. Je découvrais le courrier, l’excitation du courrier, le lien passionné entre l’expéditeur et le destinataire. Chaque matin, j’attendais ma lettre, la phrase de Michel. L’espace- temps entre chacune de nos transactions était insupportable. Je découvrais, avec Michel et le confinement, la saveur de la lenteur, du train décéléré de nos échanges réduits aux insupportables sept heures qui séparaient le midi de la soirée. J’écoutais le tempo régulier du chant des oiseaux, le tintement suspendu des cloches de l’église Saint-François d’Assise, le désert des rues sans insultes. Je découvrais l’ennui et l’attente, je guettais les signes de tête, les gestes premiers. Le Score était un laboratoire, une lumière projetée sur le peu d’espace qui nous était laissé pour vivre. L’autre n’était plus une menace mais un défi, une promesse de fantaisie, de jeu, un carnaval. J’éprouvais pour Michel un amour pudique et total, amour absurde, reflet de Marseille : train de retard, refus catégorique d’aller au rythme des autres, de louper le coche, passer à la casserole, consommer. Histoire gratuite. Un lien précieux car éphémère, voué à se terminer, à échouer, basé sur la certitude que nous vivions un moment de crise, d’ajustement, de tentatives, qui déjouait le caractère morbide du Covid en train de buter les derniers vieux du quartier, laisser la ville aux jeunes, aux capables, aux entrepreneurs missionnés de mater Marseille et son bordel, son moulon, sa moula. Un matin, Michel n’est pas venu. J’ai su qu’il était mort.
Le lendemain, Tom m’a proposé de l’accompagner sonner chez Michel. J’ai découvert qu’il habitait dans l’im- meuble du Score, trois étages plus haut. Pas de réponse, nous avons immédiatement appelé les pompiers, ils ont défoncé la porte. Michel gisait, au milieu de son lit, son lit dans le salon, la cuisine, les chiottes dans le salon, appartement pourri, vraie piaule de puceau, un bureau, une chaise, une assiette. Brassens tournait à fond sur un tourne-disque, putain de toi, pauvre de moi, Michel était au centre, le comble enfin, misérable salope, le visage serré, mort, dur, te jeter dans le lit du boucher, il était autre, ce n’était pas la mort qui l’avait travesti, simplement son accoutrement : Michel ne portait pas ses vêtements habituels, son manteau bleu, son écharpe rouge, mais un peignoir noir dans lequel il était introuvable, étranger dans cet autre tissu, dans son appartement. Brassens tour- nait à fond, putain de toi, et prenait tout l’espace, pauvre de moi, avec sa gouaille, son énergie vitale, sa cruauté. Les pompiers foutaient la zone, dérangeaient tout, nous assaillaient de questions, qui était Michel, que faisait Michel, quel âge avait Michel, nous n’en savions rien, la seule information en notre possession était le nombre de bières que consommait Michel, chaque matin, au Score, putain de toi, ce chiffre-là, Tom le connaissait parfaitement, pauvre de moi. Très rapidement, un médecin légiste est arrivé. Il a palpé Michel, l’a retourné comme une crêpe, caressé, senti. Michel touché intimement pour la première fois, par un docteur de cent kilos, une pièce énorme et insensible qui n’a pas pu s’empêcher de chanter Brassens, putain de toi, de tenir le refrain. Il a écrit dans un bloc-notes, parlé aux pompiers, passé une série d’appels, confirmé l’AVC. Il a fallu rester, se tenir droit, collaborer. Je dévisageais Michel, toujours introuvable dans son peignoir noir, à la recherche d’un signe de reconnaissance, d’un trait identifiable, cherchant son visage que je connaissais bien pour l’avoir dessiné. Michel n’avait rien à faire dans ce décor qui n’était pas le sien, bien qu’il s’agisse de sa piaule, dans ce ridicule peignoir qui ne lui allait pas, bien qu’il lui appartienne. Pour moi, il se cantonnait au Score, ne pouvait être nulle part ailleurs, le reste lui était étranger, insultant, putain de toi, comme si le paysage, les objets, les vivants autour de lui crevaient nécessairement dès qu’il franchissait, ivre mort, en rampant, la porte du PMU. Michel, assis au Score contre la plante usée, nulle part ailleurs.
Les pompiers ont commencé leur affaire, ils ont sou- levé Michel comme un petit chat, ont bousillé son inté- rieur en le transportant jusqu’à la porte d’entrée. Image dégueulasse, Michel, fin et fluide, dans les bras gonflés des pompiers. Son peignoir a glissé, j’ai aperçu ses jambes nues, ses genoux, son sexe, sa nudité, j’ai eu mal, face-à- face non consenti avec son anatomie, souffrance de voir sa bite que j’aurais aimé ne jamais rencontrer. J’ai été brutale avec les pompiers, putains de pompiers, je leur ai demandé du respect pour Michel, du respect svp, sa carcasse, sa pudeur, de maintenir cachées les extrémités de son corps. J’ai eu honte pour Michel. S’il avait été présent, il se serait buté illico. Il ne faut jamais voir les morts, c’est une insulte à ce qu’ils ont été. Michel, sans son manteau bleu, était l’équivalent d’un nique ta mère, un crachat sur sa naissance.
Tom a été réquisitionné par les pompiers, il est descendu avec eux. Je suis restée seule dans la piaule de Michel, avec ses objets, la démonstration évidente de sa précarité, sa vie de merde, et Brassens qui tournait toujours comme pour se moquer de lui, de moi, de cette scène atroce, putain de moi. Les larmes sont montées, bercées par la musique, l’image de Michel réduit à l’état de paquet. Je me suis assise sur son petit canapé, j’ai pris ma tête entre mes mains, Brassens, toujours, continuait à tourner, la chanson reprenait éternellement, j’étais incapable de l’arrêter, de bouger, d’entreprendre ne serait-ce que l’action de sécher mes larmes, le tragique de la situation et la joie sonore embrouillés dans le salon de Michel, et mon deuil qui s’installait, commençait à se faire sentir, le sentiment que la mort de cet homme, dont la voix m’était inconnue, dont la forme des mains m’était inconnue, serait difficile à vivre. Le Score, sans Michel, serait difficile, hostile, de nouveau pollué d’hommes tendus, étrangers à la tendresse, réfractaires à la douceur. C’était donc ici que vivait Michel. Dans cette piaule d’étudiant, d’esclave, sans bouteilles éparpillées sur le sol, aucune trace de son alcoolisme dans son intérieur. Je découvrais que Michel tenait à boire dehors, à sortir pour se tuer, forme de conquête de lui-même, de libido décalée. L’addiction, au contact de l’autre, forcé- ment plus justifiable. Le besoin d’avoir Tom pour lui indiquer ce verre de trop qu’il ne pouvait mesurer seul. Sans Tom, son signe de la tête, des années de vie rognées, une mort prématurée, pas de serviettes échangées. Michel tenait à boire au Score, même si ce PMU était un endroit sale, peuplé de boloss intenables, il tenait à sortir de chez lui pour boire et exister ailleurs. Bras de fer avec lui- même.
Au milieu de l’unique pièce à vivre de Michel, je visualisais désormais ses retours chez lui après le der- nier verre. Les trois étages à gravir, la porte en bois à pousser, son manteau bleu à enlever. J’imaginais Michel, avachi sur ce canapé sur lequel j’étais moi-même écroulée, humilié par sa démesure, rencontrant le coma qui suivait nécessairement l’absorption de poison, mais toujours éduqué, pas de pisse sur son unique accoutre- ment, aucune trace de merde sur son froc, l’identité foncièrement blanche de son addiction, l’absence de bordel de son alcoolisme, Michel et sa chasteté inégalable, comme une lettre scellée, gardée pour soi.
J’étais là, inconsolable, sur le canapé de Michel, hantée par l’image entêtante de son sexe fragile, son corps mort comme celui d’un cloporte, recroquevillé sur lui-même. C’est alors que j’ai levé la tête, regardé pour la première fois au-dessus de moi, comme pour m’en remettre aux murs, aux fondations, à n’importe quelle accroche tangible autre que le corps fini, à jamais terminé de Michel. Partout, accrochés aux murs, mes dessins. Certains encadrés, d’autres précautionneusement accrochés, les coins maintenus dans des couvre-coins, le tout disposé avec une attention particulière, un soin d’homme vierge. Mes dessins, partout, envahissants comme du lierre vert pomme sur une façade grise, fluorescents sur la petite surface des trois murs de Michel, tous mes dessins collés comme une immense fresque, reliés les uns aux autres, sa piaule inaudible tant mes esquisses prenaient le dessus, envahissaient l’espace, ne laissaient plus d’air, plus de respiration. Comme un autel platonique. À lui, à moi, je ne sais pas. Ses visages du matin, comme des croix au mur d’une cellule, la trace des jours accumulés, du confinement traversé ensemble, supporté à deux. Michel vivait entouré de mes portraits. Michel vivait au milieu de lui-même.
Je reconstituais Michel sur son canapé, à treize heures, ivre mort, regardant vers le haut, les étoiles, son plafond, mes portraits. L’image était flippante. Michel, décor parmi le décor, tout petit face à ma fresque, l’étendue de nos échanges, tous similaires, les portraits étaient tous les mêmes, ne changeaient que certains angles en fonction de l’orientation des bras de Michel, de l’inclinaison plus ou moins prononcée de son buste : son degré d’alcoolémie au moment du dessin. Mes larmes ont arrêté de couler. J’ai bondi du canapé, franchi le seuil de l’appartement, descendu à toute vitesse l’escalier. Tom était devant l’im- meuble, en train de raconter aux pompiers que Michel n’avait pas de famille, pas d’enfants, pas de vie, découvrant qu’il était soudain assigné au rôle de pair, apprenant qu’il en faut peu pour devenir la famille de quelqu’un, qu’il suf- fit d’éplucher une clémentine à un homme, lui refuser une bière, pour se retrouver en charge de son enterrement.
L’enterrement de Michel a eu lieu quatre jours plus tard, au cimetière Saint-Louis, dans le 15e arrondissement de Marseille. Le Score entier s’y est rendu. Les petits cons, l’ancien patron de maison close, les deux Corses inséparables, le dépressif au chien, l’obèse taciturne, la Russe, Sandrine, Tom et Soso. Les costumes noirs donnaient l’illusion que les hommes étaient grands. Les femmes boitaient à cause de leurs escarpins. Personne n’a fait de discours, personne ne savait quoi dire. Le masque de rigueur était porté sur le menton. Le prêtre a fait ça à la cool, il a lu ses textes tranquillement, a bu du pastis avec nous, taché sa soutane, roté après le repose en paix. Au moment de glisser quelque chose dans la tombe, j’ai hésité à fourrer un portrait de Michel que j’avais fait la veille, de mémoire.
J’ai renoncé à ce dernier cadeau, mes dessins l’avaient suffisamment hanté, j’ai eu envie de lui laisser un peu de répit, de le laisser décuver avec les vers et les taupes, péter un coup, digérer sa mort. On a tous lancé un peu de terre, dit amen, l’affaire était réglée. Le bus n’est pas venu, Covid ou pas Covid, les bus ne viennent pas à Marseille.
On a marché, puis Soso est venu nous chercher avec son camion blanc pour nous ramener au Score. Il y avait des pornos dans la caisse, des traces de doigts sur les vitres. Personne n’a posé de questions. Nous sommes arrivés au Score, Tom a baissé le rideau et nous a enfermés. On s’est bourré la gueule, j’ai bu autant que les cons, autant que la Russe, des mélanges infâmes, j’ai enchaîné les bières à la mémoire de Michel, de sa descente de pitre, sa mort de merde, pour tous ces mots qu’il m’a écrits, les dessins que je lui ai offerts, on a mis du Brassens, du Johnny, du Didier Barbelivien, des musiques à chier et géniales, dansé dans les bras disponibles, c’était joyeux et véritable, parfois, les cons arrivent à l’être. Les frères corses m’ont enlacée, fait tourner sur une musique honteuse, tapoté l’épaule, presque souri. Seul Soso gardait son expression tendue, son port parfait de salopard. À un moment, la Russe, pétée, s’est approchée de moi. Elle m’a demandé si j’avais baisé Michel. Plus précisément, elle m’a dit cette phrase :
— Alors, tu l’as eu ?
Je n’ai pas eu Michel, non, connasse. Sa question m’a rappelé que les instants gracieux ne durent jamais long- temps dans les PMU, c’est là que se loge la perversion de ces lieux, ils te font croire, brièvement, qu’ils peuvent t’accueillir, t’étreindre, te consoler, puis te tabassent en une phrase, une seule et unique phrase de merde qui résume bien l’état d’esprit minable de ce genre d’en- droits. La question de la Russe dans ma gueule comme la démonstration parfaite qu’il ne faut jamais fantasmer sur les murs où l’on s’empoisonne à plusieurs. Poétiser un lieu que l’on quitte en rampant, où l’on pose des questions cruelles, est d’un degré sophistiqué de cynisme, tout ça c’était de la merde, j’ai eu envie de lui cracher à la tronche, de lui dire d’aller bien se faire foutre, se faire entuber chez les moines, se buter la tête contre les chiottes ; j’étais violente : heurtée. J’ai été rattrapée par la vision des yeux de Michel, mouillés, généreux, yeux de clebs, suppliant de ne rien faire, de rester calme. Je n’ai pas répondu à la Russe, me suis simplement écartée d’elle et assise à la place de Michel, à côté de la plante usée, vrai spot, préservé du bordel, vue d’ensemble sur l’activité du Score. Michel était un voyeur.
J’ai regardé les autres danser, écouté pour la première fois les paroles de ces raps de bar sur lesquels on se trémousse et saute – « SI T’ES UNE MICHTO, VIENS M’VOIR DU CASH J’EN AI / PAS BESOIN DE PILULE DU LENDEMAIN, J’TE CRACHE DANS L’NEZ / FAIS-MOI
À MANGER » –, je pensais au vocabulaire de la poste, cochon et incisif, avec lequel Michel avait dû composer, aux paroles suintantes des raps qu’il avait dû subir ici, chaque matin, par principe : celui de toujours s’enivrer dehors, jamais chez soi. Michel et sa discrétion, son raffinement, condamné à tiser sur du Booba, c’était comique, affreux. J’ai écouté les merdeux raconter leurs conneries, se vautrer dans le racisme de comptoir, la grossièreté du zinc, tout était si facile, si fluide, absous de calculs, de réflexions, de pensées. Je ne leur en ai pas voulu. Je les voyais comme des êtres impossibles à délocaliser, des hommes qui ne survivraient pas à la fermeture de ce bar, vestiges d’un quartier, Le Score allait se faire racheter, Marseille devenait le QG du bon goût, avec l’arrivée du goût, la fin des petits merdeux. Qui voulait continuer à se suicider à plusieurs ? Marseille se faisait polir, esthétiser, raser, ma ville devenait chauve. Qui jouait encore au tiercé ? Qui écrivait encore des lettres ? Il m’est venu à l’es- prit que j’avais rêvé de Michel, qu’il était le fantôme d’un quartier communiste. D’un combat qui n’existait plus.
Je suis rentrée chez moi, ivre morte, encore terrifiée par la découverte des dessins aux murs, en colère contre la Russe, À toutes les filles, de ce connard de Barbelivien, impossible à virer de ma tête. Le trop-plein d’alcool ne m’a pas empêchée de rêver. Un rêve érotique. Michel et moi en têtes d’affiche. Ce n’était ni au Score, ni dans sa piaule, c’était en pleine Canebière, nous baisions comme des bêtes, les gens passaient autour de nous sans prêter grande attention au choc de nos corps, habitués au chaos de la rue, au coït du pavé, aux odeurs de peaux du trottoir, au foutre dans le caniveau. Michel était debout, face à moi, encore habillé, son manteau bleu, son écharpe rouge, seul son froc baissé, son sexe était immense, aride comme le climat, impossible à manipuler. Nous étions vautrés sur le sol, écrasés l’un sur l’autre comme deux moustiques- tigres en plein tamponnage, nous n’étions rien face à Marseille, elle vivait plus que nous, suait plus, gueulait plus fort, comme une folle, une désespérée, personne ne faisait gaffe à notre chorégraphie, baiser dans la rue, ici, c’est pareil que cracher, une présence, un marquage au sol, une intensité parmi d’autres. Les vieilles daronnes nous enjambaient sans sourciller, un groupe de juifs orthodoxes a failli se casser la gueule sur le barrage de nos jambes ouvertes, personne ne s’est énervé, nous réunissions tout le monde, une communauté à nous deux. Lui, la plume. Moi, le dessin. Je découvrais un autre Michel, nouveau modèle à croquer, puissant, très chaud, toujours fidèle à sa douceur originelle, ses mains glissaient sur mon corps comme si j’étais un papier fin, un être fragile. Comme si j’avais bu le verre de trop. Michel me pénétrait sans prendre de précautions, sans attendrir l’affaire, en silence, à son habitude, c’est Marseille qui chantait, perdait la tête, prenait l’espace, recommençait son refrain de monstre, chœur de passants, chiens, machines, échos de messe et de salât.
Je me suis réveillée honteuse, sentiment crade, indigne, j’avais dépucelé Michel, je l’avais brusqué, décoiffé, obligé à glisser son sexe dans la fente de mon corps, poster sa semence. Je l’avais jeté dans la ville, son chaos, lui qui s’était maintenu toute sa vie à l’écart des sueurs, sur son trousse-couilles, probablement par peur des peaux, vocation pour la solitude.
Je me suis réveillée mal à l’aise, excitée par le rêve, chauffée par les vapeurs de ce qui allait devenir une affreuse gueule de bois. L’image de nos corps emboîtés refusait de partir comme certains rêves savent pour- tant si bien le faire : s’évaporer dès le réveil, par pudeur, respect pour les protagonistes débridés malgré eux. Horrible dessin de notre étreinte, inadmissible, je voulais retrouver Michel, mon modèle sage aux jambes croisées, l’homme de lettres raffiné, son manteau bleu, son écharpe rouge, sa moustache désuète, son air de ne pas y toucher, ses lettres butées et son silence. J’avais cochonné notre lien, griffé ses épaules, collé ma jeunesse, ma vitalité sur un homme blanc, impénétrable. J’avais souillé Michel, Marseille, le confinement, la poste tout entière, les ruelles du quartier. Pour le retrouver, il ne me restait qu’à relire ses mots, précautionneusement gardés dans la boîte à chaussures. Ils étaient bien là, à côté de mon lit, ma pile de serviettes, les phrases de Michel ou celles qu’il avait pompées à d’autres, géniales ou merdiques, je n’ai jamais vraiment su.
La surdité présente de l’absurdité. J’ai longtemps préféré l’un à l’autre.
Voici pour vous venu, que le bonheur existe dans ce qui nous plaît.
L’art ne se gêne pas des ponts qui le traverse.
Déjà j’imagine que le dessin est pareil à la poésie. Sensible, léger, parfois s’enivrant de toutes choses afin de finir son œuvre.
À mieux le faire ce serait être ambitieux,
espérer serait de l’illusion. C’est la magie du spectacle. Il faut s’en satisfaire et ne rien regretter.
Ne quittez jamais vos esquisses des yeux,
elles vous accompagneront jusqu’au bout du voyage.
L’art ne dort pas, les artistes non plus.
La beauté se cache dans l’ombre, là où se perd l’esprit. J’ai terminé d’y croire mais j’ai continué de perdre.
L’artiste travaille l’art ; car l’art ne s’apprend pas ; c’est du génie. Et le génie ne s’enseigne pas.
Tout est lié comme tous vos traits ; vos dessins. Tout se tient. En faire plus serait croire au génie.
Tout est lié comme je viens de vous le dire. Tout comme vos traits et vos œuvres.
L’encre d’un dessin ou d’une écriture.
Consonnes et voyelles nous permettent d’écrire et de dessiner.
J’ai cru vous voir au large, j’ai perdu un dessin.
Il faut que l’atelier de l’artiste ne soit pas envié par ses admirateurs. C’est là tout son talent.
J’ai retrouvé le dessin perdu.
L’égarement se pose sur l’esprit libre ; ainsi s’égarent les artistes.
J’avais écrit des mots que je n’ai pas pu livrer. Peut-être sont-ils morts à la guerre.
Vous êtes arrivée tard. L’horloge ne marchait plus. J’ai attendu.
Écrire, c’est renoncer à dessiner en maintenant la couleur.
La caricature ressemble, trait pour trait, à ce que nous ne voyons pas.
Ces phrases sont celles de Michel, restituées mot pour mot. En les retapant, j’éprouve le sentiment hon- teux d’ouvrir la chambre que nous partagions tous les deux, chambre aux draps impeccables, de relever le rideau métallique du Score, de révéler le secret d’une ville indétrônable, d’un facteur vierge, de petits cons impuissants. En commençant à dessiner Michel, je ne cherchais rien, surtout pas à l’atteindre, plus à tromper ma solitude et mon ennui, remplir ces semaines de réclusion, utiliser mes deux mains gauches, occuper un espace qui n’était pas le mien. C’était Tom qui m’avait poussée à déposer ce premier dessin sur sa table. Les rencontres naissent des temps morts, des dyspraxies, des encouragements des patrons de bar.
Avec la mort de Michel, la fin d’un Vauban communiste. Le Score n’est pas encore racheté, il reste en vie, dernier bastion tenace, humilié au milieu des adresses d’exception, des clients bien foutus, énergiques, pétés de blé. Ils déambulent dans le quartier, défilent comme s’ils étaient notés, attendus au tournant. Ils sont beaux, le savent, s’enlaidissent de cette certitude. Les petits cons crachent sur eux, les inondent de pédés, se lancent dans le vaudou, pataugent dans leur chômage mais conti- nuent à vivre et ne désespèrent pas. Marseille résiste à la gentrification, au bon goût, à la beauté indiscutable. Cette ville défonce toute logique, jamais ne se laisse pénétrer : blanche comme Alger, comme Athènes, vaginique, angélique comme Michel.
Vauban s’amaigrit à petit feu. Je ne pleure plus. Les nouveaux venus ne s’éterniseront pas, ils apprendront trop vite que cette ville les déteste. Il y aura le premier jour du reste de la fin, celui où ils découvriront que cette ville est un monstre, qu’elle empêche tout projet, écroule tous ses immeubles, étouffe les ambitions. Il y aura la première baffe, celle qu’on n’oublie jamais, l’accident de bagnole dont le fautif sortira une arme, le grand jour de mistral qui empêche toute action, la rencontre avec les poubelles, la merde, les rats. Je ne pleure plus. Michel est mort. Je m’accroche à Marseille, son goût certain pour le désordre et son refus d’obtempérer. Jamais l’argent ne la séduira entièrement, il n’a pas le cardio, ne tient pas sa puissance. Marseille ne garde que les fous, les éclatés au sol, les pétés à temps plein, les clairvoyants et les clodos. Ce sont eux, seulement eux, qui établissent les lois et tiennent la descente. Ici, les keums font un mètre cinquante et se caressent l’épaule, les couilles, la fente des fesses à chaque bise. Si l’un d’eux rapporte une clémentine au bar, le groupe entier se jette pour la lui éplucher, lui enlever les pépins. Les gestes sont gratuits, foncièrement généreux, naturellement cruels, extrêmes. La tendresse n’arrive jamais sans le pédé de rigueur. Mais qu’est-ce qu’une insulte ? Les hommes se sauvent la vie.
Les mots de Michel étaient à son image, hors sujet, en deçà des vies et des lieux, chancelants, incompréhensibles. Paroles de taré, de postier qui voyait flou, n’entendait rien, ne parlait pas. Je me suis longtemps demandé ce qui m’avait poussée à dessiner Michel pour la première fois. Pourquoi choisit-on un visage à défaut d’un autre ? Attirance louche, fascination mal placée pour le perdant, l’éternel vierge. On dit que les puceaux ont des traits plus lisibles. Sa gueule comme feuille blanche sur laquelle je pouvais projeter mon ennui mortifère, ma quête pour faire du confinement une expérience fructueuse, valable, racontable, une toile à exhiber. J’avais contemplé Michel, chaque jour, s’enivrer un peu plus, franchir des caps, se niquer la race, sans jamais essayer de l’arrêter, passive devant sa mort certaine, en essayant pourtant de l’em- mener ailleurs. Je ne comptais pas sur lui. Il comptait sur moi. L’alcoolique est celui qui a besoin de l’autre pour lui indiquer le verre de trop.
J’ai aimé Michel comme on aime parfois des gens que l’on se refuse à toucher, à sentir, à entendre. Je ne connais- sais ni son odeur ni la tonalité de sa voix et ne cherchais pas à les connaître. Je savais qu’il était puceau à la manière dont il posait précautionneusement ses serviettes gravées sur ma table, me regardait sans me prendre, à sa pudeur adolescente, ses mains cachées dans son long manteau bleu et sa mort attendue. Michel s’est tué à petit feu, à la recherche du verre de trop, qu’il a fini par trouver seul.
Découverte jouissive, point culminant atteint, fin méritante. La mort allait bien à Michel, du moins un peu mieux que la vie, sûrement n’était-il pas fait pour elle, pour l’éprouver, la ressentir. Par vivre, j’entends parler, lécher. Michel s’est tué. Chez les hommes, suicide et virginité sont souvent liés. Michel s’est suicidé en écoutant Brassens, au milieu de mes dessins, habité par un nombre incalculable de courriers, lettres de rupture, pubs pour des serruriers et des volets cassés, avis d’imposition, lettres d’insultes, programmes politiques de blondes peroxydées, lettres gondolées par des clefs, des gros chèques, des godes, des échantillons de sable. Michel avait été le postier en charge d’un quartier marseillais dont les habitants vivaient en autarcie, certaines lettres lui étaient revenues, il avait dû tuer ce courrier. Parfois, il gardait dans sa piaule un mot perdu au destinataire introuvable, se prenait pour ce destinataire, finissait par y croire, pensait presque à répondre. Sa sexualité se logeait dans le plan de cette lettre. Il l’écrivait, ne l’envoyait pas. Michel est mort sans connaître la chair, son gouffre et ses ivresses. Il connais- sait l’excitation. Mes dessins accrochés à ses murs comme la trace de ses branlettes introverties.
Les mots de Michel sont à côté de mon lit. Il m’arrive de les lire et de m’y réfugier. Je rêve encore régulièrement d’une étreinte avec lui. Le rêve est moins tordu que celui que j’avais fait la nuit de son enterrement. Maintenant, Marseille ne prend plus tout l’espace, le décor est neutre,
nous sommes les seuls protagonistes. Je déshabille Michel, très lentement, j’enlève son manteau bleu, fais glisser son écharpe rouge, les yeux de Michel se mouillent, Michel aimait les gestes des autres, il comptait sur ces gestes. L’excitation est là, nous chialons tous les deux. Les vêtements de Michel peinent à se retirer, ils s’éternisent sur sa peau, résistent légèrement à mon déshabillage, comme s’ils s’insurgeaient ou refusaient l’école. Chacun de nos mouvements est long, voire éternel. Ni lui ni moi ne nous impatientons. Nous sommes attentifs, respectables. Nous ne sommes pas exhibitionnistes. Nous ne cherchons pas à choquer. Il n’y a pas de vieilles daronnes ni de juifs orthodoxes pour nous marcher dessus. Nous sommes seuls, enfin nus, mais nos sexes sont introuvables, seules nos mains sont visibles, celles de Michel sont belles, je les découvre enfin, mains de lettré, de facteur, d’homme latin épuré, épluché de ses vices. Une fois sur cent, Marseille donne naissance à un homme comme celui-là. Le lit est confortable. Je laisse à Michel la meilleure place. Il me remercie en silence.
Le Score est un PMU miteux dans une ville de rap- ports de force, de soumis contre dominants, d’arguments foireux et de misère sentimentale. Michel est mort la veille du déconfinement, le 10 mai 2020, à six heures trente-sept du matin. Marseille vivait encore, bien que contrainte et ligotée. Les bars continuaient à tourner, les flics se défonçaient la race au même comptoir que les frappes. C’était un jour parfait : soleil urine, ciel OM, les rues étaient humbles, répit général, les hommes ne frappaient pas leur femme. Les vieux guettaient leur boîte aux lettres, dans l’attente d’un courrier qui peinait à venir. Les nouveaux riches du quartier étaient enfermés dans leur immense baraque, masqués et apeurés par le contexte morbide. Leur couple était détruit par ces deux mois de peau à peau. Les femmes avaient perdu du poids, les hommes pris du bide. Les cassos du Score s’en sortaient mieux, grande vie au comptoir, ils riaient, hurlaient, se caressaient. Marseille était sexy, complète- ment hystérique, démesurément généreuse, envie totale de gâter ses marmots jusqu’au dernier jour, leur en mettre plein la vue, le bec et les oreilles. Elle avait fait du confinement un récit absurde, un échange de serviettes, un règlement de comptes avec la France.
Marseille m’a raconté Michel, timidement. J’ai appris avec elle que rien n’est plus pudique qu’une confession intime.
À la mémoire de Michel, qui m’a fait découvrir la sensation, collante, très chaude, d’être émue par un homme.
Titres parus
N° 1 — T9, Blandine Rinkel
N° 2 — Au pays de la bouffe, Mathieu Palain
N° 3 — Le premier cri, Abigail Assor
N° 4 — Ego Hugo, Arthur Dreyfus
N° 5 — La nuit Cayenne, Victor Dumiot
N° 6 — Le dernier twist, Frédéric Perrot
N° 7 — Entre les bruits du monde, Laura Poggioli
N° 8 — Les mots sont patients, Maylis Besserie
N° 9 — Entre chienne et louve, Julia Malye
N° 10 — Tu connaîtras la peur, Salomé Berlemont-Gilles N° 11 — L’odeur du sapin, Alexandre Galien
N° 12 — Le prix de la journée, Nadège Erika
N° 13 — Cath, Léna Ghar
N° 14 — Bolaño, Macron et moi, François-Henri Désérable N° 15 — Le point de félicité, David Fortems
N° 16 — Omerta, Alice Develey
N° 17 — Couleur Stanislas, Rachel M. Cholz
N° 18 — Tuer le courrier, Esther Teillard