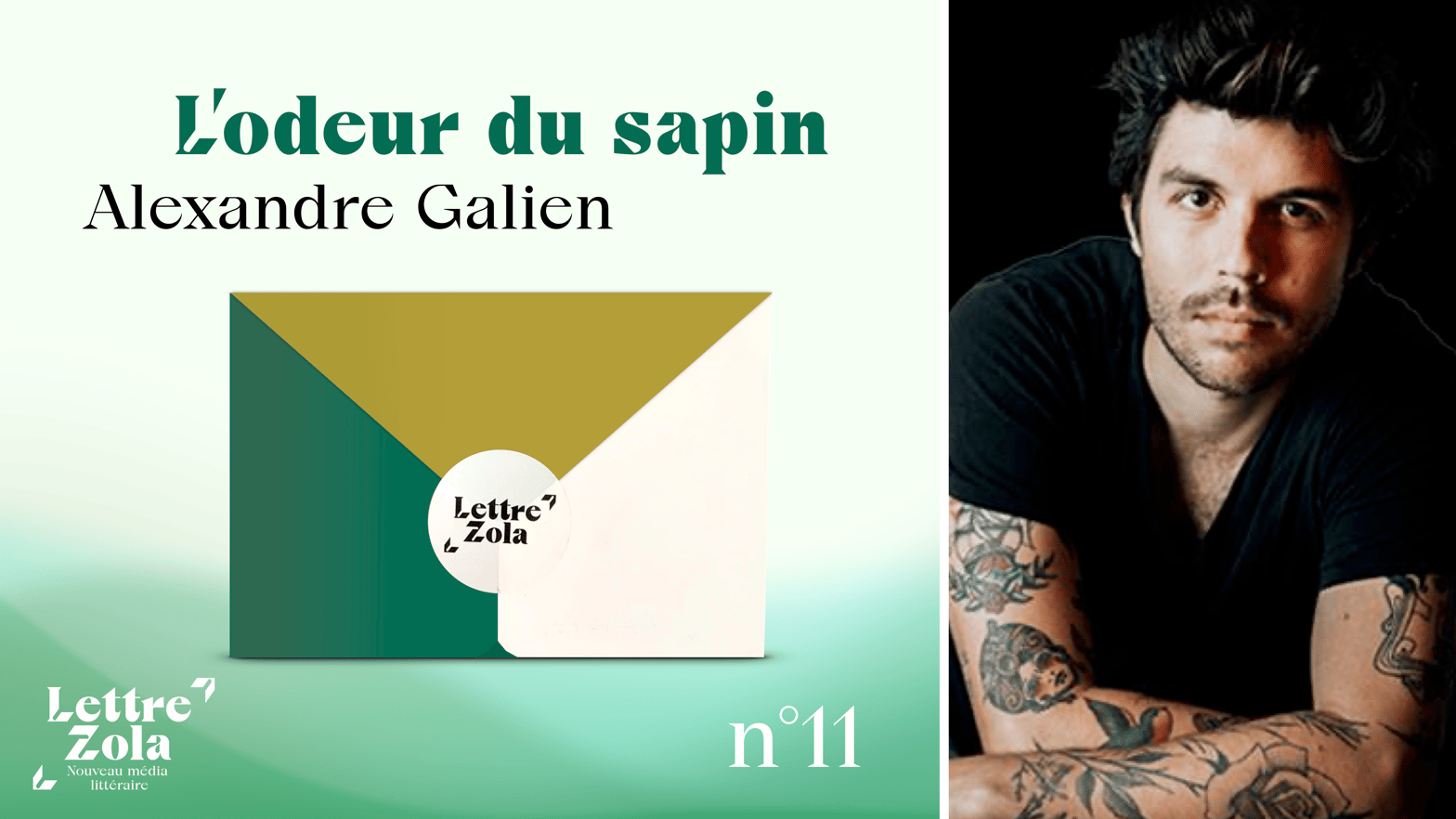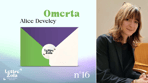L'odeur du sapin, Alexandre Galien
Lettre Zola n°11 - décembre 2024 « Je m’apprête à réveillonner avec ma famille catholique conservatrice. Une nuit étouffée, face aux mauvaises consciences que l’on purge au champagne et aux secrets lardés entre deux tranches de foie gras. Mais cette fois-ci, le secret est accablant et entache la mémoire de mon père... Si j’arrêtais de me taire ? »



1
Dans le métro, je triture mes mains. Un tic nerveux qui ne me quitte plus depuis qu’il est mort. Je parviens parfois à m’en débarrasser à la faveur d’une bière en terrasse, ou d’une conversation agréable. Là, il n’y aura ni l’une ni l’autre. La ligne 8 est stridente, elle me hurle dessus, bringuebale des voyageurs endimanchés, les bras chargés de paquets. Le 24 décembre, à partir d’une certaine heure, Paris est divisé en deux : il y a ceux qui vont passer le réveillon en famille et ceux qui sont seuls. Chacun a envie d’être l’autre. C’est grossier, vulgaire, déplacé, et il y a un tas d’autres adjectifs pour qualifier le fait de vouloir être à la place de ceux dont le cœur ne reçoit pas assez de chaleur pour qu’elle soit partagée le soir de Noël, de ceux qui travaillent parce qu’ils n’ont pas le choix, de ceux qui ne vont pas se gaver de champagne et de petits fours, ni déballer des paquets de la Fnac pour y trouver le dernier Goncourt ou un kit « apéro sympa » avec une guillotine à saucisson. Pourtant, chaque couple, chaque individu sur son trente et un semble en route pour l’échafaud.
Le dernier Goncourt ou la trancheuse à saucisson ont un prix. Un oncle libidineux qui reluque un boule au détour d’un passage à la cuisine, une ou deux remarques racistes, de l’inquiétude pour l’avenir de notre génération de la part d’un beau-frère qui fait des Paris-Strasbourg en avion et qui se déplace en SUV dans la capitale. Parfois, une grand-mère baveuse, que l’on a gentiment extraite de son Ehpad pour qu’elle s’enfile un ou deux marrons glacés, et dont tout le monde attend l’héritage en la couvant d’un œil plein de compassion et d’impatience.
Je sais, pour ma part, que je suis un vecteur de bonne conscience : « Parce qu’on ne va tout de même pas le laisser tout seul à Noël... » ; et ils devaient se dire la même chose pour Henri-Louis, mon père, avant qu’il ne casse sa pipe il y a sept ans. Nous étions, et je suis, ce que j’aime appeler des clocharistos. Dans l’arbre généalogique de l’une des plus vieilles familles parisiennes, nous étions la branche tordue, la seule sur laquelle ont le droit de se poser les pigeons qui ont un œil crevé, celle qui ne fera pas de bois noble ; au mieux, quand elle sera définitivement tombée, on la lancera à un braque allemand qui s’en amusera avant d’aller se lécher au coin du feu, dans la maison de Sologne.
Évidemment, à la lecture de ce paragraphe larmoyant, vous vous dites sûrement que notre vie était merdique, que nous étions des transfuges inférieurs, relégués au quatrième plan par d’affreux Thénardier. Nous avions pourtant quelque chose qu’aucun d’eux ne pouvait avoir. Chaque 24 décembre, nous allions nous asseoir bien
gentiment autour d’un chapon trop sec, mon père essuyant des remarques de mes oncles, et moi qui faisais comme si je ne comprenais pas qu’il s’agissait d’une humiliation. Puis, après avoir déballé un agenda en cuir siglé du nom du journal dont le mari de ma tante était administrateur, et un réveil France Télécom, boîte au comex de laquelle siégeait une autre de mes tantes, après que j’avais fait mine de m’extasier devant je ne sais quelle trompette en plastique, jeu de mikado ou toute autre merde qu’on offre à un gamin entre six et douze ans, les clocharistos retrouvaient leur liberté. Pauvres, mais libres. On grimpait à bord de sa Renault 21 hors d’âge, et Paris était à nous. La voiture était un vaisseau spatial, mon père un super-héros aux ongles rongés par l’angoisse, et les lumières défilaient. C’était toujours le même trajet, depuis l’appartement cossu du viie arrondissement où avait lieu le réveillon. D’abord, la Concorde, illuminée, puis les Champs-Élysées et leurs dizaines de guirlandes aux couleurs magiques qui se reflétaient dans mon regard d’enfant, et que je revois encore aujourd’hui, quand je ferme les yeux. Il mettait une cassette de jazz, ou d’un groupe de pop pour enfants selon son humeur, et j’écoutais ronronner le moteur autour du rond-point de l’Étoile, puis l’avenue de Wagram, le parc Monceau et, enfin, la place de Clichy. On s’arrêtait au Quick, et c’était mon vrai repas de Noël.
On y avalait des hamburgers, et mon père singeait ses frères et sœurs, passait sous silence certaines conversations privées qu’il avait eues avec mon grand-père pendant que je jouais avec mes cousins. Il faisait toujours en sorte que je rie, et lorsque nous rentrions dans le petit hôtel où il habitait, dans une ruelle un peu glauque entre la place de Clichy et La Fourche, il me faisait garder cinq minutes par le réceptionniste, un Marocain d’une cinquantaine d’années qui m’appelait « fils ». Il montait, vérifiait si personne de menaçant ne traînait dans le couloir de ce une-étoile d’un quartier interlope, allait ouvrir notre chambre et me préparait ma surprise. Lorsque je remontais, il y avait un sapin – il y mettait un point d’honneur –, tordu à sa cime parce que la chambre était mansardée. Ça clignotait de toutes les couleurs, et ça avait la même odeur que chez les riches. Au pied, un immense paquet recelait, selon mon âge, une console de jeu, un jouet Star Wars, ou le dernier Power Ranger. Mais quoi qu’il arrive, un beau cadeau, pour lequel il s’était ruiné sans que j’en aie conscience. Ces Noëls ont été les plus beaux de ma courte vie.
Il est mort comme il a vécu, rapidement et sans être aux crochets des autres. Dans un foyer pour jockeys, palefre- niers, entraîneurs de chevaux aux destins brisés, au fin fond de l’Oise, près des pur-sang qu’il aimait tant, à qui il devait sa liberté, à qui je dois la mienne, et qu’il pouvait embrasser tous les jours. Il est parti vite, l’âme tourmentée mais la fierté intacte. Depuis, je retourne chaque année faire face à ce simulacre familial, parce que je sais qu’ils le détestaient et qu’ils me méprisent, comme ils se détestent et se méprisent entre eux. Pour ces raisons, ils ne se voient qu’une fois par an, et souvent, je suis là le premier et pars le dernier, gardien de sa mémoire, pour que personne ne s’aventure à dire du mal de lui. Je suis un roquet silen- cieux, inconnu au bataillon les 364 autres jours de l’année. Mais présent pour qu’aucun de ceux qui nous détestent ne s’avise de cracher sur son nom. Le soir de Noël, je suis un monument aux morts, gardien de tous les secrets qu’il m’a livrés lorsque sa santé déclinait.
Il y a aussi celui que j’ai découvert par moi-même, qui rend mes mains plus nerveuses encore que les autres fois ; à cause duquel je m’apprête à gâcher la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Dans une famille catholique, c’est sacrilège de toucher à Jésus ; et pour mon oncle, les ambassadeurs du Christ, si indignes soient-ils, jouissent sans entrave de l’immunité diplomatique.
2
C’est idiot, une notification. Ça s’invite sur un écran de téléphone portable, ça vient gâcher un fond d’écran choisi avec soin, une photo de vacances, un selfie, une citation de Ben si on n’est pas sorti de chez soi depuis 2012. Il y a les évidentes, celles que l’on attend quand on aime ou quand on espère, un prénom à côté d’une petite bulle verte qui annonce des lendemains en caractères Times New Roman, avec pour les plus expressifs un petit émoji, pour les plus taciturnes un point d’exclamation qui vaut tout l’or du monde. Celles que l’on craint, le nom de son manager quand on a loupé le réveil, le rappel hebdomadaire d’une position de compte bancaire, un mail d’huissiers ou d’une obscure caisse de retraite complémentaire. Celles que l’on ignore, en provenance de médias divers, qui, com- pilées sur un écran, donnent parfois des choses drôles à lire, comme le jour où j’avais reçu en même temps une interview d’Éric Zemmour et un article médical sur le syndrome du côlon irritable. En général, quand elles ne concernent pas un nouveau syndrome sociétal ou une maladie du côlon, je les ignore ou les lis en diagonale. Celle-ci, allez savoir pourquoi, m’a sauté aux yeux. « Affaire Mgr Humbert : les faits prescrits renvoyés au civil ». Humbert... Humbert... le nom me parlait, sans que je sache trop pourquoi.
Je me faisais toujours secouer comme une piñata sur les sièges baquets de la ligne 8. J’ai une mémoire d’huître, alors quand je tâche de me souvenir de quelque chose de précis, je fixe le vide. Là, c’était le paquet cadeau que tenait une jeune femme brune. Elle avait des doigts fins, parfaitement vernis, ornés de quelques discrètes bagues qui faisaient comme un lever de soleil sur ses phalanges, sur lesquelles on distinguait un léger duvet – j’ai la mémoire courte, mais une excellente vue. Sur le paquet cadeau, des pères Noël faisaient de la luge. Ils ne conduisaient pas leur traîneau, ça devait être leur jour de congé. Il ressemblait à tous les paquets cadeaux qu’on fait faire à la sortie de la Fnac par des associations comme le Secours Catholique. Un jour, j’y avais croisé ma tante, qui se faisait emballer un cheval à bascule ou une merde comme ça, enfin un truc compliqué à empaqueter de manière propre. Elle regardait se démener une collégienne qui sortait la langue au coin de sa bouche, pour bien s’appliquer. Elle n’avait pas fait de miracles, mais l’œuvre était sans problème recevable sous un sapin du VIIe arrondissement. J’étais resté terré dans un coin, à regarder s’acharner cette adolescente un peu gauche, ça avait duré dix bonnes minutes, et ma tante tapotait du pied.
Quand on lui avait tendu la petite tirelire dans laquelle elle était supposée verser l’obole de rigueur dans ce genre de cas, elle avait regardé la gamine comme vous recevez un Témoin de Jéhovah qui sonne chez vous pendant votre jour de congé, elle avait lâché une phrase du style : « Je donne assez à l’Église comme ça, jeune fille », et s’était barrée avec son cheval à bascule. Et moi, j’adore les chevaux, mais celui-là, je souhaitais qu’il soit indomptable, pour venger la collégienne. Qu’il mette des coups de sabot terribles et des coups de cul quand on monte dessus, qu’il envoie valser le moutard à qui il était destiné, par justice déléguée, en quelque sorte. Mais le moutard, un petit-neveu de son mari, n’avait rien eu, et le cheval était resté docile. Sans doute parce que les chevaux à bascule sont très bien dressés, ou que les moutards comme celui-ci prennent rarement des coups de cul – en montant à cheval ou non, et quand ça arrive, ils sont assez équipés pour que leurs conséquences soient moindres.
Mon père était un gamin comme ça. Ils avaient tous grandi dans un hôtel particulier du xvie arrondissement, rue Singer. Il se faisait rosser par mon grand-père quand il avait de mauvaises notes, parce que c’étaient les années cinquante, soixante, et qu’on considérait sans doute que cette méthode était la bonne. Plus il essuyait de tartes, plus il faisait de conneries. Je pense qu’en réalité, il a servi à l’éducation de ses frères et sœurs. Comme on plante la tête d’un ennemi au bout d’une pique pour calmer les velléités de rébellion des autres. Il m’avait raconté ça un soir, quand il m’avait emmené écouter du jazz. Il avait touché un peu d’argent, et il fallait tout de suite le dépenser pour me faire plaisir. Il m’avait dit qu’au bout d’un moment, les coups ne font plus mal, et que psychologiquement, une fois détruit, on est une lavette. Donc qu’en réalité, ça avait duré toute son enfance, mais qu’il n’avait connu qu’une année de vraie souffrance. Le temps de tout casser. Ensuite, c’était comme du vent qui souffle entre les ruines d’une maison et balaie un volet accroché ; ça faisait flipper, c’était glauque, mais ça n’avait plus de conséquence. Il devait se trouver des îlots de bonheur, des moments de vérité pour échapper à ça. C’étaient les chevaux. Quand il fuguait, il escaladait le mur d’un club équestre du bois de Boulogne, en pleine nuit, et il allait les voir. Des géants de 400 kilos, ombres silencieuses dans un box de paille, au souffle apaisant et à la silhouette puissante, rassurante. Quand l’un d’eux sortait la tête de son box pour prendre un peu d’air frais, il approchait doucement sa main, et la plaçait sur le chanfrein de la bête. C’était chaud. Quand il faisait ça, les chevaux ne bougeaient pas. Aucun. Ça les calmait instantanément, il avait un don pour ça. Y en a, c’est le piano ou les claquettes, mon père, c’était ça. Il parlait mieux aux chevaux qu’aux hommes. Quand la bête était en confiance, il approchait sa tête des narines équines, et posait son nez sur cette peau de pêche à 37,8o C. Le cheval soufflait dans un bruit enveloppant, et parfois quelques gouttelettes humides se posaient sur la peau tuméfiée de mon père.
C’était son moment de bonheur, le seul, d’après lui – avec les filles, mais ça, c’est une autre histoire. Une bulle de douceur qui lui donnait l’énergie de rentrer rue Singer, de retirer le polochon qu’il avait planqué sous son lit, et le lendemain, de retourner rien foutre dans la boîte à bac tenue par des curés où mon grand-père l’avait inscrit. C’était lorsqu’il m’avait raconté l’enfer vécu dans ce collège que j’avais entendu le nom d’Humbert pour la première fois. Il en était le directeur pédagogique.
J’ouvre l’article du Monde, pour en être certain. C’est lui. Évêque, quasi-nonagénaire... Il avait été accusé de pédophilie en 2010, à la faveur du voile qui s’était levé à l’époque sur les ignominies de l’Église. Les faits étaient prescrits, alors il avait échappé à la prison, à laquelle il n’aurait d’ailleurs sans doute jamais été condamné – on aurait préféré y envoyer un type qui a volé une tablette de chocolat. Le jour de l’enterrement, il avait voulu lire un texte. Je ne savais rien de tout ça, et j’avais refusé, parce que mon père n’avait pas de bons souvenirs de ces années. Mon oncle avait un peu insisté : « Tu ne te rends pas compte, c’est un évêque... On ne peut pas vexer ces gens-là. » C’était sept ans après qu’il avait été accusé, puis foutu au placard dans une administration de l’Église où les enfants ne viennent pas jouer à la marelle. Chaque cellule de cette famille est cul et chemise avec sa paroisse locale, ils adorent inviter les prêtres à dîner, et vont au Vatican une ou deux fois par an dans des réunions catholiques. Ils ne pouvaient donc pas ignorer qu’ils allaient faire entrer la parole d’un pédophile aux obsèques de mon père. Leur silence de cathédrale était complice.
3
La ligne 8 s’arrête, Invalides. Je lève le nez, groggy. La fille sort avec ses pères Noël qui font de la luge, tout guillerets. Je descends aussi. Je pense au réveillon qu’elle va passer, dans le même quartier que moi. Les mêmes huîtres, le même foie gras, les mêmes blinis. Les mêmes secrets que l’on ne se dit pas, les mêmes piques entre les uns et les autres.
Les rues sont désertes et noires, il y règne une ambiance glaciale que viennent accentuer les larges fenêtres allumées, derrière lesquelles une lumière chaude et des ombres filantes font se sentir encore plus seul. Je ne devrais plus être dupe, plus imaginer que ce qui se joue derrière ces façades haussmanniennes est forcément moins violent, plus langoureux que ce que je m’apprête à vivre. Ce qui nous pousse à nous dire qu’il n’y a pas, sous les épais tapis des autres, autant de poussière que sous les nôtres est inexplicable. C’est à la fois hors de soi et égocentrique, d’imaginer que tout le monde va mieux que nous, ou que personne ne va aussi mal. Je ne triture plus mes mains, c’est déjà ça. Mes poings sont serrés, mes ongles sont à un cheveu d’entailler mes paumes. J’ai le cœur qui bat comme Mike Tyson qui fait du sac de frappe, mes dents grincent, et j’imagine que mon regard s’est voilé d’un peu de noir.
La lourde double porte en bois se dresse devant moi. J’ai d’abord envie de faire demi-tour. Les envoyer tous se faire foutre, et aller au Quick de la place de Clichy comme on réalise un pèlerinage, comme les paroissiens de Sainte-Rita remontent tous les six mois le terre-plein central de Pigalle, à quelques encablures, pour ramener vers le droit chemin les pécheurs de la chair qui l’arpentent. Le péché de chair aussi est prohibé, dans ma famille. Évidemment, ça n’a jamais empêché les hommes de tromper leurs femmes, et vice-versa. Un jour, j’avais croisé le mari de ma tante qui sortait d’un hôtel, le genre de cloaque qui loue des chambres l’après-midi, avec une fille de trente ans de moins que lui, une grande blonde qui ne ressemblait en rien à son épouse. D’abord, elle était souriante, ensuite, elle avait l’air amoureuse de lui. Et il avait des yeux rieurs, là où je n’avais jamais vu chez lui qu’un sourire de façade qui lui donnait un air constipé. C’est toujours une surprise incroyable, le bonheur qui irradie chez les gens tristes. Quand il m’avait croisé, il n’avait laissé transpa- raître aucune gêne, certain sans doute que je n’allais pas le balancer, ou que de toute manière il était en position de domination économique dans son couple, ce qui lui garantissait quelques passe-droits. Et puis, j’ai toujours fermé ma gueule. Un peu trop, peut-être. En composant le digicode, j’ourdis mes représailles.
Un large escalier, avec des vitraux et un tapis pourpre, assez épais pour étouffer les bruits de pas et les secrets. Je gravis les marches quatre à quatre, la rage au ventre. Ça irait vite. Je vois déjà le truc, je sonnerais et là... Mon oncle, un demi-rictus sur le visage, ouvre la porte de l’appartement de sa sœur. Il s’appelle Jean-Marc, il est passionné de business et de keynotes. Il a une patate chaude dans la bouche, les cheveux gris tirés en arrière, il porte en toutes saisons une doudoune sans manches. Il aime utiliser des mots en anglais, parce qu’il a long- temps « bossé aux US ». Rien ne lui fait plus plaisir que de serrer la main d’un évêque. C’est par lui que je commence. Il se penche pour m’embrasser, je lui tends une main gantée de distance. Courageux, il ne relève pas et m’invite à entrer. Je pénètre dans le salon cossu, dans lequel des canapés invitent à s’écrouler et à disparaître. Le sapin est haut, sa cime n’est pas tordue car ma tante et son mari ont un duplex et pas une chambre d’hôtel glauque, au travers des murs de laquelle on entendait parfois quelques râles, ce qui obligeait mon père à me faire dormir avec des boules Quies. Il y a des coupes vides sur la table et une bouteille de champagne dans un seau à glace. Mes deux cousins et ma cousine sont là, debout avec un toast au foie gras dans la main. Il y a des cadeaux au pied de l’arbre. Nous ne sommes qu’entre adultes, mais les traditions ont la vie dure – je reconnais le papier dans lequel la gamine du Secours Catholique a emballé le cheval à bascule il y a deux ans ; ils n’ont rien d’écolo, mais ils recyclent malgré eux.
Ma tante sort de la cuisine avec un plateau de canapés à la main. Elle est grande et gauche, elle a le même regard triste que mon père, seulement il est voilé de dédain. Elle a le physique de quelqu’un qui n’a pas eu de choix à faire.
Rien n’est abîmé chez ces gens-là, à part peut-être un peu de moraline. Le plus vieux de mes cousins a l’air ravi de me voir, je l’aime bien, il est moins mou que les autres. Il a une tête de requin, mais de l’esprit. Et ça manque cruellement lors de ces soirées. Lorsqu’il est dans la pièce, je me raccroche à lui, ça me calme de pouvoir faire quelques blagues qui ne s’évaporent pas.
Je m’approche de Coralie, ma tante, pour lui accorder une bise bourgeoise. Alors que je l’étreins sans amour comme son mari doit le faire tous les six mois, je la retiens une seconde et lui glisse à l’oreille : « J’ai mis du temps, tu sais, mais j’ai compris pour le père Humbert. Compte sur moi. Vous allez le regretter, et ça commence ce soir. » Et j’attrape un canapé au foie gras en me ruant dans le sofa. C’est imperceptible pour les autres, mais je vois ses bras se bander sous son pull en cachemire. Je lui lance une œillade, elle semble perdre pied, pose rapidement le plateau sur la table du repas. Son mari, en manspreading sur le canapé d’en face, tourne lentement la tête vers elle. « Mais enfin, Coralie, pose donc ça sur la table basse. » Elle n’écoute pas et part dans la cuisine comme si une guêpe venait de lui piquer les fesses. Sur le chemin, elle appelle son frère : « Jean-Marc, tu peux venir m’aider pour les huîtres ? » Je les imagine en panique, en plein conciliabule à côté du plateau de fromages, au milieu de l’odeur des girolles qui reviennent dans la poêle. On me sert du champagne, j’attends qu’ils sortent. Jean-Marc a un peu perdu de sa superbe, on le croirait à la fin d’une réunion chez Goldman Sachs en 2008. Il me fixe méchamment, je vide ma coupe d’un trait sans ciller, « Tu bois vite... », « C’est pour me donner du courage ». Personne ne relève, à part mon cousin un peu drôle qui lève un sourcil.
Dans une petite assiette, il y a des pruneaux enroulés dans du lard. Jean-Marc en attrape un. Le mari de ma tante, celui qui est amoureux pendant ses pauses déj’, se lance dans une grande litanie sur le paysage politique. Sa fille et mon autre cousin boivent ses paroles, la femme de Jean-Marc regarde dans le vide, elle doit calculer la durée écoulée entre son dernier Xanax et sa deuxième coupe. Jean-Marc mastique un pruneau avec violence. Il ne me quitte pas des yeux, s’il avait un tant soit peu de courage, j’aurais peur qu’il ne veuille me casser la gueule. Ses mâchoires, sous une légère couche de gras, décrivent un mouvement circulaire parfait. Si le vieux beau à ma droite n’était pas en train d’expliquer qu’un vote socialiste ferait résonner les chenilles des chars soviétiques sur les Grands Boulevards, on entendrait crisser les dents de mon oncle. Ma tante, dans un ultime réflexe de survie, ouvre le tiroir central d’un petit secrétaire Empire qui, me semble-t-il, appartenait à mes grands-parents sans jamais avoir été intégré à la moindre succession. De toute manière, on n’en voulait pas. Mon père détestait la poussière quand elle n’était pas soulevée par des sabots, dans une carrière, ou qu’elle n’était pas révélée par des rayons de soleil filtrant à travers la vieille tôle d’un manège où l’on délasse un pur-sang.
Elle farfouille en jurant, ça fait un bruit de breloques : « Mais où est-il ? » Ses gestes sont gauches, c’est jubila- toire. On dirait qu’elle cherche un remède à toutes les emmerdes qui vont s’abattre sur son chapon. « Ah, ça y est ! », et elle brandit son appareil photo numérique. Bien joué, elle veut immortaliser une ambiance déjà lourde, mais pas encore obèse. « Rapprochez-vous. Jean-Marc, mets-toi entre tes deux fils. Sidonie, va t’asseoir à côté de ton père. Toi... Reste là où tu es, surtout ne bouge pas. » C’est trop beau, je ne peux pas louper cette occasion. Le Monde est posé sur un guéridon. « Attends, j’ai une tache sur mon pantalon, je vais la cacher... Il vaut mieux dissimuler les taches. » Ses jambes se crispent, elle a l’air de serrer les fesses. Je me saisis du journal, le feuillette une seconde, tombe sur le long article qui raconte l’affaire Mgr Humbert, et pose le canard sur mes genoux. Tout le monde sourit, personne n’est heureux, le déclencheur fait un bruit d’imprimante. Je me penche vers Jean-Marc : « Maintenant qu’il est immortalisé, on va rendre ce réveillon inoubliable. »
4
Le plan de table d’un repas de Noël s’apparente à une science. Il faut placer les gens de manière à ne vexer personne, positionner les plats de pommes de terre sautées au centre, pour que chacun y ait accès sans difficulté, laisser la cousine souffrant de troubles alimentaires dans un coin qui lui permettra d’abandonner le contenu de son assiette au bichon maltais de la maison – un roquet à l’œil doux et au poil rêche, qui n’a en lui ni méchanceté ni intelligence – sans que personne s’en aperçoive. Cette année, ils doivent ajouter une inconnue à l’équation : un neveu marginal et revanchard qu’il faut asseoir de manière à ce qu’il soit forcé d’élever la voix pour révéler un secret honteux. On m’a mis en bout de table, à proximité de la cuisine. Coralie, en bonne maîtresse de maison, a pris le parti de n’y engager que des activités bruyantes, destinées à couvrir le son de ma voix. C’est ainsi que, durant tout le repas, elle fera démarrer un blender pour mélanger un obscur sabayon au moment de l’entrée, qu’elle découpera le chapon avec un couteau électrique, ou qu’à la fin, à court d’idées, elle démarrera la machine à laver les torchons qui équipe sa cuisine à îlot central sur la position essorage durant environ une demi-heure.
Jean-Marc, lui, a rapproché une enceinte qui crache le même album de Michael Bublé depuis cinq ans. Depuis qu’il est rentré des States, il estime que Bublé vaut bien Sinatra, pour une raison inexplicable, comme la file d’à côté qui avance plus vite au supermarché, ou la tartine beurrée qui tombe du côté du beurre. Il a également pris place à mes côtés. À chaque parole, il pose sa main sur mon avant-bras dans un geste qui pour les autres peut paraître affectueux, et le comprime de plus en plus fort. Je plante mes yeux dans ceux de ma tante, assise de l’autre côté de la table. Je n’ai toujours pas dit un mot, et ouvre parfois la bouche comme si j’allais le faire, simplement pour les voir se crisper.
Je fixe les mains de Coralie qui décortique une crevette avec brutalité. Elle arrache la queue d’un geste ferme, enserre la tête un peu trop fort entre son pouce et son index pour procéder à la décapitation – un peu de jus coule le long de ses doigts qui n’ont jamais travaillé. Elle la pèle si violemment que ses ongles se plantent dans la chair blanche du crustacé, sur qui elle passe ses nerfs. Dans ce cercle, c’est une tradition de passer ses nerfs sur les êtres qui n’ont rien demandé. Chacun à son échelle, évidemment. Je soupçonne que Jean-Marc s’en prend à ses N moins je sais pas combien en leur donnant des leçons un peu humiliantes, Coralie
torture des crustacés et piétine la fierté d’adolescentes bénévoles du Secours Catholique, mon grand-père collait des trempes à mon père pour oublier que sa carrière militaire n’était faite que de médailles en chocolat, et Mgr Humbert touchait des pénis d’enfants. Chacun son truc. Je suppose que Raymond, le bichon maltais, doit essuyer quelques torgnoles quand ça leur chante.
Au moment où un plat de marrons passe sous mon nez, Jean-Marc se penche vers moi : « C’est plus compliqué que tu ne le penses, tu sais ? » Je ne dis rien. S’il s’est mis à jaqueter, c’est qu’il a des choses à dire. Je prends un peu de purée à laquelle je ne touche pas. « C’est des histoires plus complexes que tu ne le crois. On ne peut pas se mettre mal avec un évêque, en fait. Tu sais bien que je travaille avec le Vatican... Et puis, je vais te dire, tout ça, c’est des conneries... Humbert était un homme important, ton père a étudié dans ce collège, et moi j’y suis allé ensuite. » Il fait une pause d’une seconde à rallonge. « Je peux t’assurer d’une chose, mon grand, s’il avait dû toucher un gamin, ça aurait été moi. À moins que tu ne penses que je sois trop moche pour ça... » Outre la faute de conjugaison, je pense que j’aurais dû lui couper la parole, histoire d’éviter que des mots comme les siens ne se matérialisent, ne soient lancés dans l’air. Il y a les conneries que l’on entend au quotidien, pendant une conférence de presse d’un secrétaire d’État, dans le métro quand un vieux réac se met à discuter avec nous. Celles-là, ça va, on sait quoi en faire. Il y a celles qui propulsent un
abruti condamné au pénal à la présidence des États-Unis, que l’on regarde de loin, au travers d’un océan, persuadé qu’elles ne savent pas nager ni voler, et que donc elles ne nous toucheront pas au point de bouleverser nos vies ; l’avenir nous donnera tort, mais on a encore quelques mois de déni devant nous. Et il y a celle que je viens d’entendre, qui bouleverse tous mes objectifs.
C’est un carrefour de décisions. Je pourrais lui expliquer que pour un prédateur sexuel, le choix de la victime ne réside pas, n’a jamais résidé, dans un quelconque critère de beauté. Le prédateur, comme son nom l’indique, cherche une proie, faible, qui ne l’empêchera pas, qui ne parlera pas, ne se rebellera pas, n’exercera aucune forme de résistance. Un peu comme lui quand il décide de s’en prendre à la stagiaire la plus réservée pour essayer de la coincer entre le pâté en croûte et la sangria à la fin d’un pot de départ. Je peux aussi ignorer, et poursuivre mon entreprise de démolition de ce dîner de Noël en lui répon- dant très fort, histoire de couvrir le son de l’essorage. Je peux également changer d’objectif, comme quand un président est élu pour faire barrage à l’extrême droite, et que finalement, non.
Là, mon nouveau projet ne serait pas de raboter les acquis sociaux, mais de creuser. Comprendre les limites de la connerie de Jean-Marc. Ce serait un voyage dans les abysses du manque d’esprit, une véritable exploration de la jungle de la bêtise, on y trouverait de la phallocratie, un peu de racisme, de l’ultralibéralisme, une aversion pour la moindre notion de déterminisme social qui viendrait ternir son grand roman à base de « Quand j’étais jeune, j’étais voiturier. Je me suis fait tout seul, moi » – après vérification, il a en effet exercé un petit boulot de ce type l’été de ses dix-huit ans, alors qu’ils étaient en vacances à La Baule ; j’ai une pensée émue pour tous ceux qui se paient une grande école en bossant au McDo pendant des années. Mes yeux se plantent dans les siens, il serre mon avant-bras avec la puissance d’un homme de soixante ans en rogne. Je n’aimerais pas être sa stagiaire. Il y a au fond de son regard une imperceptible douleur, un voile de tristesse que je n’ai jamais vu auparavant, une assurance envolée, carapace de façade. Je pourrais croire qu’il va pleurer.
Une bulle se forme autour de nous. Il n’y a plus la litanie du mari de ma tante sur la gauche, il n’y a plus les Xanax de sa femme, mon cousin le requin, et les autres qui ont la réactivité d’une moule. Jean-Marc souffre, sans que je sache s’il y a quelque chose de profond, d’enfoui sur lequel j’appuie, ou au contraire si je suis en train d’écailler un vernis construit à force de soixante années de faux-semblants, d’une éducation stricte, de business schools prestigieuses, de postes à responsabilités. Tout cela semble avoir vacillé, simplement parce que je menace de gâcher Noël. Derrière les pattes-d’oie au coin de son œil franc, direct, il y a une faiblesse. C’est ça, une faiblesse. Un déni de quelque chose, d’une réalité qui viendrait bousculer l’Église comme institution politique, protectrice de ses fidèles et de ses vassaux, pour questionner Dieu, non pas par son existence, mais par ceux qu’Il a choisis pour le représenter sur la surface du globe. Alors, les certitudes des Jean-Marc s’évaporeraient, et les espoirs de ceux qui n’y croient plus referaient surface, après une apnée de plusieurs siècles de domination cléricale. C’est peut-être ce qui se joue au fond du regard de Jean-Marc ; peut-être ça que je menace de balayer comme on souffle sur des miettes de pain, en annonçant à toute la tablée ce qu’elle sait déjà, en la mettant face à ses propres contra- dictions. Comme si l’on disait à quelqu’un qui se plaint de grossir qu’il faut arrêter de s’enfiler des pots entiers de Nutella. Tant que la vérité n’est pas présente dans l’air, on ne la palpe pas, et on peut l’ignorer.
La prise de Jean-Marc se fait encore plus ferme, c’est douloureux. Coralie coupe son chapon comme si elle voulait en scier les os avec le couteau de sa ménagère, ça fait un bruit strident sur les porcelaines héritées de ma grand-mère. Son mari en est à dire que Hollande est trop mou et, étouffant un rot, s’envoie une grande gorgée de pomerol. La femme de Jean-Marc a perçu quelque chose, mais regarde les petits pois dans son assiette comme si elle était en train de les compter. L’apocalypse semble proche, sans que rien soit encore arrivé de notable. Pas de tonnerre qui se râcle la gorge, ni d’éclair à travers la fenêtre, juste l’essorage de la machine à laver, et le flash de l’appareil photo de Coralie, qui a laissé tomber son découpage clinique pour immortaliser la tablée.
5
Coralie n’a pas beaucoup de fantaisie. À part une envie de prendre des photos en tout temps et en tous lieux, une impressionnante propension à la pingrerie et, parfois, un gloussement étouffé, rien ne la définit vraiment. Si bien que lorsqu’elle apporte sur la table une bûche dont le parfum n’inspire aucun réconfort, style pamplemousse et fleurs de sureau, les figurines de nains en train de faire semblant de la découper à l’aide d’une scie qui fait deux fois leur taille ont été retirées. Il n’en reste que deux petits trous plantés dans la crème de pamplemousse, et dans lesquels l’ensemble de la tablée, au moment du dessert, semble vouloir disparaître. Lorsqu’elle m’en sert une part dans une assiette ornée de bougainvilliers, son geste est si brusque qu’on croirait qu’elle me colle une gifle, et la pâtisserie s’écrase sur l’émail avec un bruit de flaque qui doit rappeler à Raymond sa dernière promenade.
Il est 21 h 30, tout est calibré pour que nous puissions aller à la messe de minuit pour 22 heures pétantes. Chaque année, la basilique Sainte-Clotilde organise une superbe messe où tout le VIIe arrondissement a rendez-vous pour se donner la paix du Christ, bouffer une hostie, et balancer du venin sur le contrôle fiscal de son voisin de banc. Coralie n’a jamais beaucoup d’idées, ni de répartie. Contrairement à Jean-Marc qui, dans la fange de sa connerie déconnectée, a développé une forme d’intelligence, Coralie ne m’a jamais évoqué autre chose qu’une huître. Un organisme vivotant autour de la table de Noël, doué de peu d’intelligence, que je rêve de voir, un jour, se recroqueviller dans sa coquille de nacre. Cependant, il subsiste en elle une lueur de quelque chose, parfois. Sa manière de vouloir à tout prix que tout aille bien, d’immortaliser les choses sur la rétine de son appareil photo, le fait qu’elle soit une femme trompée tellement ouvertement qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de déve- lopper une capacité au déni qui confine à la psychiatrie. Elle est sans doute devenue idiote avec le temps, s’aper- cevant que savoir relier les points entre eux causerait sa chute. Je la plains plus que je ne lui en veux.
Avant qu’elle ne meure – obsèques dont l’oraison funèbre avait été écrite par Humbert –, ma grand-mère insistait pour que nous allions la voir dans son Ehpad. C’était une maison de retraite pour les riches, donc il y avait un grand jardin ; en revanche, que l’on soit riche ou pauvre, les Ehpad puent. Il y a, dans la vieillesse ou dans la diminution, un retour à l’égalité. Ou plutôt, la révélation que les inégalités n’ont pas tant d’importance que ça. Les coups portés sur les aînés, les privations de repas, les injures, l’humiliation de laisser des quasi-centenaires des heures entières dans des draps souillés de merde existent dans tous les types d’établissements pour personnes dépendantes. Face aux cerveaux où s’étendent petit à petit des zones d’ombre, face à l’incapacité de s’exprimer, face aux délires de la sénilité, l’être humain, souvent, révèle le pire de lui-même. On gère des flux d’individus, et on génère des profits. La sourde oreille se prête plus facilement aux complaintes éraillées de l’âge.
Je m’astreignais à y aller, sans trop savoir pourquoi. Ce sont des souvenirs immondes. D’abord, je n’aimais pas voir les gens si vulnérables, entendre les vieux qui chialent parce qu’on leur a piqué un truc, et une aide-soi- gnante en galère, qui doit s’occuper d’une vingtaine de patients à elle seule, tenter de garder patience face à cette montagne à gravir pour un SMIC qui lui est reversé au lance-pierre à la fin du mois. Mais surtout, je détestais ces après-midi, parce que Jean-Marc avait formellement interdit que l’on informe ma grand-mère de la mort de mon père. Et comme elle ne l’aimait pas, il ne pouvait pas profiter, face à elle, de l’immunité que l’on accorde aux défunts. Ainsi, les quelques fois où je suis allé la voir, la vieillesse étant parfois une arène propice à la haine, elle déversait sur mon père une bile immonde. Je m’asseyais, docile, sur le coin d’un lit médicalisé, et écoutait, sous l’œil lâche et torve du reste de la famille, ma grand-mère m’expliquer à quel point il était un homme indigne de cette famille, à quel point il se désintéressait des autres jusqu’à ne pas visiter sa propre mère dans un mouroir (sic). Et Jean-Marc ne bronchait pas, ne prenait la défense de personne, ni ne cherchait à trouver d’excuses à son frère. Il se contentait de hocher la tête, l’air de dire « Que veux-tu ». Ensuite, Coralie nous prenait en photo à côté du lit aux draps pas encore souillés, et à ce moment-là, j’imprimais le sourire triste que l’on apprend aux enfants bourgeois, celui destiné à dissimuler les souffrances, un sourire que l’on devrait enseigner à chaque capitaine de bateau tant il permet d’éviter de faire des vagues. Je ressortais de là et pleurais tout ce qu’il me restait de larmes en imaginant les cendres de mon père dispersées aux quatre vents, sa main sur la mienne qui n’existerait plus. Ces instants passés dans la puanteur de vieille soupe me rappelaient que j’étais le dernier des clocharistos, le gardien d’un héritage qui n’a besoin d’aucun notaire. La dernière brin- dille d’une branche sur laquelle Raymond avait dû pisser plus que de raison.
Je pense que c’est à la faveur de l’un de ces après-midi que j’ai pris la décision de ne plus avoir de famille. Nous avions organisé les quatre-vingt-dix-huit ans de ma grand- mère dans la salle polyvalente de l’Ehpad. Coralie avait apporté des macarons de chez Picard, et nous avions suivi l’habituel rituel des faux culs, bougies sur le gâteau, filet de bave et photo gênante. J’avais aidé à débarrasser la table sur laquelle nous avions festoyé, et mis le reste des macarons dans la grande poubelle commune. Nous étions tous partis les uns après les autres, et j’avais humé l’air frais en rêvant d’une clope. En tâtant mes poches, je n’avais pas senti mon paquet. Je portais un manteau avec des poches obliques, desquelles des trucs se cassaient tout le temps la gueule. Mes cigarettes avaient dû tomber pendant le moment de convivialité. J’avais rebroussé chemin, remontré patte blanche à la dame de l’accueil, et m’étais dirigé vers la salle. La porte était ouverte, et la lumière allumée. Nous nous étions installés tout au fond, j’avais donc dû traverser l’endroit dans une semi-pénombre jusqu’à notre table. À mi-chemin, j’avais distingué une ombre voûtée au fond de la salle. Je n’aime pas surprendre les gens, alors j’avais gentiment toussoté, en bon petit bourgeois. La silhouette s’était redressée comme si elle avait pris une châtaigne. J’avais allumé la lumière. Coralie était debout au fond de la pièce, à côté de la poubelle. Un tupperware à la main. Elle était en train de récupérer les macarons que j’avais jetés. Elle avait bredouillé, comme si je l’avais surprise en train de coucher avec un infirmier. Cet instant a marqué une rupture. Dans tout ce qu’elle a de détestable, je me suis mis à la plaindre.
Pour des raisons évidentes, je ne touche pas à ma part de bûche. Je me lève pour aller pisser, ce qui permet à mon avant-bras de se dégager de l’étreinte de Jean-Marc. Il me suit. Dans le corridor qui mène aux chiottes, je le vois qui cherche à me rattraper. J’accélère le pas et m’enferme dans les gogues. Mon téléphone était resté dans ma poche, je le saisis. C’est idiot, une notification. Il y a celles que l’on ignore, et celles qui nous font accélérer le cœur. C’est un SMS de mon cousin le requin. « C’est Mgr Humbert qui va officier à la messe de Sainte-Clotilde ce soir. Ne pense pas que je n’ai pas vu ton petit manège avec le journal pendant la photo, j’ai tout compris. Mais je t’en prie, ferme ta gueule. »
Quand je sors, Jean-Marc est debout dans le couloir, face à une bibliothèque de livres que Coralie et son mari n’ont jamais lus. Ses yeux ne sont plus voilés d’un quelconque je-ne-sais-quoi, ils sont remplis de larmes. Il me chope par le cou, sa poigne est puissante. Je reste coi quelques secondes, le temps pour lui de dire : « Ne gâche pas tout... Tu ne sais rien. » Alors que je m’apprête à lui foutre un coup de genou dans le ventre, il lâche prise et fait demi-tour. Ça tourne autour de moi, j’ai l’impression de ne plus pouvoir respirer. Je me rattrape au mur, mon dos plaqué contre le béton ciré. Je me laisse glisser et me pose par terre. Là, enfin, l’air revient à force d’une toux sourde.
6
Je suis le mouvement sans broncher. Jean-Marc se tient à distance de moi, nous progressons le long de la rue de Bourgogne, puis la rue Saint-Dominique, le ministère de la Défense à gauche, un petit jardin d’enfants dans lequel mon père et moi allions jouer au gendarme et au voleur. Derrière, l’immense bâtisse et ses deux pointes qui se dressent dans l’ombre du ciel. Le parvis est assez large pour y accueillir les parties de foot des gosses du quartier, quelques marches mènent jusqu’à l’église. Une foule compacte est massée aux entrées, derrière des grilles en fer forgé précédant les étroites portes de bois communes à la plupart des lieux de culte, avec un petit sas pour protéger des courant d’air, ou pour que ce qui se passe dans l’église n’ait pas de prise directe avec le tumulte du dehors, le progressisme, la protection des plus jeunes. L’intérieur est impressionnant, haut et gris comme dans n’importe quelle basilique néogothique, avec de beaux vitraux et des tableaux de scènes destinées à intimider les impies – le Christ portant sa croix et, au-dessus, une demi-douzaine d’hommes qui plantent des clous dans ses chairs. Je mets quelques gouttes d’eau bénite sur le bout de mes doigts, opère une génuflexion et un signe de croix. Par respect pour ce qui est plus puissant que moi. Mon père avait longtemps oscillé, en matière de religion. Haïssant les culs-bénits, et vénérant une puissance supérieure. La judéité et le christianisme n’ont cessé de se croiser dans les vies de mes parents, si bien qu’aujourd’hui, je sais aussi bien respecter le rite du sabbat que réciter un « Je vous salue Marie ». J’en ai développé ma propre religion, qui n’a qu’un seul fidèle – c’est bien plus difficile qu’on ne le pense d’être fidèle à soi-même. Dieu a toujours été pour moi un voisin du dessus sympathique, pas dérangeant, voire très discret, et qui possède une part écrasante des tantièmes de la copropriété. Ne sachant pas vraiment s’Il est là ou pas, ni ce qu’Il aime ou pas, je tente de bien me comporter et de ne pas foutre le bordel jusqu’à 4 heures du mat’ dans la studette qu’est mon existence.
Coralie nous guide vers le banc qui nous est réservé, au troisième rang. On va pouvoir observer Humbert de près, et même, lors de la communion, nous irons dans sa file. Il est hors de question de se faire remettre le corps du Christ par un jeune prêtre. Le banc est en bois, inconfortable. Des livrets de messe sont posés dessus. J’aime bien les livrets de messe, ça me permet de savoir s’il y en a encore pour longtemps. S’il y avait des livrets de messe pour l’existence, on se ferait vachement moins chier. Humbert, pour son come-back, a concocté un programme de choix.
Plein de prières à gerber de bons sentiments, des litanies sur le caractère sacré conféré à l’Enfant Jésus ; s’il avait pu, on aurait fait entrer un gâteau avec 2024 bougies, des feux de Bengale et des danseurs brésiliens. Mais je crois qu’il serait inhumain de faire danser des gens torse nu dans le froid qui règne entre les pierres multicentenaires. Coralie s’est stratégiquement installée à côté de moi, elle a l’air excitée en feuilletant le livret, c’est peut-être ses morceaux favoris. Son mari est assis les mains croisées sur le ventre, il envisage d’engager la digestion de son chapon et des toasts au foie gras, comme chaque année. Coralie lui filera des coups de coude quand il faudra se lever, et on le verra debout en train de faire de légers mouvements d’avant en arrière, comme un culbuto, parce qu’il est un tout petit peu bourré. Ma cousine, qui a la larme facile, sera forcé- ment émue au moment de l’épisode sur les traces de pas dans le sable, c’est en quelque sorte le Je te promets des ecclésiastiques, et mes deux autres cousins sont en pilote automatique. En bout de rangée, la femme de Jean-Marc a l’air inquiète. Son mari est sorti passer un coup de fil. Un 24 décembre... Je suis au milieu du banc, aucun moyen de me tirer. Le spectacle commence, Humbert apparaît, au-dessus de lui brille la loupiote rouge qui représente le Saint-Esprit.
Il traîne sa vieille carcasse plus qu’il ne marche. Il a encore des cheveux gris coiffés avec une raie sur le côté, et une paire de lunettes à verres grossissants, dont la monture, large, moitié en forme de carré, moitié en forme de cercle, lui bouffe une grosse partie du visage. Elles sont un peu fumées, elles ressemblent à celles de Claudy Focan dans Dikkenek ou de Francis Heaulme. Comme si les opticiens avaient dans chacune de leurs boutiques un rayon dédié aux pervers. Il approche de son micro et parle sans jamais lever la tête, avec l’air fuyant de ceux qui n’ont jamais expié leurs péchés devant une cour d’assises. Au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. Au nom du père... Je me penche vers Coralie et lui murmure : « J’ai hâte qu’on en soit à la paix du Christ. » Elle a une déglutition d’aristo. On vous l’enseigne à l’étape 2, juste après le sourire qui masque la souffrance.
Jean-Marc ne m’adresse pas un regard. J’ai l’impression d’avoir pris une fessée quand j’ai senti sa poigne d’homme se serrer autour de mon cou, tout à l’heure. Lorsque j’ai vu la douleur, la détermination dans ses yeux. Comme si tout me dépassait réellement, alors que c’est simple. Simple comme une prière, simple comme la foi, qui ne devrait pas exiger d’apprendre des mots par cœur, ni de se plier à des rites. C’est simple comme un type puissant qui couvre un pédophile.
Pendant les chansons, je fais du playback, Coralie est à donf. Elle a une voix de crécelle, pas une note ne sonne juste, mais elle y va, la Coralie. Si Humbert jetait son aube dans la foule, je pense qu’elle irait foutre des coups de griffe aux autres groupies pour emporter un morceau d’étoffe. Humbert marmonne un long monologue sur l’amour, le micro est mal réglé, si bien qu’on entend le ploc-ploc de sa bave de pervers au coin de ses lèvres. Je comprends qu’on arrive à la paix du Christ. Au moment où je m’apprête à piquer mon petit scandale, mon portable vibre. J’ai l’incorrection de le regarder pendant la messe. Coralie enrage. C’est rien, une notification. De la merde, la plupart du temps. Et en général, quand c’est Le Monde, je les ignore copieusement. Celle-ci, je la lis. Sans doute pour énerver un peu Coralie, aussi pour me donner une conte- nance. Jean-Marc Decaux, ancien vice-président de la multi- nationale PHB, se joint à l’action civile contre Mgr Humbert. Je lève les yeux vers le bout de la rangée, et vois mon oncle en larmes, son téléphone allumé dans les mains. Nos regards se croisent, sans haine, cette fois-ci. Je m’approche et le prends dans mes bras. Il parle avec une voix étouffée. « La paix du Christ, mon neveu », « La paix du Christ, Jean-Marc. Pardon », « J’ai aussi fait ça pour mon frère, tu sais... Allez viens, on se casse, je n’ai pas envie de communier ce soir. Dieu me pardonnera ».
En larmes, on sort tous les deux de la basilique Sainte-Clotilde sous les yeux éberlués du reste des parois- siens. Il est immense, le parvis de Sainte-Clotilde. Il est assez grand pour accueillir l’ensemble des culs-bénits du VIIe, pour une partie de foot à vingt-deux joueurs, et pour permettre à Jean-Marc d’expier toute la douleur contenue depuis cinquante ans. Il aspire une bouffée d’air froid et pose sa main sur mon épaule. Sa poigne est ferme, plus encore que durant le dîner. Il descend les quelques marches qui nous séparent du parvis. Au nom du père, donc.
Titres parus
N° 1 — T9, Blandine Rinkel
N° 2 — Au pays de la bouffe, Mathieu Palain
N° 3 — Le premier cri, Abigail Assor
N° 4 — Ego Hugo, Arthur Dreyfus
N° 5 — La nuit Cayenne, Victor Dumiot
N° 6 — Le dernier twist, Frédéric Perrot
N° 7 — Entre les bruits du monde, Laura Poggioli
N° 8 — Les mots sont patients, Maylis Besserie
N° 9 — Entre chienne et louve, Julia Malye
N° 10 — Tu connaîtras la peur, Salomé Berlemont-Gilles
N° 11 — L’odeur du sapin, Alexandre Galien
N° 12 — Le prix de la journée, Nadège Erika
N° 13 — Cath, Léna Ghar
N° 14 — Bolaño, Macron et moi, François-Henri Désérable